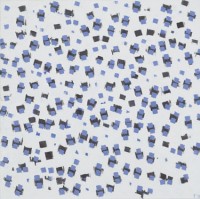Mark Rothko renonça assez vite à l’art figuratif et en particulier à la représentation des personnes parce qu’il avait « l’impression d’abimer le visage ». Renoncement qu’on ne peut discuter (c’est-à-dire contester) du point de vue esthétique, voire sur le plan éthique. L’artiste est souverain. Mais si l’on considère l’histoire des idées et leur formalisation, on peut effectivement s’interroger sur ce glissement qui relègue au rang de quasi archaïsme la question de la figure humaine. Faut-il y voir comme Paul Virilio la matérialisation d’un art impitoyable qui a, entre autres, récusé l’histoire d’après 1945 (même si l’horreur n’est pas réductible à cette période) ? Il est en tout cas troublant que Rothko ne peignit qu’un auto-portrait, en 1936.
En 1936, pendant que d’autres organisaient l’effacement systématique des juifs, le peintre abandonnait l’idée de se tenir à distance de lui-même. L’affaire, nous l’avons écrit d’emblée, semblait avoir une raison plus théorique. Néanmoins, cet abîme avait aussi à voir avec cette question d’identité qui allait faire de Markus Rothkowicz, à partir des années 40, Mark Rothko. Troncation du nom, mais dans une certaine limite, pour ne pas tomber dans l’identifiable immédiat : Roth, comme Philip Roth ou Joseph Roth, par exemple… Ne plus se peindre parce qu’il y a, peut-être, une difficulté à se peindre. Un problème de légitimité. Dès lors, on regarde cette unique expérience avec une certaine circonspection.
La question de la ressemblance n’est pas vraiment au cœur du tableau. On le reconnaît assez facilement, si l’on se réfère aux photos de l’artiste. L’œuvre n’est pas en soi très remarquable. Les couleurs sont pauvres, l’angle de vue est assez classique (l’amour de Rothko pour Rembrandt), les proportions n’ont rien d’originales et nous sommes loin des « déformations » qu’ont depuis longtemps exploré les cubistes et leurs suivants. Alors quoi ?
Les yeux. Encore que le terme soit inapproprié, puisque Rothko porte déjà les lunettes qu’on lui connaît. Mais ce n’est évidemment qu’un élément secondaire, parce qu’il s’agit plutôt du regard. Et le regard est d’abord une question dynamique. Si les yeux existent en soi, le regard, lui, n’a de sens que dans le rapport avec l’objet qu’il a en perspective. Le regard, c’est à la fois l’acte mais aussi un choix, une manière de. Il est l’essence même de la peinture et de sa théâtralisation (si l’on veut se rappeler que l’étymologie grecque du mot renvoie au verbe « regarder »). Il est le fondement de l’art de Rothko, comme de tout peintre. La peinture est un regard porté sur quelque chose et la manière de faire procède d’une manière de voir.
Quid donc de cet œil dissimulé, de cette obscurité fondamentale dans la représentation de soi ? Il ne ferme pas les yeux, mais il accentue l’écran par quoi n’importe qui peut prétendre être une énigme. Faut-il croire qu’un homme aussi grave que Rothko puisse ainsi se mettre en scène ? Ce serait à peine croyable. Si l’on considère la position du corps, le trois-quarts face, il est de toute manière évident que le modèle ne nous regarde pas. Son œil fuit quelque part. Il n’essaie pas d’accrocher notre attention. Le vrai trouble tient au redoublement de cette noirceur que le spectateur peut décomposer : le noir de l’organe et le quasi noir des verres de lunettes. De quelle angoisse cette dissimulation marque-t-elle la vérité ?
Car c'est bien une angoisse latente que nous raconte cet autoportrait. La noirceur désignée du regard n'est pas une afféterie, mais la trace d'une (in)consciente torture de ce qui sera l'appui de l'artiste pour exister, pour s'exprimer. Et l'on descend un peu plus bas dans le tableau, pour observer les mains. Croisées, l'une sur l'autre, l'une tenant l'autre, la pressant, comme s'il y avait péril en la demeure. Les mains, ou l'autre medium de la peinture, ce qui traduit la vision, lui donne sa densité. Le passage du virtuel au réel. La crispation que l'on sent en elles est troublante. La liberté est comme absente de l'œuvre. L'artiste n'est pas au travail (il est habillé pour sortir, peut-être, avec sa cravate) mais il porte toute l'attention de sa représentation autour des deux conditions de son existence comme peintre. Ce n'est pas son visage qu'il abîme, ni même sa figuration sociale ou proprement existentielle. On y lit plutôt un étrange aveu de cette impossibilité à aller au-delà de ce qu'il serait censé représenter. Il se montre et on pense petit à petit à une posture de contrition, à la mise à peine transformée (la cravate est bien sûr trop claire, trop voyante) d'un homme en deuil. De qui ? De quoi ? Comme le tableau ne contient lui-même aucun élément narratif extérieur, il ne reste pour le spectateur qu'à se retourner vers le sujet en tant que tel : Rothko lui-même.
Cette œuvre est à la fois très belle et très émouvante. Elle est si loin de ce qui fera le succès de l'artiste, de son goût pour les couleurs vives, avant que ne viennent les tons sombres et la touche finale de la chapelle de Houston. Certes, il est toujours facile de revisiter une toile à la lumière d'un destin tragique et d'en faire un acte prémonitoire. Une toile n'est pas un acte, sinon à être déclarée comme telle. Mais cette volonté, dans cet unique autoportrait, de se dépouiller du moindre orgueil de l'art est poignante. La simplicité y est une forme d'aveu et une manière de clore le débat autour de l'homme. Arrivé à ce point, on comprend mieux pourquoi il a voulu explorer l'énergie de la couleur, d'où il pouvait se soustraire.