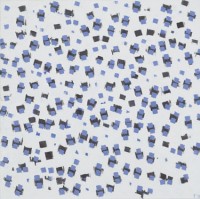Ce n'est pas la nouvelle du mois, bien sûr. Ce n'est même pas une nouvelle, dans le sens où il y aurait, à l'apprendre, un effet de surprise. L'annonce est un grain supplémentaire dans l'implacable subversion des valeurs, qui interdit les hiérarchies, magnifie une pseudo-culture populaire et relègue au rang des ennuyeux et des empoussiérés le monde des arts, des sciences et du politique (comme quoi, le politique contemporain, parce qu'il n'a plus que le nom de politique, peut achever ce qu'il est censé représenter).
En la ville de Chantonnay, il y aura bientôt un boulevard Thomas-Voeckler. Pas une impasse ou une petite rue. Un boulevard. Qui est-il, diront certains ? Une sommité locale, un responsable régional, un enfant du pays (comme on disait parce que maintenant cela a des accents paysans et clairement ringards) ? Nullement. Il est coureur cycliste. Un coureur du passé, mort ? Un compagnon de l'époque mythique qui aura fait s'extasier Jarry ou Blondin (surtout Blondin) ? Nullement. Il a trente-quatre ans. Il va revêtir pour la prochaine saison chaussures, gants, cuissards et maillots. Il est parmi nous, et comme en eut le droit, jadis, Victor Hugo, et il fut le premier d'entre tous, il entrera dans la toponymie des lieux de son vivant. Je ne sais pas ce que pense l'intéressé d'être ainsi canonisé par l'institution. Sans doute répondra-t-il qu'il est ému, honoré, et fier : tel est le vocabulaire en vigueur. Le cœur et la gravité devant ce qui n'est pas commun. Et nous, qu'en penser ?
L'affaire, face à l'effroi du monde, etc., etc., etc., ne demande pas de commentaires. C'est ainsi, d'ailleurs, que fonctionne pour le mieux le désordre, quand ils nous astreignent, le monde et le désordre, à ne pas faire de commentaires. À nous taire. Le temps contemporain fabrique de la futilité, en fait son actualité, à une vitesse vertigineuse, détricotant le passé, mais nous interdit de prendre cette entreprise sur son versant idéologique, si bien qu'il ne nous reste plus qu'à acquiescer. Car au fur et à mesure que s'accumulent les anecdotes onomastiques, les attributions fantaisistes à des minores de nos rues et de nos bâtiments institutionnels, on finit par se dire qu'il s'agit bien d'une entreprise de neutralisation des valeurs (1). Tout est dans tout et rien ne mérite qu'on le distingue. D'ailleurs, il s'agit de faire peuple, d'être décoincé et ouvert. Très important, cela : décoincé et ouvert. On dirait même open...
Le sport ayant acquis un tel statut dans le monde contemporain, il est donc légitime qu'on lui donne une part belle dans les artères de nos villes et de nos villages. Et comme le sport n'a pas eu le temps de s'inscrire vraiment dans le temps, qu'il est même une négation du temps, consommant ses héros à vitesse grand V, il ne reste plus qu'à prendre le train en marche et à les sanctifier de leur vivant. Ainsi Thomas Voeckler...
Sur ce point, le moment choisi n'est peut-être pas anodin. En cet automne où la statue du Commandeur Armstrong a été dévissée en quelques semaines, cet hommage sent bon sa revanche cocardière. Le bon petit Français contre le méchant Américain, le pot de terre contre le pot de fer, l'honneur outragé contre la félonie outrecuidante (mais à la fin battue). C'est tellement bon d'avoir de ces petites victoires qui ramènent à l'auto-glorification. On imagine que le sportif français est le chevalier blanc de l'effort à l'eau de source, du combat à mains nues, de la souffrance pure, pure, pure. Si donc il s'agit de s'enorgueillir d'un combat qui, contre un libéralisme sportif prônant le résultat coûte que coûte, se réclame du seul mollet vaillant et de la volonté inoxydable, je trouve alors que Chantonnay, c'est un peu petit. Je ne doute pas que l'ami Delanoë (2), qui aime être hype en diable, ne sera pas en reste. Pour lui éviter de passer trop de temps sur une carte, je lui suggère ainsi de débaptiser l'avenue des Champs-Élysées pour qu'elle devienne avenue Jacques-Anquetil, que la rue de Rivoli soit désormais la rue Bernard-Hinault et que la place Clichy, si chère à Céline (tant pis pour lui), soit actualisée en place Raymond-Poulidor. C'est, je le concède, une mythologie de peu, mais il faut bien faire avec ce qu'on a (3).
La roue tourne et suivant les chemins d'une rêverie mi-sérieuse mi-désabusée, de se souvenir d'un des actes fondateurs d'une destitution de l'art, il y aura un siècle, l'an prochain : Marcel Duchamp avec ceci :

(1)À commencer par tous ces collèges ou lycées Jacques-Brel, Barbara-Hendricks, Georges-Brassens, René-Goscinny...
(2)Je précise que j'ai choisi Delanoë parce qu'il dirige la mairie de Paris, que Paris est la capitale de la France, que Paris est la plus grande ville de France. Mon ironie n'a rien à voir avec son orientation sexuelle. Je préfère l'écrire parce qu'en ces temps de délire autour de l'homosexualité, certains, peut-être, y verraient là l'expression latente d'une certaine homophobie.
(3)Car, un jour, il adviendra que nous aurons des rues Bernard-Henry-Lévy, des places Michel-Drucker et des Impasses Bernard-Pivot...
 Jackson Pollock, Number 1, 1950
Jackson Pollock, Number 1, 1950