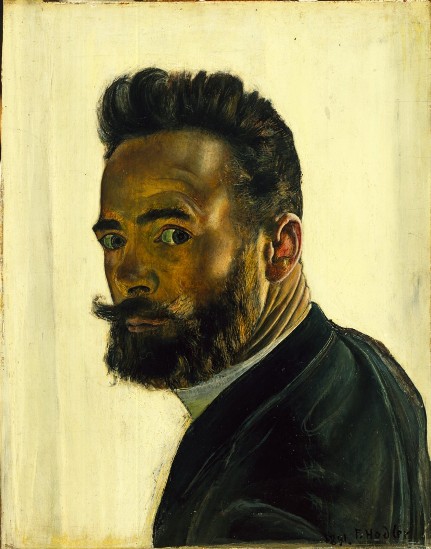Eugène Boudin, Plage de Trouville, 1868
En 1853, Flaubert, un jour qu'il contemple une plage normande et ceux qui y sont, écrit à Louise Collet : "Il faut que le genre humain soit devenu complètement imbécile". Le jugement est, comme souvent chez lui, sans appel. Faut-il le mettre sur le compte d'un pressentiment qui finira effectivement par se vérifier, de la horde criarde et brûlée par le soleil se déversant sur des kilomètres de sable ? sur celui d'un dégoût pour la platitude de l'espace lui-même, métaphore d'un esprit embourgeoisé qu'il juge, ce n'est pas nouveau, inepte ? Ou bien sont-ce ces corps à demi nus auxquels il associerait une image de décadence ? Le fait est qu'en ce milieu de siècle le monde se tourne progressivement vers le littoral, dans un mouvement qui doit d'ailleurs beaucoup à la princesse Eugénie. Et Boudin composera de nombreuses toiles sur le sujet, des toiles magnifiques.
Ce peintre n'est pas le plus connu du mouvement impressionniste et si son nom ne faisait pas sourire beaucoup de ceux qui le découvrent, peut-être même serait-il plus encore ignoré. Il y a pourtant un tel charme dans ses œuvres qu'il faut lui rendre justice. Boudin, d'abord, ce sont des ciels, des ciels qui souvent recouvrent une partie majeure du tableau, comme dans celui choisi plus haut. Sur ce plan, thématique, il n'est pas très original et l'impressionnisme les collectionne. Il n'en a pas l'exclusive, certes, mais lui, au contraire de beaucoup d'autres, a su en capter l'essence incertaine, la quasi disparition parfois, la grâce éparpillée, souvent, sans jamais aller jusqu'à la tourmente : le ciel d'orage n'est pas son domaine. Il s'agit d'être léger, de saisir justement cette épaisseur insaisissable de l'air qui nous amène à ne considérer l'espace lointain ni comme une menace, ni comme un fond. Plus qu'aucun autre, il suggère le passage, rappelant la dernière réplique de L'Étranger, dans Le Spleen de Paris écrit par Baudelaire : "J'aime les nuages... les nuages qui passent... là-bas... là-bas... les merveilleux nuages !" Même la relative opacité du ciel de Trouville n'échappe pas à ce principe. C'est un voile qui ne peut pas s'éterniser, une pulvérisation qui attend de disséminer ses reflets rosés, une buée, une vapeur enchanteresse que ne craignent nullement ceux qui s'ébattent dans la Manche, dans la partie gauche du tableau. Le bouillonnement des vagues avec lesquelles ils luttent est beaucoup plus dense, d'une épaisseur d'eau en contact (et donc en frottement) avec le sol. S'il y avait une quelconque inquiétude, elle serait là. Petites taches des corps, noyés dans l'ensemble du tableau, comme s'ils n'étaient qu'un élément très secondaire. Et c'est le cas.
Car la plage, ou plus exactement la grève, est le sujet essentiel. Des hommes et des femmes en villégiature (il serait anachronique de parler de vacanciers) y sont installés. Des tentes de toile ont été montées, préfigurant les petites cabines que l'on trouvera ensuite, plus en arrière, et qui font le charme étrange des côtes de la Mer du Nord, de la Normandie et de la Bretagne (1). Rien, dans les choix vestimentaires, ne laisse présager le lieu. Les robes sont soignées, les costumes de mise. Sans doute sont-ils, les unes et les autres, un peu moins apprêtés mais la distinction demeure. On discourt doucement, nul n'a oublié son éducation. il n'est pas question de jouer ou de courir. Le vent maritime est à peine sensible. Il ne s'agit pas encore d'être dans l'agitation moderne née des congés payés, mais, en quelque sorte, de prolonger, dehors, dans un endroit qui, apparemment, ne s'y prêtait pas, les rites d'une civilité ordinaire et bien comprise. La plage n'est pas encore cette hétérotopie de la liberté factice et de la mise en scène, du corps sculpté et de l'égalitarisme illusoire. Sa jouissance récréative reste l'apanage d'un petit nombre. Boudin peint une caste voluptueuse et tranquille. Le tableau, avec la position un peu lointaine de l'artiste, nous ménage un spectacle quasi silencieux, où les déplacements, les gestes n'enfreignent jamais les limites de la bonne éducation. L'élégance est une seconde nature.
La délicatesse de cette toile émane de l'unité chromatique. Les taches de rouge sont amorties par la couleur du sable, ce qui donne l'impression que tout se réduit à du bleu, du blanc, du noir, de l'ocre, On passe d'un détail à un autre, d'un groupe à un autre sans que l'œil ne soit jamais agressé. Il y a une continuité apaisante, singulière qui nous permet également d'admirer les personnages et d'être une sorte de génie invisible. Cette délicatesse produit un double décalage temporel pour le spectateur. Il est soudain ramené à un univers à la fois désuet, où le désir aristocratique demeure, et familier, puisqu'il a lui aussi connu les joies de la plage. Mais il contemple également une préfiguration proustienne. Certes, Boudin ne fut pas des modèles principaux qui permirent à l'écrivain d'élaborer la figure d'Elstir mais il n'est pas difficile de rapprocher le Port de Carquethuit dont la "puissance (...) tenait peut-être plus de la vision du peintre qu'à un mérite spécial de cette plage". Cette grâce discrète de Boudin prend pour nous une forme toute littéraire et si, comme nous le disions, les discussions sont feutrées, il est peut-être, en quelque conciliabule rapide, le début d'une romance. Boudin peint alors bien plus qu'une scène, qu'un moment balnéaire, une histoire que les règles vestimentaires savent encore, symboliquement, cacher, quand la part du mystère ne recouvre pas, loin s'en faut, celle du mensonge (2).
À ce titre, il est l'impressionniste dont la contemplation provoque l'étrange regret de n'avoir pas connu ce temps, à l'inverse de bien d'autres artistes de ce mouvement, à l'urbanité trop moderne. En regardant ses toiles, on rétrograde ; la vitesse décroît. Il repose sans jamais alanguir. Un moment de bonheur...
(1)Une quasi privatisation de l'espace public diront certains. Mais, on a fait bien mieux depuis, avec les plages avec droit d'entrée, ou interdites au quidam. Pour une fois, laissons cette question de côté.
(2)Dans Bains de mer, bains de rêve, publié en 1960, Paul Morand rapporte l'anecdote suivante :
"Je me souviens d'une boutade de je ne sais quelle gazette : deux jeunes gens étendus au bord d'une piscine avec deux jeunes filles ; l'un souffle à l'autre : "On les emmène ?" - "Attendons d'abord de les voir habillées". Cela m'avait fait rire, puis réfléchir. Le vêtement en dit long sur l'homme ; nu, il cachera plus jalousement ses secrets. Je vois sous le soleil à pic, une société ténébreuse, et qui ment."