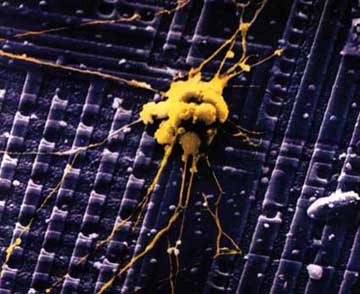François-René de Chateaubriand n'est pas seulement, dans la tradition aristocratique des mémoires, le fin contempteur des hypocrisies de son temps, entre le ridicule des ultras et la vaine suffisance des nouveaux maîtres. Il n'est pas que le contemplateur mélancolique d'un monde qui s'enfuit et que les quarante ans sur lesquels se déploie son œuvre immortalisent pages après pages, à la manière d'un monument funèbre.
François-René de Chateaubriand ouvre aussi à son ambition littéraire la porte des âmes abandonnées par l'Histoire, à commencer par sa famille. Il parle de celle-ci avec tout l'équilibre d'un homme encore touché par le devoir de la retenue. Le respect grave pour le père, la tendresse un peu sévère pour la mère, l'amour inconditionnelle pour la sœur Lucile : aucun de ces nœuds affectifs ne passe outre les limites où tombera bientôt l'autobiographie. L'étalage n'est pas le propre du vicomte. Il verrait un dévoiement ridicule dans la récollection franche de ses amours et de ses blessures. Sur le plan de l'histoire littéraire (comme on dit), François-René va moins loin que Jean-Jacques et c'est tant mieux. Le dessein rousseauiste est, dans le fond, funeste (même s'il n'est pas question de lui imputer ce qui lui succède) : il ouvre la boîte de Pandore des vigilances égocentriques, celles de la vie recyclée en ravissement...
Chateaubriand est pudique. La trace discrète de ses déchirements n'en est que plus ardente et précieuse. Ainsi pour évoquer la disparition du frère.
"Mon frère ne vint point ; il eut bientôt avec sa jeune épouse, de la main du bourreau, un autre chevet que l'oreiller préparé des mains de ma mère."
Une phrase suffit, une seule, dans laquelle toutes les vies semblent tenir. "Mon frère ne vint point". La f(r)acture de la mort arrive sous la forme d'une dissimulation, une formule suffisamment neutre pour que l'on puisse, le cas échéant, imaginer l'imprévu ou la fuite, presque un manquement au devoir. "Il eut bientôt avec sa jeune épouse". La parataxe réunit immédiatement deux temps et deux réalités en face à face. Quelque chose s'est passé dont l'effet va arriver (quoique déjà arrivé pour celui qui écrit. Tel est le fracas de la rétrospection.), ce quelque chose placé sous le signe du lien indéfectible du mariage. Et ce lien, comme un nœud gordien pour des temps obscurs, est tranché "de la main du bourreau". Un homme, un homme seul, et une main unique, métonymique, pour une cérémonie macabre et politique dont l'objet est le nom et la particule. C'est une mort qui n'a que peu à voir avec la justice et beaucoup avec la prétention hasardeuse de triomphants en mal d'honneur. Comme pour Lucile, la disparition du frère a la rigueur sordide d'un monde qui se pare d'une vertu sanglante avant d'imposer sa propre terreur pour le siècle qui s'engage : ses répressions populaires, des canuts à la Commune, son libéralisme progressiste propre à abrutir les faibles, ses vanités nobiliaires et impériales. Tout cela pour des Louis-Philippe, des Napoléon III et des monsieur Thiers à qui on offre des funérailles grandioses. Autant dire une misère.
Chateaubriand noircit plus encore le spectre de l'exécuteur des basses œuvres quand il évoque, en contrepoint, le souvenir familial et les "mains de (sa) mère" qui ont préparé "l'oreiller". C'est l'heure du coucher, la fin du jour, le foyer, le lit, l'attention maternelle, tout un univers dont Proust, plus tard, fera une cérémonie. Tout reste ici modeste. À la férocité révolutionnaire, il répond par un geste simple, une quasi banalité, dont il fut sans doute le témoin et peut-être le destinataire caché.
Cette attention qui n'avait même pas besoin de se dire pour exister, par sa naturalité, exhume des vies perdues à la source de l'écriture, et des affections profondes. Le travail mémoriel les concentre en un tableau unique. Quoique défaite et meurtrie par le temps et les événements la famille Chateaubriand persiste dans son humanité de victimes, sans que l'écrivain cherche le pathos. Il ne fait que rétablir la chaîne de la filiation qui va du fils à la mère. À eux en somme le premier et le dernier mot de la phrase et, au delà, le dernier mot de la vie dans sa transcendance. La Loi peut tout enlever de ce qui fait le commun politique : elle ne peut entacher le récit particulier des instants grâce auxquels des êtres se reconnaissent des uns et des autres. C'est comme si l'effraction de l'ordre collectif n'arrivait pas à atteindre la délicatesse de l'être jusqu'à ériger celle-ci en souvenir inaliénable. Plus encore : dans cette confrontation entre le criminel et la mère, Chateaubriand rappelle avec sobriété combien la cruauté ne tient pas qu'à la sentence elle-même mais aussi à la négation humaine qu'elle induit. L'écrivain reprend alors possession de ce qu'on l'a privé, sans plus d'épanchement, par la simple autorité d'un détail que toutes les oppressions du monde ne pourront jamais anéantir.
Il y a longtemps que la littérature autobiographique, et particulièrement contemporaine, ne pense plus un tel degré de finesse, de telles subtilités. Or ce sont elles qui donnent aux Mémoires d'outre-tombe leur éclat kaléidoscopique si particulier et leur beauté si poignante.