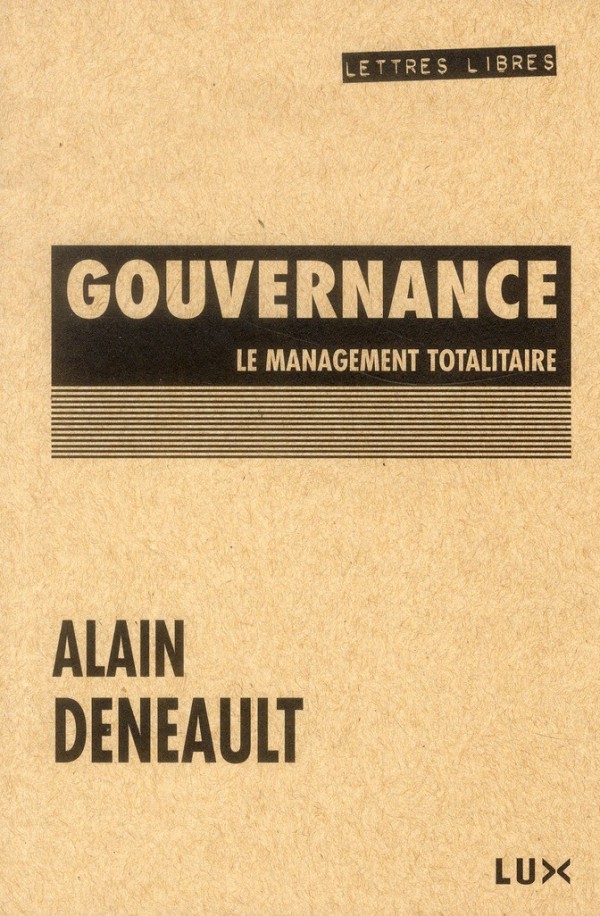"L'une des victoires du postmodernisme est d'être considéré et apprécié comme un mouvement profondément de gauche, progressiste voire contestataire. Il impose partout une image contrefaite, se déclarant bien plus libertaire que libéral. Il s'y entend comme personne pour soutenir toutes les postures et ne jamais défendre un seul combat qui évoquerait, même de loin, l'existence d'une lutte des classes. "L'indigène de la République" se substitue à l'exploité, les "queers" font l'impasse sur les luttes féministes et l'hétérosexualité devient un impérialisme à combattre. On conteste la domination de l'homme blanc abstrait, jamais celle de la marchandise concrète. Le rejet postmoderne de toute histoire révolutionnaire ne s'explique que par le refus de l'anticléricalisme de celle-ci. Sous la variante gauchiste, le "pomo" est celui qui, de façon toujours confusionniste, soutient la cause palestinienne, la jeune fille voilée et le "garçon arabe" en se référant exclusivement au passé colonial de l'Europe mais sans jamais rattacher ce passé à l'histoire des luttes de classes. C'est pourtant, du XVIIe au XXe siècle, l'histoire de la guerre sociale qui explique l'exploitation conjointe du prolétariat européen et des populations colonisées. Que le prolétariat soit absent de l'argumentation postmoderne n'est pas innocent : on y sent l'épouvantable odeur d'œuf pourri de Dieu.
Pour Noam Chomsky, les "pomos" sont de vrais fascistes s'exprimant avec un discours de gauche. Pourtant, une vérité aussi irréfutable et si facilement vérifiable n'est pas toujours entendue, tant les "pomos" sont habiles à détourner le langage et à retourner à leur avantage les critiques de leurs adversaires. Une pareille impunité repose d'abord sur le principe de non-engagement du postmodernisme, qui se contente d'emprunter à la critique sociale l'identité de la victime. Elle repose ensuite sur une très efficace pratique du "lobbying" favorisant l'occupation des postes clés au sein de l'université et des médias, et par l'activation de cercles plus spécialisés du pouvoir économique et politique, à l'image des "think tanks", des organismes supranationaux et de quelques départements des services de renseignements. On peut dire brièvement que ces cercles définissent les thématiques que les médias et les universitaires convertis à ces nouvelles thèses diffuseront massivement. Cette description, un rien mécaniste, ne traduit pourtant pas fidèlement le processus, car, au final, le calcul n'y joue pas un rôle supérieur à celui du suivisme ordinaire. Les résultats de cette organisation en réseau sont cependant exemplaires : par un mensonge sans cesse renouvelé, c'est le "pomo" qui est de gauche, progressiste, lui encore qui invente et réinvente une nouvelle conception de la liberté, de la sexualité et des corps."
Jordi Vidal, Servitude & simulacre, Allia, 2007