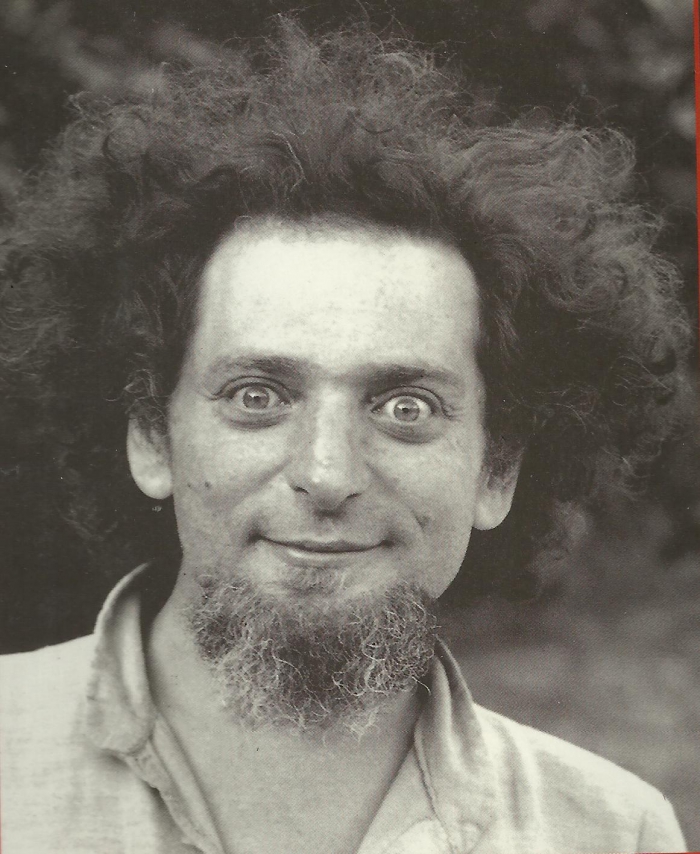"Lorsqu'on emploie trop de temps à voyager, on devient enfin étranger en son pays." Voilà ce qu'écrivait Descartes, dans Le Discours de la méthode. Il en savait quelque chose, lui qui vécut si longtemps dans les Provinces-Unies avant de mourir en Suède.
Force est de constater que nous n'avons même plus besoin d'un quelconque exode, ou d'une longue pérégrination incertaine pour éprouver ce singulier sentiment de l'étranger face à ce qui nous entoure. Il suffit d'entendre la conjuration des imbéciles qui nous gouvernent pour s'assurer que nous ne sommes plus en France. Le travail de sape d'une histoire française continue de plus bel. Il s'agit d'abattre les dernières réticences pour que le triomphe d'une mondialisation barbare et assassine achève son œuvre. Il faut encore quelques coups pour que ce qui fait notre substance (du moins la mienne tant la violence de ce qui se passe me touche au plus profond) ne soit plus qu'une longue procession marchant gravement vers le cimetière. Je suis né en France, j'y ai vécu et je ne suis pas sûr d'y mourir (pour le temps que Dieu me prêtera vie). Pas sûr, en effet, parce qu'à choisir il vaut mieux être un étranger dans une contrée qui vous regarde comme tel, plutôt que de l'être dans ce qui fut naguère votre patrie.
Le multiculturalisme libéral s'était appuyé depuis longtemps sur le relativisme gauchiste, son goût de la repentance unilatérale, sa soumission sournoise à l'ordre marchand, ses combats contre la langue fasciste (vieille antienne des Tel quellistes qui, dans le même temps, trouvaient Mao formidable), son obsession contre l'église catholique, son adhésion à un concept fourre-tout de culture, dont même Lévi-Strauss a fini par mesurer qu'il nous menait vers la terreur de la pensée individualisée comme revendication en soi. Le multiculturalisme libéral et le relativisme gauchiste sont des alliés objectifs pour que nous ne soyons plus nous-mêmes, c'est-à-dire ni des citoyens, ni des hommes d'un lieu, ni des hommes d'une culture. À la place il y a le libre-service d'une pensée morcelée et d'un droit exorbitant à satisfaire ses moindres désirs, ce qui revient à infantiliser l'individu pour qu'il puisse être le plus docile possible et adhérer aux lois du marché divinisé (1).
Le progressisme, quand il n'est pas le fruit d'une réflexion longue et mesurée, c'est la mort. Ni plus, ni moins. C'est la science sans conscience, la technique sans morale, le contrôle permanent pour le bien de tous et la violence psychologique en ligne de mire, parce que le nouveau management, par exemple, n'est pas une erreur du système mais son fondement. Notre devenir est sombre mais il y a tant de raisons de s'amuser, de se divertir, au sens pascalien bien sûr : le foot, les comiques, le porno, les jeux de hasard, le portable, la coke démocratisée, le new age, la sagesse orientale... que tout passe, et que les catastrophes les plus sournoises ne font l'objet d'aucune attention, ni médiatique, ni politique. Peut-on de toute manière espérer autre chose de la sphère journalistique et de l'univers politique ? Je vois combien cette tournure d'esprit qui est la mienne (mais je ne suis pas le seul) n'a que peu de chance d'être entendue. Cela est prévisible quand on a érigé, au fil des décennies, la contestation de fond en théorie du complot. L'ordre libéral agit face ce qui se présente comme opposant selon deux manières.
Soit il intègre, il digère et il fait du nouvel élément neutralisé un instrument pour justifier de sa tolérance : propagande de la prétendue liberté. C'est le mode de la récupération. Il suffit de voir combien l'art, et en particulier l'art américain depuis 45, a servi les causes de l'impérialisme dont il croyait faire le procès. Il intègre ce qui est, dans le principe, un avatar de sa dialectique. Il faut être d'une bêtise incommensurable pour s'extasier sur Andy Warhol ou Jeff Koons et ne pas comprendre en quoi ils ne sont ni provocateurs, ni subversifs mais des exploitants rusés d'une liberté d'expression qui se résume à la mise au point d'un concept exploitable, aussi débile soit-il.
Quand il n'intègre pas, le libéralisme fustige, calomnie, manipule, incarcère parfois. Il a beaucoup appris du nazisme et du stalinisme, en fait. Les Américains ont d'ailleurs avec diligence recyclé un certain nombre d'hommes du IIIe Reich au sortir de 45. Histoire de voir. Comme au poker. Il ne peut y avoir de vérité que dans ses livres et ses analyses : le libéralisme a toujours raison et ses partisans, au nom de la liberté, défendent cette idéologie. La liberté, à n'importe quel prix. La liberté du marché, à n'importe quel coût... Si l'on n'entre pas dans le cadre, on est banni. La force du libéralisme dans sa forme contemporaine tient à ce qu'il ne semble rien imposer. Mais tout coule de source.
Cette dernière semaine, donc, pendant que la France idiote s'indignait des turpitudes de François Fillon, turpitudes qui, si elles sont avérées, et rien n'est moins sûr, sont dans l'ordre classique des pratiques politiques françaises (2), pendant que les antennes, les sites web et le papier journal faisaient leurs choux gras des malheurs du sarthois, on apprenait que le comité pour la candidature de Paris aux JO de 2024 avait choisi son slogan : Made for sharing. N'est-ce pas magnifique ! La langue française boutée hors de son territoire. Pourquoi ? La raison invoquée, celle qui semble la plus acceptable sans doute, renvoie au fait que 80 % de ceux qui vont décider de l'attribution parlent anglais. Ainsi fallait-il se plier à cette exigence du colonisateur anglo-saxon : prendre sa langue, apprendre sa langue et oublier la sienne. Ce que les Allemands ne réussirent pas à faire en 40, le libéralisme du nouveau siècle y parvient. Et cela, au mépris même de la langue à laquelle on se soumet, parce que le moindre individu maniant l'anglais sait que Made for sharing, c'est du globish de mauvais élève, que jamais un Anglais n'userait de cette formule, et qu'il dirait simplement : For sharing. Les décérébrés qui ont applaudi à ce choix de collabos n'ont même pas été capables d'écrire correctement dans leur nouvelle langue. Leur esprit est tellement esclave des ordres financiers et des espoirs de breloques qu'ils ont négligé la grammaire (3). Ils sont comme le Esaü biblique : ils perdent leur âme pour un plat de lentilles. Ce choix ne peut se réduire à un parti pris marketing, parce qu'il touche à l'une des essences qui font ce pays : la langue. Après avoir abandonné ses frontières et sa monnaie, avec toutes les conséquences prévisibles que l'on connaît, après avoir renoncé à sa souveraineté (4), voilà qu'elle renonce à sa langue.
Le lecteur comprendra mon émoi. La langue : celle de mon père, celle de ma mère. La langue maternelle. Ce dont je suis constitué au plus profond. La langue de mes premières écritures, de mes premières lectures, des auteurs de l'enfance (5). Renier sa langue est une des pires trahisons auxquelles on puisse céder. C'est oublier le regard que l'on a sur le monde, abandonner le partage des temps anciens, faire taire la voix intérieure de ses colères secrètes, de ses chagrins honteux, de ses interrogations parfois futiles. Dans la langue maternelle, il y a le chant intime des heures et la fructification par la lecture et la parole de toute une éducation. Abandonner cela, c'est être vil. Abandonner sa langue, dans un cadre officiel, c'est ne plus vouloir être. C'est éteindre son intériorité en abandonnant l'antériorité de la langue. Ceux qui agissent ainsi ne connaissent ni la fierté, ni le courage. Ils nieront, arguant qu'ils ont le goût de l'effort et du sacrifice, qu'ils savent donner d'eux-mêmes. Sans doute, s'ils parlent de performances, de temps, de muscles, d'entraînement. Mais ce sont là des considérations individuelles, des appréciations égocentrées. Je parle, moi, de la langue comme partage et comme identité, de la langue qui charrie des siècles et transporte des histoires, des récits. Le français. La langue française. Et je pense à du Bellay, à la Pléiade, à la souplesse spirituelle de Montaigne, à la rigueur de Racine, à la subtilité des moralistes classiques, à l'inventivité de Diderot, aux méandres rousseauistes, à la tournure déliée de Beaumarchais, à l'éclat mélancolique et acéré de Chateaubriand, à la précieuse magie nervalienne, au brio de Stendhal, à la torsion rimbaldienne, aux excès de Huysmans, aux salves de Barrès et de Péguy, à la circumnavigation mémorielle de Proust, à l'ampleur claudélienne, à la brutale lucidité de Bernanos, aux jongleries pérecquiennes, à la luxuriance de Chamoiseau.
Je pense à eux quand, comme un écho à la bêtise olympique, je lis deux jours plus tard le suffisant Macron affirmer : "il n'y a pas de culture française. Il y a une culture en France et elle est diverse." Que faut-il entendre sinon qu'il s'agit de facto de jeter le passé aux orties, de se contenter d'une culture de l'immédiateté, du temps présent, consommable, participant du mouvement consumériste général. Propos négationniste devant l'histoire sans doute, à condition de considérer qu'il y ait une Histoire. Or, la saillie macronienne nous informe du contraire. Comme un relent des annonces de Francis Fukuyama en son temps, le pseudo franc-tireur de la politique hexagonale tire un trait sur le passé. Il se démasque et apparaît alors, derrière l'arrogance jeuniste, le procès fait à notre filiation spirituelle, intellectuelle et morale. On renvoie ainsi la littérature, les arts, la culture classiques, à n'être plus que des vestiges poussiéreux que l'on pourra au mieux javelliser pour les vendre à des visiteurs incultes et photographes.
L'annonce de Macron a le grotesque des formules qui se veulent révolutionnaires. On peut en rire. On en rirait d'ailleurs s'il était seul dans son coin, si sa phrase était héritée d'un esprit de provocation très français, comme on en trouve chez Joubert, Paul-Louis Courier, Joseph de Maistre, Bernanos. Mais ce n'est pas cela. Il s'agit d'une annonce programmatique, d'une formulation toute politique. Et par un hasard sinistrement facétieux, on retrouve l'écho du globish. Macron nie une culture française pour une culture made in France en quelque sorte. C'est plus qu'une nuance : la transformation de la culture en produit, selon des principes qui obéissent à une loi du marché. Or, le marché ne veut pas, sauf à développer des niches pour happy few, de produits trop marqués. Il faut voir grand, être mondial. C'est l'ici et maintenant qui compte : la culture comme élément intégré à la croissance, à l'épanouissement du PIB. Dès lors, il est nécessaire de reléguer le passé aux oubliettes, et ce pour deux raisons.
1)Une partie du passé est inexploitable comme tel. Pour des raisons juridiques (l'inscription aux monuments historiques par exemple) ou pour des raisons de distance culturelle, justement (en quoi les églises ou la peinture religieuse signifient-elles encore quelque chose dans une société déchristianisée ?). Ce passé-là, sauf à le relooker, comme on dit, ou à en faire un spectacle de foire (les fameux sons et lumières), est lettre morte.
2)Si la culture est désormais un produit (quoique cela ne date pas d'aujourd'hui : le XIXe bourgeois post-révolutionnaire avait compris son intérêt et le sinistre Voltaire, déjà...), elle ne peut s'intégrer que dans la logique du renouvellement, dans cette catastrophe de l'étonnement, de la surprise, de l'inattendu, comme n'importe quel article manufacturé ou n'importe quel service. Or, l'indexation de la création sur le degré de nouveauté est une des explications de l'appauvrissement de celle-ci.
L'imposture funeste de Macron tient dans le déplacement même du référent français. La détermination d'une "culture en France", contrairement à ce que supposerait une lecture rapide, ne renvoie pas à un concept historique incluant un temps écoulé, le tradition (et donc : une transmission), mais à une réduction spatiale quasi géographique dont le contenu neutralise justement toute considération temporelle. La géographie physique sans l'histoire, si l'on veut. La France n'est plus qu'une étendue circonscrite mais figé. C'est une aire qu'il faut comprendre comme une étiquette. Culture made in France. A ce point la France n'est plus un pays, pas même un territoire. Le négationnisme mondialiste pousse sa logique jusqu'au bout.
Cette manière de passe l'histoire par la fenêtre est en cohérence avec l'entreprise troublante qui, depuis les premières aspirations européennes d'après-guerre, sous couvert d'une défiance envers l'attachement national, veut dévitaliser, bien au-delà des craintes fascistes (ou supposées telles), la légitime filiation de l'homme français dans sa relation au lieu où il a vécu et dont il sent la présence viscérale. Il s'agit de la francité qu'il faut éliminer. Une francité qui n'a rien à voir avec un quelconque repli sur soi. Elle a été caricaturée : frilosité, xénophobie, étroitesse d'esprit (6). L'expérience de la profondeur peut-elle être ainsi bassement qualifiée quand on en trouve la voix chez des auteurs aussi divers que Barrès, Proust, Larbaud (7), Béraud, Giono, Jouhandeau, Aragon, Michon, Bergounioux, Millet,... Et qu'affirme Senghor, en 1966, dans un discours à l'université Laval de Québec : « La Francophonie, c’est par delà la langue, la civilisation française, plus précisément l’esprit de cette civilisation, c’est-à-dire la culture française, que j’appellerai Francité ». C'est rien que cet esprit multi-séculaire que veut liquider Macron.
"Il y a une culture en France, et elle est diverse." Nul n'a besoin d'être grand clerc pour décrypter le sens de cette dernière considération. La diversité dont parle Macron correspond à la transformation ethnico-culturelle dont le think tank Terra Nova a théorisée les implications politiques, transformation que l'on voudrait nier mais qu'un chercheur comme Christophe Guilluy a très bien analysée (8). Il faut ainsi comprendre que la France n'existe plus que comme une immanence géo-politique, intégrée à des préoccupations propres au marché, et la transcendance historique non seulement n'est plus prise en considération mais doit être niée. L'accueil enthousiaste fait à une immigration massive, sur laquelle peu s'interrogent quant à son surgissement (9), n'est pas un hasard. Sur ce point, la théorie du grand remplacement de Renaud Camus est insuffisante parce qu'elle s'en tient à une conception ethnicisée du territoire autant qu'à une interprétation historique de la démographie. En fait, ce bouleversement ne se fait pas dans le seul but de détruire l'Europe : il s'agit d'un modèle plus général de déterritorialisation des individus. Le migrant d'aujourd'hui n'est pas le gagnant de demain : il est le futur esclave d'un espace dans lequel il reste, volontairement ou non, étranger, remis à un communautarisme étroit, capable d'être là ou ailleurs. Le nomadisme du pauvre n'est pas le cosmopolitisme du riche mais il est utile au riche pour pouvoir anéantir toute implication sociale et culturelle autre que celle d'une participation peau de chagrin à la grande aventure de la globalisation. La diversité est comme la littérature-monde : une mascarade pour embellir l'asservissement (10). Voilà pourquoi Macron, l'ultra-libéral (11), hait la France, l'histoire de France et tout ce qui pourrait entretenir notre mémoire.
Macron est le pire de ce que quarante ans d'intérêt pour la politique nationale m'ont mis devant les yeux. Voter Macron, c'est le néant d'un demi-siècle d'existence. Qu'il puisse devenir président d'une république que je conchie ne me dégoûte pas : cela m'effraie.
(1)On lira avec profit Thomas Frank, Le Marché de droit divin.
(2)C'est dans tous les cas d'un affreux ridicule que de voir des opposants à Fillon se draper de vertu quand on connaît le parcours de certains. Que Cambadélis, condamné, et comme tel repris de justice en somme, dirige le PS et que nul ne s'en émeuve, voilà qui donne à réfléchir.
(3)Il est vrai que : 1) la grammaire est depuis longtemps une bête à abattre, un signe de distinction qu'il faut détruire. La polémique autour du prédicat est le dernier avatar de cet acharnement à détricoter la langue. 2) le monde sportif brille par la qualité de son expression : athlètes, journalistes et dirigeants sont des infirmes du subjonctif, confondent le futur et le conditionnel, usent d'un vocabulaire peau de chagrin où la nuance et la précision n'existent pas.
(4)Pour n'être pas dupe des mensonges qui ont suivi et des fausse repentances des thuriféraires de l'ordre bruxellois, je renvoie à la lecture, certes longue mais instructive, du discours de Philippe Seguin, en date du 5 mai 1992, touchant au traité de Maastricht. Il avait tout dit. Il n'était pourtant pas devin. Il était simplement français.
http://tempsreel.nouvelobs.com/rue89/rue89-document/20110506.RUE2200/discours-du-5-mai-1992-de-philippe-seguin.html
(5)Auteurs d'enfance qui ne furent jamais des auteurs pour enfants, il est vrai. Je ne suis pas de la génération qu'on a nourrie à coup d'histoires creuses, à la syntaxe simplifiée.
(6)Pour plus de clarté sur le sujet, on lira l'article de Georges-André Vachon, datant de 1968, qui définit fort bien le cadre et les enjeux de ce néologisme.
https://www.erudit.org/revue/etudfr/1968/v4/n2/036315ar.pdf
(7)Sur la figure de Larbaud, il y aurait beaucoup à dire tant ce grand (et très sous-estimé) écrivain porte en lui l'ambiguïté du cosmopolitisme, ambiguïté que son intelligence remarquable sublime dans cet attachement au pays natal, au Bourbonnais dont il évoque si profondément la grandeur dans Allen. De même, pour Proust dont l'admiration pour Barrès et ses textes sur les églises en France éclairent aussi certains aspects de la Recherche.
(8)Christophe Guilluy, Fractures françaises, Flammarion, 2013
(9)L'explication autour de certains conflits ne tient guère la route. Ces cinquante dernières années n'ont pas été avares en massacres, déplacements de populations, génocides, guerres civiles. Pourquoi maintenant ?
(10)Camille de Toledo, Visiter le Flurkistan ou les illusions de la littérature-monde, PUF, 2008
(11)Lequel Macron est le plus heureux des candidats devant l'accord commercial CETA, avec le Canada, qui prévoit des tribunaux placés au-dessus des états pour gérer les dysfonctionnements du marché.