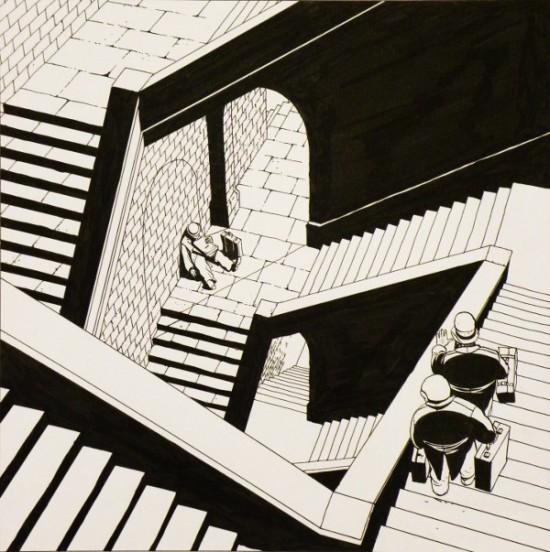Hier un homme a été tué. Un vieil homme. Il a été martyrisé. Non pas parce qu'il était français, non parce qu'il était un citoyen, mais parce qu'il était catholique. Sa qualité de prêtre accroît pour certains l'indignation ; c'est néanmoins faire de l'habit un faux argument pour évacuer le sens profond de cette abomination. J'aimerais qu'on entende bien en le disant ce que signifie cette phrase : un homme est mort parce qu'il était catholique. Qu'on la dise avec la même intensité que lorsqu'on rappelle qu'un homme est parce qu'il était juif, par exemple. Ainsi articulée, avec la lenteur qu'elle requiert pour chacun des termes qui la composent, on mesure toute la portée de ce qui se trame. L'ennemi profond des islamistes, c'est le christianisme, et plus particulièrement le catholicisme. Il l'est depuis la nuit des temps théologiques. Si l'on ne veut pas entendre toute la portée de cette menace, nous disparaîtrons ou nous serons réduits à l'esclavage. L'Autre, si cher à Lévinas, mais d'abord au message évangélique, sera éradiqué, comme l'ont été les chrétiens d'Orient et du Maghreb (essayez d'être chrétien en Algérie...).
Mais il ne suffisait pas que le crime se fasse à l'autel, il fallait que la victime soit salie post-mortem. La république maçonnique qui nous gouverne, dont la haine pour le prêtre, est une des pensées majeures, encourageant la déchristianisation de la France, la déshistoricisation de sa population, réduisant notre passé à deux siècles de marchandages, d'obscurantisme positiviste (1), celui-ci a osé, hier soir, par la voix de son maître, affirmer que ce crime, c'était "profaner la République". Profaner ? Comment cela se peut-il ? Qu'y a-t-il de sacré dans ce régime dont l'histoire est un tissu d'inepties, une collection d'ignominies et un tableau de racailles corrompues (2) ? Où y a-t-il une quelconque spiritualité dans le jeu des pouvoirs et d'un régime qu'un profiteur éhonté dont se réclame l'actuel thuriféraire en chef qualifia de coup d'état permanent ? Comment le mépris du peuple par des gens de peu pourrait-il être sacré ? Si, au moins, à défaut de miracles, on avait au sommet de l'état Marc-Aurèle ou Cincinnatus, nous aurions moins de dégoût. Mais ce n'est pas le cas.
On sent bien la gêne et les tentatives pour déminer le terrain. Mais ce ne sont que de piètres dialecticiens et Valls fait un aveu indirect quand il dit craindre une guerre de religions. Comment est-ce possible dans une République laïque que, paraît-il, le monde entier nous envie sans que nul ne veuille en faire le fondement de sa pensée politique ? Il est vrai que la laïcité en question a d'abord été une arme pour détruire l'église catholique et si elle avait mis autant de zèle à mater ces trente dernières années les exigences politiques de l'islam qu'elle en a mis pour pétrifier la pourpre cardinalice, nous n'en serions sans doute pas là.
Ceux qui pensent que le chapelet des valeurs républicaines impressionne des engagés qui placent Dieu hors de tout sont des idiots, des fous dangereux. On n'oppose pas à une revendication politique confondue avec des appuis spirituels (dont je ne discute pas ici la pertinence. Ce qui prime, c'est la logique combinatoire) des principes matérialistes et bassement juridiques par lesquels nous nous affaiblissons terriblement (3). Après le Bataclan, le leitmotiv était superbe : "nous retournerons au concert et nous siroterons à nouveau en terrasse." Voilà de quoi durcir la démocratie, politiser les foules et rendre spirituels le troupeau d'abrutis festifs qui rythment leurs existences avec Facebook, Instagram, Pokemon-Go, les Nuits sonores, Harry Potter, les rails de coke, Adopteunmec et j'en passe, dont le rapport au monde n'excède pas le temps de leur propre mémoire, et qui disent ce qu'ils pensent avec d'autant plus de facilité qu'ils ne pensent rien.
Nous ne pourrons éternellement nous aveugler, en réduisant la spiritualité à un choix consumériste et prétendument démocratique, où le religieux est soit une grossièreté, soit un paramètre de l'expression individuelle : aujourd'hui bouddhiste, parce que c'est tendance, comme le tatouage, demain animiste, après-demain macrobio ou je ne sais quoi, au gré de l'influence des gens qui comptent ou des progrès de la science qui anéantit l'homme par le biais de la bio-politique (4).
Il y a un siècle et un peu plus, à des titres divers, Bloy, Barrès, Huysmans, Proust ou Péguy sentaient le gouffre d'un abandon pluri-séculaire. Mais sans doute est-ce déjà Chateaubriand, à la fin des Mémoires, qui sonnait avec ardeur le tocsin, ce cher Chateaubriand dans la prose duquel, pour l'heure, je me réfugie. Voici ce qu'il écrit, dans le quatrième tome de son œuvre majeure. Le chapitre s'intitule "L'idée chrétienne est l'avenir du monde".
"En définitive, mes investigations m'amènent à conclure que l'ancienne société s'enfonce sous elle, qu'il est impossible à quiconque n'est pas chrétien de comprendre la société future poursuivant son cours et satisfaisant à la fois ou l'idée purement républicaine ou l'idée monarchique modifiée. Dans toutes les hypothèses, les améliorations que vous désirez, vous ne les pouvez tirer que de l'Evangile.
Au fond des combinaisons des sectaires actuels, c'est toujours le plagiat, la parodie de l'Evangile, toujours le principe apostolique qu'on retrouve: ce principe est tellement ancré en nous, que nous en usons comme nous appartenant; nous nous le présumons naturel, quoiqu'il ne nous le soit pas; il nous est venu de notre ancienne foi, à prendre celle-ci à deux ou trois degrés d'ascendance au-dessus de nous. Tel esprit indépendant qui s'occupe du perfectionnement de ses semblables n'y aurait jamais pensé si le droit des peuples n'avait été posé par le Fils de l'homme. Tout acte de philanthropie auquel nous nous livrons, tout système que nous rêvons dans l'intérêt de l'humanité, n'est que l'idée chrétienne retournée, changée de nom et trop souvent défigurée: c'est toujours le Verbe qui se fait chair !
Voulez-vous que l'idée chrétienne ne soit que l'idée humaine en progression ? J'y consens; mais ouvrez les diverses cosmogonies, vous apprendrez qu'un christianisme traditionnel a devancé sur la terre le christianisme révélé. Si le Messie n'était pas venu, et qu'il n'eût point parlé, comme il le dit de lui-même, l'idée n'aurait pas été dégagée, les vérités seraient restées confuses, telles qu'on les entrevoit dans les écrits des anciens. C'est donc, de quelque façon que vous l'interprétiez, du révélateur ou du Christ que vous tenez tout; c'est du Sauveur, Salvator, du Consolateur, paracletus, qu'il nous faut toujours partir; c'est de lui que vous avez reçu les germes de la civilisation et de la philosophie.
Vous voyez donc que je ne trouve de solution à l'avenir que dans le christianisme et dans le christianisme catholique; la religion du Verbe est la manifestation de la vérité, comme la création est la visibilité de Dieu. Je ne prétends pas qu'une rénovation générale ait absolument lieu, car j'admets que des peuples entiers soient voués à la destruction; j'admets aussi que la foi se dessèche en certains pays: mais s'il en reste un seul grain, s'il tombe sur un peu de terre, ne fût-ce que dans les débris d'un vase, ce grain lèvera, et une seconde incarnation de l'esprit catholique ranimera la société.
Le christianisme est l'appréciation la plus philosophique et la plus rationnelle de Dieu et de la création; il renferme les trois grandes lois de l'univers, la loi divine, la loi morale, la loi politique: la lois divine, unité de Dieu en trois essences; la loi morale, charité; la loi politique, c'est-à-dire la liberté, l'égalité, la fraternité.
Les deux premiers principes sont développés; le troisième, la loi politique, n'a point reçu ses compléments, parce qu'il ne pouvait fleurir tandis que la croyance intelligente de l'être infini et la morale universelle n'étaient pas solidement établies. Or, le christianisme eut d'abord à déblayer les absurdités et les abominations dont l'idolâtrie et l'esclavage avaient encombré le genre humain."
(1)Je renvoie par exemple au clip de campagne de l'anaphorique présidence pour qui tout commence à la Révolution, à ce moment béni où l'on massacra justement des prêtres...
(2)Le lecteur aura le loisir de se pencher sur ce que furent les scandales, les compromissions et les basses œuvres du pouvoir depuis 1870. L'exemplarité républicaine à l'aune des III et IVe versions, voilà bien une sinistre escroquerie.
(3)C'est la ligne de conduite de l'insuffisance présidentielle : ne pas sortir des valeurs de liberté dont nous serions les porteurs universels. Dès lors, pourquoi un état d'urgence ? Pourquoi jouer sur les mots, quand l'état d'exception est, depuis longtemps, la règle, au profit exclusif d'intérêts privés et commerciaux ? Mais je doute fort que l'énarchie au pouvoir ait lu Carl Schmitt, et moins encore Giorgio Agamben.
Quant à un exemple de faiblesse, sur le plan juridique : une preuve grandiose. La condamnation de la Norvège dans le procès que Breijvik a mené contre ce pays, pour traitement inhumain. Il est certain que c'est inadmissible de vouloir brusquer un individu qui pratique la tuerie collective et le salut hitlérien !
(4)Dont Foucault (quel paradoxe !) esquissa l'horreur. Mais depuis, il y a mieux à lire : Giorgio Agamben ou Céline Lafontaine., par exemple.