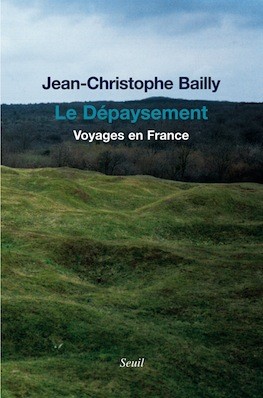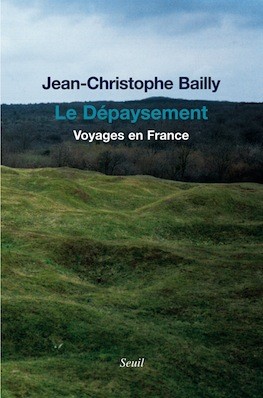
Dans les temps où Nicolas Sarkozy engageait sa campagne électorale en montant sur l'estrade pour nous confier qu'il aimait la France, qu'il énumérait les raisons de son amour, pour nous révéler aussi ce qu'était de ne pas aimer la France, en ces temps, donc, où il jouait la fibre patriotique sur une musique vieillie de la pauvre rhétorique Guaino, je commençais à lire Le Dépaysement de Jean-Christophe Bailly.
Le titre, Le Dépaysement, est sur ce point une merveille. Il feint l'exotisme facile, comme si nous avions envie de nous changer les idées (et l'auteur lui-même, croit-on...) alors que c'est justement tout l'inverse. Ce n'est pas la lassitude ou le besoin de s'aérer qui enclenche le désir de vagabonder dans l'hexagone mais la curiosité de ne pas avoir encore compris cette présence française en lui. Le sous-titre éclaire davantage : Voyages en France. Le pluriel n'est pas qu'une question de décompte des billets de train ou des trajets en voiture. Loin de cela. C'est la multiplicité qui donne du sens, le caractère fragmentaire et fragmenté de l'expérience qui remplit peu à peu l'esprit d'un tableau imparfait et pourtant saisissant du territoire. Ce livre est d'abord une incitation à penser l'irréductibilité du monde à l'idée trop facile que l'on s'en fait.
Bailly parle donc de la France, quoique ce verbe convienne mal puisqu'il écrit, et dans une langue plus sereine et plus douce que celle du binarisme élyséen. Ce n'est pas un carnet de voyage, ni un pèlerinage pour circonscrire la nation et le territoire. Ce n'est pas un recueil d'anecdotes : les personnages sont là, certes, mais ils sont en filigrane, participants précis et en même temps fugaces du décor (ce décor qu'ils ont façonné et qui les a façonnés). Ce n'est pas une enquête sociologique. Il y a chez Bailly une liberté, un délié dans le parcours, un balancement si imprévisible entre le détail, le croquis et la réflexion que le lecteur a vite la conviction que l'enjeu n'est pas la somme (le livre dans son entier) ou l'addition des parties (les chapitres cumulés) qui priment mais, étrangement, tout ce qui a été laissé de côté, tout ce à quoi ces pages nous ramènent. C'est une clef, en quelque sorte, pour regarder le monde autrement, parce que si nous y sommes, lecteurs, c'est dans les interstices du cheminement de l'auteur, cheminement qu'il faut faire nôtre, ensuite.
Ainsi nous emmène-t-il en promenade dans des lieux discrets, secondaires, dirait-on, comme pour une route qui n'est pas un grand axe. C'est Culoz, Saint-Quentin, les jardins ouvriers de Saint-Étienne, une rue singulière de Lorient, Tarascon et Beaucaire... Il ne part pas à la recherche de ce qui est français en ces lieux, parce que ce serait vouloir les réduire absolument à l'abstraction d'une sémantique que les nationalistes et les cosmopolites (1) ont pourri de leurs certitudes. Il sent plutôt ce que l'histoire a inscrit, dans le déplacement incessant de son agitation, cette imperceptible marque des choses, des dispositions architecturales, des aménagements, des tracés, des connivences avec la nature,... Son livre n'est pas celui du soleil, des chromos d'un temps doré et d'une douceur intemporelle de vivre, qui fait dire/écrire à certains qu'avant tout était absolument mieux puisque c'était avant. Ses pages sentent la pluie, le vent, une certaine difficulté à se mouvoir dans l'espace, la lenteur de l'ordinaire, de ce que les belles âmes parisiennes qui regardent le périphérique comme le début de la misère ne pourront pas comprendre, parce que pour la comprendre, il faudrait l'imaginer, et que l'imagination ne part jamais de rien. Livre de fuite (non pas de renoncement mais de fuite, quand un ailleurs proche appelle son correspondant tout aussi proche) pour nous dire que c'est d'abord le regard qui doit se remplir du monde et non l'inverse. Dès lors, il n'est pas nécessaire d'aller loin.
Mais revenons à la France de Bailly, qui n'est, on s'en doute, ni celle de Nicolas Sarkozy, kyste national-libéral dont l'incohérence sidère, ni celle des gauchistes classiques qui trouvent que, même dans le désordre et l'absurdité, la France reste un beau pays, un phare de la conscience mondiale, un modèle, mais un modèle qu'ils ne cessent de vouer aux gémonies. L'écrivain sait, lui, que parfois la parole est vaine, une sorte d'ajout à l'évidence. Dès lors, sa phrase et son sens du presque-rien émerveillent, parce que, loin de vouloir expliquer la complexité d'une nation qui a vu tant de singularités la nourrir, ces deux éléments (union de la forme et du fond) ouvrent vers un espace hexagonal fluide (les cours d'eau y ont une importance capitale) : jamais un lieu ne peut être compris sans sa proximité, même non dite ; jamais un lieu, aussi délimité soit-il sur la carte de France, ne peut être approché sans le lointain qu'on n'oserait pas habituellement lui accoler. Au fond, comme un exemple mystérieux, il s'agit d'admettre que Rimbaud, écrivain des brumes ardennaises est revenu, malgré tout, mourir en France, à l'exact opposé de sa naissance : Marseille.
Cette œuvre ouverte qu'est la France, cette impossible unité (que la mondialisation cherche absolument à détruire), cette puissance de la présence du territoire, sans désir de revendication, Bailly l'a éprouvé, écrit-il, un jour à New York. Ce sont les premières pages du livre. Il est dans un appartement. La télévision diffuse en version originale La Règle du jeu de Renoir.
« Il m'arriva ceci d'inattendu que ce film (ce que je revois, c'est seulement l'image en noir et blanc, sans dimension ni cadre) se mue en révélation. Non parce que je l'aurais alors découvert (je l'avais en effet vu, de cela en revanche je suis sûr), mais parce qu'à travers lui, à travers donc ce film qui, sans doute, est avant tout un classique du cinéma, j'eus la révélation, à ma grande surprise, d'une appartenance et d'une familiarité. Ce que ce film tellement français, ainsi visionné à New York, me disait à moi qui au fond n'y avait jamais pensé, c'est que cette matière qu'il brassait (avec la chasse, le brouillard, la Sologne, les roseaux, les visages et les voix -les voix surtout) était mienne ou que du moins, et la nuance qui ôte le possessif est de taille, je la connaissais pour ainsi dire fibre par fibre -mieux, ou pire : que j'en venais. »
Quand, désormais, les simplifications politiques et morales ne vous laissent que le choix entre un nationalisme étroit et oublieux d'une partie de l'Histoire, et un cosmopolitisme culpabilisant et haineux de la même Histoire, le livre de Bailly est un bonheur d'intelligence et de finesse. Une autre façon d'approcher le monde, ce monde qui commence aussi au bout de notre rue.
(1)Je renvoie à la querelle entre Maurras et Gide, celle du peuplier, au début du XXe siècle.
Jean-Christophe Bailly, Le Dépaysement. Voyages en France, Seuil, 2011.