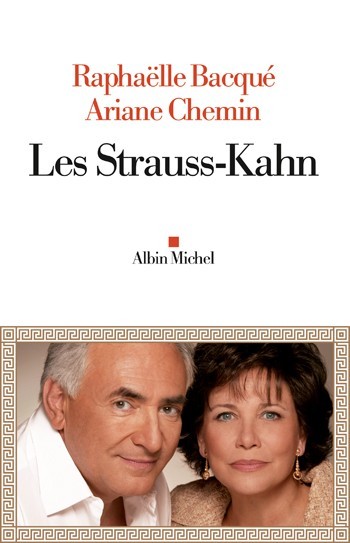La semaine passée, sur I-télé, le hasard (s'il existe) m'offre l'occasion d'écouter un débat "d'éditorialistes". Une sorte d'affrontement gauche-droite, aussi factice dans le milieu des journaleux qu'il l'est dans le milieu politique (1). Et le hasard se combinait avec la chance puisque l'un des deux artistes était Laurent Joffrin. Celui-ci sévit dans le paysage médiatique français depuis trente ans. Il en est un des représentants les plus superfétatoires. Baudruche gauchiste dans le sociétal et libéral éclairé au niveau économique. Rien que du classique.
Comme tous les gauchos patentés, sa signature, à défaut de l'intelligence, est l'indignation. Signature qui, au passage, est une exclusive : un homme de droite, ou pire : d'extrême-droite, en est sui generis privé. L'indignation est le point de Godwin de ces gens-là, leur structuration mentale par quoi tout passe, en bouillie ou en purée. Pour le coup, Joffrin était indigné. La question portait sur l'appel de Denis Tillinac concernant la préservation des églises françaises, appel paru dans Valeurs actuelles. Pour les lecteurs de ce blog qui ne seraient pas au courant, voici l'affaire.
Il y a quelques semaines, le président du CFCM, le si modéré (?) Dalil Boubakeur, accessoirement recteur de la mosquée de Paris, proposait de récupérer les églises abandonnées pour combler le déficit de mosquées. En clair, ce qu'on appellera non une transformation mais une conversion du lieu. Celui-ci, devant un certain nombre d'indignations, a rectifié le tir en disant qu'il s'était mal exprimé. On ne glosera pas plus avant sur cet essai malicieux pour tâter le terrain d'une possible islamisation du territoire à travers ses lieux symboliques, lesquels ont donné à la France une identité architecturale, intellectuelle et morale que les islamo-gauchistes et les francs-maçons s'ingénient à nier, selon une démarche révisionniste ahurissante.
Devant cette inquiétante tentative de radicalisation (2), l'écrivain Denis Tillinac a donc lancé son appel. Et Joffrin évidemment de crier à l'intox, au faux débat, au détournement. Tout cela .organisé par des hommes (et des femmes) d'extrême-droite : il suffit de nommer l'écrivain Jean Raspail pour que le tour soit joué. Ce ramassis de réac fachos n'ont rien compris et ils épousent, peu ou prou, la ligne incarnée par une lepénisation des esprits. Denis Tillinac, dont j'avais déjà défendu la position sur ce blog, est encore une fois cloué au pilori. La parole de Boubakeur n'est pas à prendre au premier degré ; celle de Tillinac si. Le propos de Joffrin n'aurait rien de particulier et ne mériterait pas qu'on s'y arrête si cet idiot, ivre de sa bêtise, ne se donnait pas le droit d'être spirituel. Il explique alors que beaucoup des églises sont dans un axe est-ouest, tournées vers l'Orient, vers Jérusalem. Dès lors, Jérusalem ou La Mecque, c'est un peu la même chose. Sublime, forcément sublime, pour plagier la bonne Marguerite Duras...
Ces considérations sont du même tonneau que celles de Boubakeur, pour qui l'islam et le christianisme sont des cultes voisins ! Balancées avec la présomption de l'inculte (nul sur le plateau ne rectifie), elles procèdent par amalgame (mot à la mode) et sont le fruit d'une ignorance crasse. Si le petit Joffrin avait un tant soit peu de culture, il saurait
-que l'orientation (qui vient effectivement du mot orient) est-ouest est un classique architecturale ; que sa pratique se retrouve dans d'innombrables civilisations. Cela établit le rapport très ancien de l'homme à la nature, et notamment au soleil. Le porche du Temple de Salomon était déjà tourné vers l'est, ainsi que le précise Ezéchiel. La question de Jérusalem, qui n'est d'ailleurs pas l'est universel, selon la latitude où nous nous trouvons, est ridicule. Elle ne fonde pas l'édification des églises occidentales.
-que la thématique de la lumière organise effectivement l'orientation des édifices chrétiens répond aussi à une symbolique déterminée par la figure même du Christ, "soleil de justice". Il est "la lumière du monde", ainsi que l'écrit Jean. L'architecture est donc le relais d'un discours spirituel et théologique spécifique à la chrétienté.
De cela, Joffrin, en bon renégat de la culture millénaire qui a bâti l'Europe, fait des raccourcis à seule fin de nier une réalité historique et intellectuelle à laquelle ses accointances islamo-gauchistes voue une haine sans bornes.
Peut-être n'aurais-je pas signé l'appel de Denis Tillinac (la pétition n'est pas mon fort), mais la bêtise mortifère de Joffrin ajoutée aux souvenirs littéraires des inquiétudes, il y a un siècle, de Proust et de Barrès, devant la ruine des églises, m'ont incité à le faire...
(1)Si l'on veut comprendre rapidement cette identité sous la fausse garde des débats dits contradictoires, il suffit de regarder quelquefois les deux chaînes d'infos en continu : BFM et I-télé. La première est vaguement de droite, l'autre vaguement de gauche. Mais dans les limites très étroites d'une doxa européenne et libérale qui les fait se ressembler comme des sœurs jumelles. Ceux qui y voient des différences imaginent donc que Ruth Elkrief et Laurence Ferrari pensent. Fichtre !
(2)Radicalisation, en effet, parce que le sieur Boubakeur est fort silencieux quand il s'agit de défendre les chrétiens d'orient, et plus encore les chrétiens d'Algérie, lesquels sont persécutés au milieu d'un silence condamnable.
(3)Il dirige Libération. Que dire de plus ?