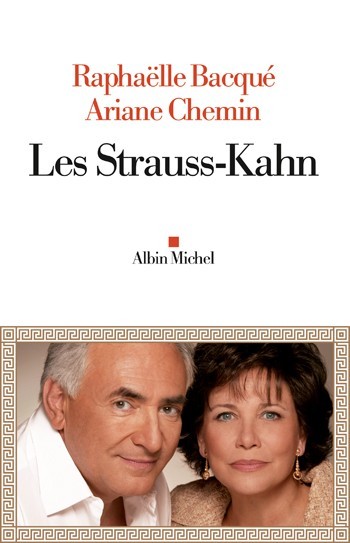Au jeu idiot des œuvres que l'on voudrait emporter sur une île déserte, outre le nu magnifique de Boubat, il y aurait aussi celle qui suit, de l'immense Lewis Baltz, disparu en novembre dernier.

Construction Detail, East Wall, Xerox, 1821 Dyer Road, Santa Ana (1974), from “The new Industrial Parks near Irvine, California."
En 1974, le photographe américain, figure majeure du mouvement New Topographics, vient explorer avec son objectif une zone industrielle californienne et, plutôt que de sonder, à la manière des Becher, dont il est proche, l'architecture complexe des espaces, il s'attache justement à ce qui, à première vue (1), n'accroche pas : les surfaces, les panneaux, la raideur métallique, l'étendue uniforme. C'est un peu comme s'il voulait abandonner le pittoresque en ce qu'il suppose une aspérité, un défaut, une variation pour l'intransigeante inquiétude de ce qu'on ne regarde jamais vraiment, puisque c'est toujours la même chose, sans relief.
Le livre publié par Baltz est une des plus grandes merveilles qu'il soit donné de voir (2). Il y dévoile une intransigeance formelle fascinante. Alors que tant de clichés cherchent à faire entrer le bruit et l'agitation comme signe de la modernité ambiante, le photographe américain en creuse la singularité à travers le silence induit par la froideur des matières et des textures, comme le montrent assez clairement, je pense, les deux exemples suivants.


Mais, paradoxalement, l'œuvre la plus singulière de ce projet touche à la construction du mur est de Xerox. Les murs sont encore entre l'enduit et la peinture, une peinture qui semble avoir été étalée de manière anarchique. Les teintes ne sont pas unies. Outre ce désordre des surfaces et des chromatismes, on trouve un certain nombre d'éléments disparates : une porte, une échelle métallique, des bouts de bois, des parpaings. S'ajoute une avancée architecturale dont on détermine mal encore l'utilité. Il n'y a donc rien de bien extraordinaire. Ce n'est pas le sujet qui en impose mais son traitement. Le choix d'une posture frontale, avec une certaine distance qui aplatit la profondeur et use de la bordure noire inférieure pour, en quelque sorte, encadrer l'ensemble, tout cela donne à cette photo une allure de tableau, comme si ce qui avait pris par la lumière n'était en fait qu'une construction picturale. C'est en cela que je trouve ce cliché admirable. Il explore d'une manière tout à fait insolite la fameuse opposition entre la photo et la peinture. Non pas selon le mode ancien des pictorialistes de la fin du XIXe siècle, en essayant de "rattraper" le trop de vérité de la photo par un trucage tirant l'œuvre vers le tableau, mais en réussissant à composer un espace réel, avec son inévitable profondeur en une surface à deux plans, ce qui définit, selon Clement Greenberg, le modernisme en peinture...
Dans cette photo convergent, d'une part, l'écrasement des volumes et la quasi neutralisation des objets en formes filant vers l'abstraction idéale (comme s'ils étaient "décharnés"), dans le sens où ils ne sont plus des fonctionnalités mais des expériences plastiques, et, d'autre part, la métamorphose du fond, du mur, en une toile imaginaire. Le travail inachevé, dans la réalité, devient une expérience abstraite. Laquelle expérience rappelle étrangement les peintures de l'expressionnisme abstrait américain, de Rauschenberg à Johns, en passant par de Kooning. Cet écho n'a rien de surprenant quand on sait que la première exposition de Baltz en 1971 est assurée par Leo Castelli, le même Castelli qui lança par la grâce d'un hasard à peine croyable, Jasper Johns en 1958.
Ainsi, dans cette œuvre, le photographe ne singe pas, ne rattrape pas l'art pictural. Il ne trafique pas. Il prend le réel, dans toute sa brutalité et son inachèvement, le monde en chantier, pour le sublimer par la seule réflexion (au double sens du terme) de la distance à prendre face à lui. Plus que la technique, et Baltz n'en manque pas, c'est l'œil de l'artiste qui sidère. la grandeur d'un art tient certes à l'inattendu qui le sous-tend, mais plus encore à un inattendu ne procédant pas (ou le moins possible) d'une posture esthétique flagrante. La frontalité de la prise n'est pas pour rien dans la magie de ce cliché. Le point de vue cherche tellement l'impression de la neutralité qu'on est dérouté devant ce dépouillement, comme si l'objet photographique (l'instrument, l'appareil) s'absentait et qu'à la place notre regard se trouvait contrait de regarder ce qu'il ne peut pas voir. Non pas un art en soi, donné ou voulu comme tel (3), mais une construction qui détourne la banalité en tableau, l'inertie en drame (au sens grec de drama, une action). Cette confusion multiple (de la réalité à l'artistique, de l'inachevé en achevé -puisque l'œuvre est achevée, du désordre à l'ordonnancement, du tridimensionnel au bi-dimensionnel), tout photographe, je crois, aimerait un jour la rencontrer. Il ne s'agirait de copier Baltz. Plutôt d'être soi-même pris au piège de son illusion...
(1)Mais la photographie n'est pas la vue. Elle est une vue, une certaine vue. Une vue de la vue. Il y a toujours une distance supplémentaire puisque, contrairement à notre œil mobile, le cadre est fixe. C'est un cadrage...
(2)Comme le sont, en faisant fi des questions de style, Paris la nuit de Brassaï, Americain Photographs de Walker Evans, Twentysix Gasoline Stations de Ed Ruscha ou Places d'Aaron Siskind...
(3)Pour faire simple : ce mur barbouillé n'est pas du street art. Voilà pourquoi il prend un sens bien supérieur.