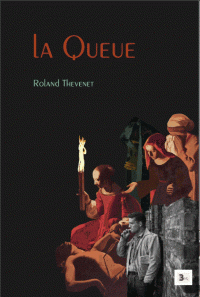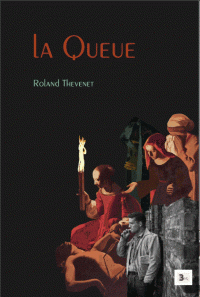
Ce qui intéresse dans un roman n'est pas forcément l'histoire. J'entends : cette forme molle que l'on peut résumer en une phrase et qui cache l'essentiel. Ainsi La Queue, écrit par Roland Thévenet, serait-il le récit d'une vie, celle d'un homme, Félix Sy, lequel, après « bien des chocs et d'imprévus désastres », trouvera une fort encombrante notoriété. La Queue tient à la fois du bildungsroman et de la fresque désespérée. L'air du temps n'est pas à la rigolade et ceux qui lisent régulièrement l'auteur sur son blog ne s'en étonneront pas.
Mais, dis-je, passons outre l'histoire même, sa linéarité vivante pour en venir à notre propre intérêt. C'est-à-dire ce qui nous a arrêté au delà de savoir si le Félix sus-nommé trouverait sa voie dans un monde si imparfait. De fait, c'est l'ombre de la satire qui plane sur le récit. Et doublement. On la repère aux coups de griffes récurrents d'un narrateur qui, parfois, ne sait pas tenir sa langue. Le désarroi, ou le dégoût, s'invite dans l'histoire et, d'une certaine manière, en justifie l'orientation. Il y a du procès dans l'air. Mais la réussite romanesque n'est pas là. Elle est dans un autre degré de la satire, dans la satura, soit : le mélange, cette hybride composition qui désarçonne le lecteur, parce qu'il ne sait pas vraiment sur quel pied danser. N'est-ce pas là, aussi, qu'est la misère de notre époque, dans cette mixture tragi-comique qu'on nous sert à grands renforts de bavasseries médiatiques ? C'est en nous interrogeant sur notre attente et notre capacité à prendre pour argent comptant ce qu'on nous dit que le roman de Roland Thévenet fait mouche.
L'histoire commence d'abord sur une enchère quasi mémorielle de l'invention par quoi le sieur Sy a fait fortune. Il a inventé la queue postiche, que l'on porte en toute occasion et avec tous les accoutrements possibles. Les pages initiales autour de cette incongruïté sont drôles, certes, parce qu'on est obligé d'imaginer le monde (celui des grands et des modestes) attifé de cet appendice grotesque. Nul n'y échappe : des politiques aux rock-stars, de l'excentrique au discret. Cet amusant délire, cet excès imaginaire se déploie avec une telle facilité qu'on finit par s'en faire une représentation assez simple et ce qui prenait d'abord une forme grotesque et quasi carnavalesque, l'auteur, par son insistance, en donne une version toute classique. Et de penser que nous aussi, nous avons nos queues, nos soumissions rances à l'effet de mode. Certes, le personnage habille, si j'ose dire, son invention d'un semblant de justification philosophique, mais nous savons bien, nous lecteurs, que, justement, tout cela est pure habillage. Dans le fond, cette queue supplétive, l'auteur la ramène à une terrible équivoque, qui mine l'époque contemporaine : celle du concept. La queue est un concept, c'est-à-dire une plaisanterie à but lucratif, dont la formulation vaut pour autant qu'elle rapporte et qu'elle devient un événement mondain. Ce début de roman, dont je disais qu'il m'avait fait rire, est aussi l'exposition grinçante d'un univers à la Kossuth et à tous ceux qui l'ont suivi. Le talent, le style importent peu. Ce qui compte tient à une évaluation indexée sur une mise aux enchères. La réussite est dans le gimmick. La manière se substitue au sens. Et ce d'autant plus que le facétieux écrivain a choisi d'emballer le tout (l'expression est un peu leste certes) en faisant de l'appendice caudal la cible de la réussite. L'art de la queue, si l'on veut. Ou, pour un second degré avec un demi-sourire, le vernis libidinal pour justifier de la moindre imposture. Le ludique et le libidinal, comme le disait déjà Michel Clouscard dans Le Capitalisme de la Séduction. Les incessantes anecdotes sur la queue de tel ou tel (mais écrivons plutôt : de tel ou telle, puisqu'à partir du moment où la queue paraît, il n'y a plus, dans ce roman, ni homme ni femme, mais des quasi porte-manteaux...) sont autant de preuves que ce jeu sur la liberté d'être se couvre d'un vernis provocateur : puisque le sexe est au centre de la trouvaille, ladite trouvaille est forcément signifiante. Les premières pages du roman sont donc la remarquable exposition d'une escroquerie comme il en existe tant désormais. Le trait est à peine forcé.
Dans l'histoire de Félix Sy, au milieu du roman, vient la rencontre majeure avec Jack Kerouac. Là encore, laissons l'intrigue de côté et regrettons seulement que cet épisode ne soit pas plus long, entre Paris et les States, mais ce n'est qu'un détail. Plus précieuse en revanche est la singularité donnée à cet homme dont on connaît le nom, dont on a lu le livre le plus connu, à défaut d'être le plus emblématique. On the road. Kerouac est l'exemple-type de la construction sauvage autour des mythes du voyage, de la rupture, de la marginalité. Le rebelle. Un Rimbaud américain, pour adolescent soixante-huitard qui ne veut pas sortir de cet état prétentieux et ridicule. Mais Roland Thévenet, plus lecteur de Kerouac que les paradeurs libertaires qui l'ont récupéré, s'en va, lui, de l'autre côté du poster. Son Kerouac est à la fois humain et démystifié, habité d'une inquiétude spirituelle qu'aucun dévoiement artificiel ne peut assouvir. Il emmène Félix avec lui, soit. Ils font un bout de chemin ensemble, mais l'Américain n'est pas le triomphant pourfendeur de l'ordre établi, ce que serait plutôt, dans le roman, Grégory Corso. C'est la tourmente religieuse qui guette, le rapport au frère mort et à la mère. Roland Thévenet ne fabrique pas un nouveau Kerouac. Il l'éclaire d'une lumière que la bonne parole des révoltés bourgeois a voulu occulter. La Queue fait aussi son chemin dans les ornières d'une imagerie d'Épinal née dans les années soixante et quand on suit l'épisode unissant le prétendu clochard céleste et Félix deux routes progressivement se tracent : celle d'un déjà-connu (mais en fait : de la bouillie et de la nourriture intellectuelle pré-mâchée) et celle d'une découverte à laquelle seul un détour par toute la littérature de Kerouac peut donner consistance. Ce roman est donc aussi une belle exploration, par contrepoint, de la culture construite, imposée et fausse produite par ce gauchisme libertaire issu de l'après-guerre. En ramenant l'écrivain américain à une complexité sans réponse assurée, baignée de religiosité, Roland Thévenet nous demande de déconstruire la terreur intellectuelle dans laquelle a été plongée le dernièr demi-siècle. Et cette déconstruction-là n'a évidemment rien à voir avec le délitement interprétatif de Derrida et consorts. Il s'agit d'en revenir aux textes. Il n'est pas question de dire que le Kerouac de La Queue est le vrai Kerouac, le seul Kerouac ; il s'agit de comprendre qu'en matière de doxa culturelle il est indispensable de faire un retour sur le passé récent.
En repliant, en partie, l'odyssée de Kerouac du côté du spirituel religieux, et du catholicisme, le roman marque nettement la préoccupation de l'auteur devant un monde occultant son héritage chrétien. Or, et c'est le troisième point qui nous arrête, l'histoire de Félix Sy est frappée du signe de la religiosité puisque, orphelin, il est recueilli et éduqué par un prêtre. La mort frappe et le bon Guillaume survient. Cette douceur, parfois maladroite, d'une soutane est déjà une erreur stratégique (si l'on veut considérer le point de vue purement commercial) : La Queue ne crache pas sur la prière et l'encensoir. C'est péché sans doute, quand la vulgate contemporaine voit en l'église catholique le comble du Mal, l'ennemi intime de l'ultra-liberté libérale. Mais c'est un trompe l'œil car, sur ce point également, le roman est bien plus retors qu'il n'y paraît. La quête finale de Félix Sy, à la fois incertaine et désespérée, nous éloigne de ce que certains assimileraient à un roman catholique. Certes, l'interrogation sur la transcendance traverse tout le récit mais il semble loin le temps confiant d'un Péguy ou d'un Bernanos. Le héros revient aux sources et cherche un refuge, jusqu'à sombrer dans une forme d'oubli de soi. Dès lors, plutôt que de lire La Queue sous le jour d'un hommage à la foi salvatrice, par quoi l'homme d'église, Guillaume, et son fils « adoptif » et spirituel, Félix, se retrouvent in fine, choisissons de l'envisager à rebours : une œuvre où l'espoir transcendant est comme décomposé. La fuite de Félix, riche, reconnu, adulé, n'est pas la énième forme de la rédemption (ce qui trouve plutôt dans les scenarii américains, chez les protestants) mais le récit de son impossibilité. Ainsi serait-il un contresens de trouver La Queue outrancièrement militant du côté du catholicisme alors même que la trame amène à cette impasse d'un monde qui ne peut plus recevoir la voix discordante de l'homme dont la réussite est exemplaire. On repense alors à la fin de La Crypte des capucins de Joseph Roth, quand le héros, perdu, se retrouve devant les grilles fermées du sanctuaire. Decize, Paris, les Etat-Unis, Bruxelles et retour à Decize. Mais trop tard. Toujours trop tard. Et lorsque le livre s'achève, dans le silence et un certain effroi, on repense au début, à toute cette agitation autour du concept qui fit la fortune de Félix Sy. Le bruit y était fort, infernal, et le bruit emporte le silence, la mondanité la solitude, les pièces de collection l'intériorité d'un homme...