Ce que le présent essaie d'effacer : la spiritualité, l'histoire, le religieux, la langue, l'intériorisation pour être au monde, une part de silence et de solitude, Fauré s'en saisit avec la poésie de Racine. L'extase est brève mais profonde.
catholicisme
-
Racine, Fauré et Dieu
-
Florilège hebdomadaire
Le roi de Macroncéphalie a expliqué aux Français qu'ils étaient en partie responsables des attentats qui ont atteint leur pays. "Le terreau sur lequel les terroristes ont réussi à nourrir la violence, à détourner quelques individus, c'est celui de la défiance". Voilà qui méritait d'être dit. Il est vrai que l'islamisme ne touche que le territoire hexagonal : Jemaah Islamiyah en Indonésie, Boko Haram au Nigéria, Les chebabs somaliens, les Talibans afghans, Al-Qaïda, Abou Sayyaf aux Philippines, et j'en passe, tout cela n'existe sans doute pas pour lui. À moins que les susdits Français ne soient eux-mêmes responsables de toutes les dérives de l'islam, ne serait-ce que parce qu'ils n'ont pas su l'empêcher...
Le roitelet de Bordeaux veut maintenant "écraser Daech". Il ne dirige rien, sinon sa mairie. Peu importe : il parle, il donne le cap, se place en sage et en responsable, oubliant seulement que tout ce qu'il dit depuis une semaine est à l'opposé de tout ce qu'il disait jusqu'alors. Il oublie seulement que pour sa redécouverte de Bachar Al-Assad, il a dû prendre des cours de géo-politique chez Marine Le Pen. Il ne chute pas de très haut, néanmoins, vu qu'il a toujours volé très bas (quand c'est Chirac qui fait de vous "le meilleur d'entre nous"...)
François Baroin, le Harry Potter de la politique, qui n'a pas réussi à finir premier ministre et s'est dès lors replié sur la suffisance double : municipale et sénatoriale, comme un Prudhomme weight watcher, dirige l'association des maires de France et décrète que l'urgence est à l'interdiction des crèches municipales, pour cause de laïcité, laquelle laïcité n'est que le cache-misère d'un anti-catholicisme maçonnique. Mais quand on se rappelle qui était son père dans la hiérarchie de la règle et du compas, on ne s'étonne pas. Ce triste sire ouvrait moins sa gueule quand la mairie de Paris fêtait la fin du ramadan. Je ne doute pas qu'il demandera l'intervention policière contre les résistants.
Le normal président, sérieux comme Forrest Gump, demande aux Français de hisser les couleurs nationales, ce vendredi, en hommage aux victimes. Rien de moins : le fossoyeur de la Nation, le collaborateur d'un coup d'Etat permanent, depuis le contournement du réferendum de 2005, vient donner aux citoyens des leçons d'humanité et de patriotisme. Ce drapeau qu'il a réussi à ridiculiser jusque dans la photo officielle qui trône dans les mairies (là où les crèches sont à proscrire...), il voudrait que les hommes et les femmes de ce pays s'en drapent pour qu'il puisse lui pavoiser sur la misère des victimes. Ce sera sans moi ; j'aime trop mon pays et comme disait de Gaulle : "je me suis toujours fait une certaine idée de la France".
On aura compris : si la violence et la terreur augmentent, la bêtise n'est pas en reste. Il va falloir que la résistance s'organise, et d'une manière autrement plus musclée dans les têtes. Si la France doit s'en sortir, c'est d'abord par une reprise en main de sa destinée, de son histoire, de son passé, de sa religion, de sa culture. Pour parodier Poutine, cela suppose qu'on poursuive la connerie jusque dans les chiottes. Peu ragoûtant mais nécessaire.
-
Dimanche...
Ce dimanche, j'irai à la paroisse de mon quartier, à la messe. Il ne peut en être autrement. Nonobstant la question de ma catholicité, j'irai en ce lieu pour la raison diamétralement opposée à ce qui m'a fait rester chez moi quand le pékin se rachetait une (bonne) conscience en bêlant avec Hollande et la clique : je suis Charlie. Parce que ce n'est pas un acte spectaculaire, parce que ce n'est pas la promenade du dimanche, parce qu'il n'y a pas de selfie à la clé, parce que j'y serai à la fois seul et en communion.
Il est philistin de vouloir déconnecter (pour parler dans le vent) la tentative avortée contre deux églises de Villejuif et la croisade lancée par Daesh contre les chrétiens d'Orient. C'est le même souci d'extermination : on appelle cela la guerre. Et plutôt que de ne rien faire et de se lamenter, entrer dans une église ne sera rien d'autre que de reprendre la filiation d'une culture chrétienne qui a fait, n'en déplaise aux islamo-gauchistes (1), le paysage et l'âme de l'Europe occidentale. Ce sera condenser en un acte politique et de civilisation la profondeur intime que j'ai trouvé depuis toujours dans la grandeur inachevée de Beauvais ou de Sienne, dans la modestie de Valcabrère ou de Planès, dans la sévérité douce de Conques ou de Vézelay, dans l'émerveillement des Scrovegni ou de la chapelle Contarelli. Encore faudrait-il parler de la peinture (de Giotto au Caravage...) ou de la littérature (Chateaubriand, Bloy, Claudel, évidemment...)...
Un certain cynisme politique effleure l'esprit, se disant que l'attentat mené à son terme, des morts dans un lieu de prière, tout cela eût permis de se compter et de laisser tomber les masques. Mais il y a déjà une morte et cela suffit. La barbarie qui veut s'installer parmi nous n'a pas besoin de démonstration superflue. C'est la conscience de ce qui se trame qui doit prévaloir.
J'irai à l'église dimanche, en pensant à Proust et à Barrès, s'alarmant l'un et l'autre du délabrement de l'héritage. Mais cette complainte est bien lointaine car aujourd'hui la question n'est plus de sauver les pierres mais de sauver ce qui fait notre sel, notre pensée, notre liberté et notre âme. Et c'est bien de cette grandeur-là que veulent éradiquer les islamistes qui posent des bombes, tirent dans une salle de rédaction ici, massacrent, égorgent, exterminent là-bas...
(1)Lesquels se trouvent aussi à droite, si on lorgne vers Juppé, pour qui le bon peuple de gauche, républicain et servile, votera dans deux ans, au second tour de la présidentielle...
-
La Queue, Roland Thévenet
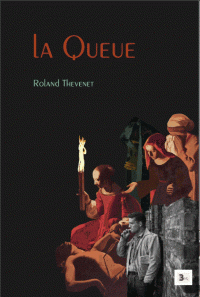
Ce qui intéresse dans un roman n'est pas forcément l'histoire. J'entends : cette forme molle que l'on peut résumer en une phrase et qui cache l'essentiel. Ainsi La Queue, écrit par Roland Thévenet, serait-il le récit d'une vie, celle d'un homme, Félix Sy, lequel, après « bien des chocs et d'imprévus désastres », trouvera une fort encombrante notoriété. La Queue tient à la fois du bildungsroman et de la fresque désespérée. L'air du temps n'est pas à la rigolade et ceux qui lisent régulièrement l'auteur sur son blog ne s'en étonneront pas.
Mais, dis-je, passons outre l'histoire même, sa linéarité vivante pour en venir à notre propre intérêt. C'est-à-dire ce qui nous a arrêté au delà de savoir si le Félix sus-nommé trouverait sa voie dans un monde si imparfait. De fait, c'est l'ombre de la satire qui plane sur le récit. Et doublement. On la repère aux coups de griffes récurrents d'un narrateur qui, parfois, ne sait pas tenir sa langue. Le désarroi, ou le dégoût, s'invite dans l'histoire et, d'une certaine manière, en justifie l'orientation. Il y a du procès dans l'air. Mais la réussite romanesque n'est pas là. Elle est dans un autre degré de la satire, dans la satura, soit : le mélange, cette hybride composition qui désarçonne le lecteur, parce qu'il ne sait pas vraiment sur quel pied danser. N'est-ce pas là, aussi, qu'est la misère de notre époque, dans cette mixture tragi-comique qu'on nous sert à grands renforts de bavasseries médiatiques ? C'est en nous interrogeant sur notre attente et notre capacité à prendre pour argent comptant ce qu'on nous dit que le roman de Roland Thévenet fait mouche.
L'histoire commence d'abord sur une enchère quasi mémorielle de l'invention par quoi le sieur Sy a fait fortune. Il a inventé la queue postiche, que l'on porte en toute occasion et avec tous les accoutrements possibles. Les pages initiales autour de cette incongruïté sont drôles, certes, parce qu'on est obligé d'imaginer le monde (celui des grands et des modestes) attifé de cet appendice grotesque. Nul n'y échappe : des politiques aux rock-stars, de l'excentrique au discret. Cet amusant délire, cet excès imaginaire se déploie avec une telle facilité qu'on finit par s'en faire une représentation assez simple et ce qui prenait d'abord une forme grotesque et quasi carnavalesque, l'auteur, par son insistance, en donne une version toute classique. Et de penser que nous aussi, nous avons nos queues, nos soumissions rances à l'effet de mode. Certes, le personnage habille, si j'ose dire, son invention d'un semblant de justification philosophique, mais nous savons bien, nous lecteurs, que, justement, tout cela est pure habillage. Dans le fond, cette queue supplétive, l'auteur la ramène à une terrible équivoque, qui mine l'époque contemporaine : celle du concept. La queue est un concept, c'est-à-dire une plaisanterie à but lucratif, dont la formulation vaut pour autant qu'elle rapporte et qu'elle devient un événement mondain. Ce début de roman, dont je disais qu'il m'avait fait rire, est aussi l'exposition grinçante d'un univers à la Kossuth et à tous ceux qui l'ont suivi. Le talent, le style importent peu. Ce qui compte tient à une évaluation indexée sur une mise aux enchères. La réussite est dans le gimmick. La manière se substitue au sens. Et ce d'autant plus que le facétieux écrivain a choisi d'emballer le tout (l'expression est un peu leste certes) en faisant de l'appendice caudal la cible de la réussite. L'art de la queue, si l'on veut. Ou, pour un second degré avec un demi-sourire, le vernis libidinal pour justifier de la moindre imposture. Le ludique et le libidinal, comme le disait déjà Michel Clouscard dans Le Capitalisme de la Séduction. Les incessantes anecdotes sur la queue de tel ou tel (mais écrivons plutôt : de tel ou telle, puisqu'à partir du moment où la queue paraît, il n'y a plus, dans ce roman, ni homme ni femme, mais des quasi porte-manteaux...) sont autant de preuves que ce jeu sur la liberté d'être se couvre d'un vernis provocateur : puisque le sexe est au centre de la trouvaille, ladite trouvaille est forcément signifiante. Les premières pages du roman sont donc la remarquable exposition d'une escroquerie comme il en existe tant désormais. Le trait est à peine forcé.
Dans l'histoire de Félix Sy, au milieu du roman, vient la rencontre majeure avec Jack Kerouac. Là encore, laissons l'intrigue de côté et regrettons seulement que cet épisode ne soit pas plus long, entre Paris et les States, mais ce n'est qu'un détail. Plus précieuse en revanche est la singularité donnée à cet homme dont on connaît le nom, dont on a lu le livre le plus connu, à défaut d'être le plus emblématique. On the road. Kerouac est l'exemple-type de la construction sauvage autour des mythes du voyage, de la rupture, de la marginalité. Le rebelle. Un Rimbaud américain, pour adolescent soixante-huitard qui ne veut pas sortir de cet état prétentieux et ridicule. Mais Roland Thévenet, plus lecteur de Kerouac que les paradeurs libertaires qui l'ont récupéré, s'en va, lui, de l'autre côté du poster. Son Kerouac est à la fois humain et démystifié, habité d'une inquiétude spirituelle qu'aucun dévoiement artificiel ne peut assouvir. Il emmène Félix avec lui, soit. Ils font un bout de chemin ensemble, mais l'Américain n'est pas le triomphant pourfendeur de l'ordre établi, ce que serait plutôt, dans le roman, Grégory Corso. C'est la tourmente religieuse qui guette, le rapport au frère mort et à la mère. Roland Thévenet ne fabrique pas un nouveau Kerouac. Il l'éclaire d'une lumière que la bonne parole des révoltés bourgeois a voulu occulter. La Queue fait aussi son chemin dans les ornières d'une imagerie d'Épinal née dans les années soixante et quand on suit l'épisode unissant le prétendu clochard céleste et Félix deux routes progressivement se tracent : celle d'un déjà-connu (mais en fait : de la bouillie et de la nourriture intellectuelle pré-mâchée) et celle d'une découverte à laquelle seul un détour par toute la littérature de Kerouac peut donner consistance. Ce roman est donc aussi une belle exploration, par contrepoint, de la culture construite, imposée et fausse produite par ce gauchisme libertaire issu de l'après-guerre. En ramenant l'écrivain américain à une complexité sans réponse assurée, baignée de religiosité, Roland Thévenet nous demande de déconstruire la terreur intellectuelle dans laquelle a été plongée le dernièr demi-siècle. Et cette déconstruction-là n'a évidemment rien à voir avec le délitement interprétatif de Derrida et consorts. Il s'agit d'en revenir aux textes. Il n'est pas question de dire que le Kerouac de La Queue est le vrai Kerouac, le seul Kerouac ; il s'agit de comprendre qu'en matière de doxa culturelle il est indispensable de faire un retour sur le passé récent.
En repliant, en partie, l'odyssée de Kerouac du côté du spirituel religieux, et du catholicisme, le roman marque nettement la préoccupation de l'auteur devant un monde occultant son héritage chrétien. Or, et c'est le troisième point qui nous arrête, l'histoire de Félix Sy est frappée du signe de la religiosité puisque, orphelin, il est recueilli et éduqué par un prêtre. La mort frappe et le bon Guillaume survient. Cette douceur, parfois maladroite, d'une soutane est déjà une erreur stratégique (si l'on veut considérer le point de vue purement commercial) : La Queue ne crache pas sur la prière et l'encensoir. C'est péché sans doute, quand la vulgate contemporaine voit en l'église catholique le comble du Mal, l'ennemi intime de l'ultra-liberté libérale. Mais c'est un trompe l'œil car, sur ce point également, le roman est bien plus retors qu'il n'y paraît. La quête finale de Félix Sy, à la fois incertaine et désespérée, nous éloigne de ce que certains assimileraient à un roman catholique. Certes, l'interrogation sur la transcendance traverse tout le récit mais il semble loin le temps confiant d'un Péguy ou d'un Bernanos. Le héros revient aux sources et cherche un refuge, jusqu'à sombrer dans une forme d'oubli de soi. Dès lors, plutôt que de lire La Queue sous le jour d'un hommage à la foi salvatrice, par quoi l'homme d'église, Guillaume, et son fils « adoptif » et spirituel, Félix, se retrouvent in fine, choisissons de l'envisager à rebours : une œuvre où l'espoir transcendant est comme décomposé. La fuite de Félix, riche, reconnu, adulé, n'est pas la énième forme de la rédemption (ce qui trouve plutôt dans les scenarii américains, chez les protestants) mais le récit de son impossibilité. Ainsi serait-il un contresens de trouver La Queue outrancièrement militant du côté du catholicisme alors même que la trame amène à cette impasse d'un monde qui ne peut plus recevoir la voix discordante de l'homme dont la réussite est exemplaire. On repense alors à la fin de La Crypte des capucins de Joseph Roth, quand le héros, perdu, se retrouve devant les grilles fermées du sanctuaire. Decize, Paris, les Etat-Unis, Bruxelles et retour à Decize. Mais trop tard. Toujours trop tard. Et lorsque le livre s'achève, dans le silence et un certain effroi, on repense au début, à toute cette agitation autour du concept qui fit la fortune de Félix Sy. Le bruit y était fort, infernal, et le bruit emporte le silence, la mondanité la solitude, les pièces de collection l'intériorité d'un homme...
-
Rome, au crépuscule
C'est après être passé chez Roscioli, pour un si tendre apfelstrudel, qu'il s'est mis à chercher quelque terrasse où il pourrait boire une Theresianer, que l'on fabrique non loin de Trieste, depuis 1766. Ainsi, en un temps très court, le voici remonté dans le nord de l'Italie, dans cet autre monde qui fut si longtemps dans le cercle de l'empire des Habsbourg, cette Italie matinée du double élan impulsé par le Saint Empire Germanique puis l'empire austro-hongrois.
Les gens filent devant lui, dans tous les sens, les uns vaquant à leurs occupations, les autres furetant le monument inoubliable. Son verre se vide doucement et il rêve à ces mondes finis, pourtant si grands qu'on ne les eût, sans doute, jamais imaginés comme des ombres, réduits qu'ils sont à des vestiges ou à des demeures énervées. Les temps ne sont pourtant pas si lointains où la politique pouvait encore se penser dans le Mitteleuropa. Il n'a plus à sa disposition qu'une rêverie en sucre (comme de goûter un Esterhazy dans une bonbonnière de Salzbourg) et le goût piquant d'une fermentation.
Il n'y a rien de hasardeux à ramener sur cette place discrète et romaine les fantômes de Vienne et Ratisbonne. Il s'est, la matinée durant, perdu dans les pierres folles et démembrées du Forum. L'infini empire, encore un..., de Trajan n'est plus qu'un bassin ridicule, dont la beauté est factice, dont le désastre ne se verra jamais aussi bien qu'en allant sur la Roche Tarpéienne, quand des fourmis bariolés tentent, sous le soleil, de donner du sens au passé. Vaste soupir des choses, désagrégation de la pensée. Rien ne tient, rien n'est intangible et la Fortune est amère.
L'affaire n'est donc pas nouvelle et son verre est achevé. Les troupeaux passent et repassent. Il est cinq heures. Ils viennent de tous les coins du monde et l'Europe se meurt. L'histoire n'est plus qu'un bavardage de guides, la pensée une affaire de statues aux noms inconnus.
L'Europe, celle qui, justement, remonte si loin, s'est formée de toutes les concrétions historiques et religieuses, se décompose. Elle n'est même plus une appellation proprement géographique ; elle n'est plus qu'une zone. Une zone de libre-échange, un carrefour circulatoire. Elle est une étiquette sur un cadavre, elle est atteint d'un mal mortel : la haine de soi. Cet effondrement, c'est à Rome qu'on la sent comme jamais.
Quand les alentours de la piazza di Spagna ne sont plus que des allées marchandes internationales, ceux de la piazzale Vittorio Emmanuelle une suite d'enseignes asiatiques (jusqu'à la pharmacie) ; qu'au même endroit le trottoir est consacré aux prières de rue, la tête tournée vers La Mecque ; que le flot imbécile des errants touristiques ne tarit pas où q'u'on aille, ou presque, alors lui revient cette phrase de Chateaubriand, écrite en 1838, désolé de voir "la Rome chrétienne (qui) redescend peu à peu dans ses catacombes."
Mais ce n'est plus seulement de Rome qu'il s'agit. La Ville, qui n'a plus rien d'Éternelle, nous tend un miroir cruel...
Photo : Philippe Nauher
-
Le courage catholique

Monseigneur André Vingt-Trois, évêque de Paris, dans son discours d'ouverture à l'assemblée des évêques, a rappelé son opposition au mariage homosexuel, que l'actuel gouvernement veut instituer. Il reprend la ligne que Monseigneur Barbarin, primat des Gaules, avait déjà définie.
Il faut être d'une inculture sidérante pour s'étonner que la hiérarchie catholique soit réticente devant un tel projet. Celle-ci peut-elle, en toute bonne foi, et selon un principe pluriséculaire, en héritage d'ailleurs d'une tradition antérieure à l'établissement du christianisme et de la chrétienté, rappeler autre chose que cette évidence : le mariage consacre une union hétérosexuelle ? Évidemment non. Faire le procès de cette position en établissant directement, comme le font les progressistes patentés de la gauche (mais on sait ici ce que je pense de l'invocation du progrès en matière politique), qu'il s'agit là d'une attitude homophobe relève du procès en sorcellerie, d'une pratique stalinienne courante. L'acharnement de ces trente dernières années contre le catholicisme est à ce point constant qu'il en est caricatural. Mais il fallait bien que les promoteurs des gender studies, des cultural studies et autres supercheries où tout se mesure à l'aune d'un discours minoritaire creux (1) établissent la hiérarchie des peines, des manquements et des responsabilités. En braves soldats de la doctrine foucaldienne, ils ont désigné le principal acteur de leur misère : l'église catholique et son cortège inquisiteur. En ce cas-là, spécifiquement, l'histoire est utile. Elle sert les intérêts du requérant. L'homosexuel, qu'on n'appelait pas encore gay, mais sodomite, inverti, pédéraste, a payé au tribunal de Dieu ses pratiques. Contester ce point serait complètement idiot. Mais se focaliser sur ce seul élément historique, je veux dire : sur ce seul axe de l'Histoire, est un peu court. Les délires médicaux sur l'anormalité des homosexuels n'avaient pas besoin de l'Église. Les aspirations positivistes et le goût des classifications suffisaient.
Qu'il y ait, dans l'épiscopat, une certaine hypocrisie vis-à-vis de l'homosexualité, comme de la sexualité en général, n'est pas douteux. Mais, en l'espèce, il ne s'agit pas tant de cela que de définir l'ordre de la relation au mariage, jusques et y compris, dans sa définition administrative. L'invocation du mariage pour tous (2) fait sourire, quand l'institution qu'il représente se détermine d'abord dans une perspecive familiale et de protection de la progéniture (et les homosexuels ne peuvent pas avoir d'enfant, c'est un fait). Sur ce point, il aurait déjà fallu que les progressistes analysent de quoi étaient faits les textes du Code Civil. Les évêques ne vont même pas aussi loin dans la critique, et c'est un grand tort. Ils s'en tiennent à la seule contestation (très rétrograde, non?) de la famille, avec un père et une mère...
C'est pour cela qu'on leur tombe dessus à bras raccourcis. Encore ont-ils, eux, le courage d'afficher leur position ! Car, l'une des plus remarquables abérations du moment, c'est le silence des autres confessions monothéismes, lesquelles ne peuvent, sur ce point, qu'être en accord avec les catholiques. Faut-il, en effet, penser que le silence du Consistoire juif, du CFCM et des autorités protestantes a valeur de consentement ? Il est bien curieux que ces institutions, si chatouilleuses sur leurs prérogatives, si regardantes sur les pratiques que l'on encadre quand elles entachent l'espace public d'une expression ostentatoire de l'appartenance religieuse, il est bien curieux que, sur ce point, elles se taisent toutes. Bizarre, vraiment, que les intégristes de ce coin-là, qui ne manquent jamais de rappeler ce que Dieu, ses prophètes et ses commenteurs ont dit, écrit, prescrit, ne viennent sur le devant de la scène nous avertir qu'il y a là une loi scélérate, indigne et tout à fait contraire aux préceptes religieux. On devrait leur savoir gré d'avoir ainsi modéré, voire changé, leur position. Il est évident qu'il n'en est rien. C'est d'ailleurs, par exemple, parce que le rejet massif de l'homosexualité par les jeunes maghrébins est un fait que certains s'inquiètent du glissement nationaliste, voire d'extrême-droite, d'une frange de la communauté gay.
De fait, il est bien agréable, et facile, de voir la hiérarchie catholique monter en première ligne et de faire que les éternels geignards du minoritaire (en particulier ceux qui voient de l'islamophobie partout : CFCM en tête) puissent se taire sans montrer qu'à leur tour ils pourraient désigner d'autres minoritaires. Le choix catholique a au moins le mérite de la clarté et de l'honnêteté. Il se définit dans la plénitude d'une position affichée qui n'exclut en rien le dialogue avec les homosexuels. La question du mariage est épineuse mais, au moins, devant une loi qui lui semble contestable et dangereuse, monseigneur André Vingt-Trois ne fait pas semblant. Il ne cherche pas à s'attirer les bonnes grâces de la doxa ambiante ; il ne cherche pas à feindre et à tromper ; il ne se cache pas. Il choisit le choc frontal. Sans doute parce que la position qu'il défend est plus importante que l'estime temporaire d'une médiatisation qui voudrait à tout prix la modernité. Il est seul à prendre cette voie, au risque d'enfoncer un peu plus l'Église catholique dans la crise, au risque de donner du grain à moudre à ceux qui voient en lui l'incarnation du mal.
Ces derniers font un calcul petit, minable et dangereux. Trop contents d'avoir l'adversaire qu'ils s'étaient choisis depuis longtemps, et lui seul, car les autres sont tapis dans l'ombre, ils pavanent. Ils seront heureux de brandir la loi, une fois qu'elle sera votée, heureux et heureuses de pouvoir être comme tout le monde, marié(e)s, et d'avoir, dans les grandes largeurs, niqué les cathos... Ils se trompent, et lourdement...
(1)Creux, quoique assez efficace, si l'on en juge par certaines évolutions visibles dans les institutions. Il est dès endroit, aujourd'hui, où le minoritaire est un universitaire hétérosexuel. La cooptation existe aussi chez ceux qui hurlent à la ségrégation. La revendication homosexuelle est aussi une réalité et il est des milieux où elle forme un rempart entre les admis et les refusés. C'est un fait. Le dire n'induit en aucune façon que l'on soit homophobe. Encore faut-il alors souligner que, dans le monde homosexuel aussi, il existe des différences de classes : l'homosexuel du Marais peut vivre, assumer, revendiquer, voire exclure, quand celui de la banlieue de Seine-Saint-Denis est obligé de se cacher, de prendre ses choix comme une tare, et de se taire. On aimerait qu'il eût un peu plus de solidarité sur ce plan. Or, ce n'est pas avec un Gay Pride à l'esprit petit bourgeois qu'on a des chances d'y arriver.
En vertu de ce principe, d'ailleurs, Anne Lafetter dans Les Inrocks écrit, le 17/01/2012, au sujet du livre publié par l'ancien président d'Act-Up, Didier Lestrade :
«Un hétéro n’aurait pas pu écrire Pourquoi les gays sont passés à droite. Discriminatoire aurait-on dit, voire homophobe.» Un tel aveu est consternant, et doublement : a)il fait le constat d'un état de terreur dans le droit de penser b)il marque l'approbation par celui qui fait ce constat de cet état de terreur du bien fondé de cet état. La boucle est bouclée. Comme quoi il est toujours intéressant de fouiller les poubelles de ceux que l'on combat...
(2)La formule a des airs de slogan publicitaire. Le mariage pour tous, c'est plus facile, quand on sombre, comme les socialistes, dans le libéralisme intégral, que la dignité pour chacun, un toit pour chacun, un travail pour chacun. Privilégier le pluriel devant le singulier est un moyen rhétorique classique pour cacher la misère de sa pensée et pour placer celui qui conteste en position de méchant réactionnaire bridant les aspirations et l'épanouissement des citoyens...
Photo : Reuters
-
Florence, boutiquière...

Giotto, Enterrement de Saint-François, Chapelle Bardi, Santa Croce, Florence, 1320-1325.
Il fut un temps où, aux étudiants à peine argentés, plus d'un quart de siècle déjà, Florence offrait sa part de désintéressement qui présiderait, dit-on, au bonheur de l'art. La déambulation improvisée menant de palais en palais, de places en places, kaléidoscopie de façades majestueuses en témoignage d'un passé politique fastueux, cette déambulation dans la rigueur d'un pouvoir conscient de lui-même comme il y en eut peu, tirait sa puissance du bonheur qui attendait les rêveurs des merveilles cachées derrière les portes des édifices. L'éclat de la place Santa Croce, accompli dans le marbre tricolore de l'église et le salut respectueux au visage sévère du Dante, était une première joie que l'entrée dans le petit Panthéon florentin (Michel-Ange, Machiavel, Rossini, Galilée ou Vasari y reposent) multipliait d'un mystérieux besoin de se taire, et d'écouter les œuvres, le prestige de la ville. L'envers de l'histoire. Non pas l'envers, sa continuation.
Le bonheur pouvait ainsi se répéter au Duomo, à Santa Maria Novella, à San Lorenzo, aux Ognissanti, à San Miniato, à Santa Maria del Carmine... : multiples stations de l'histoire florentin accédant à l'universalité, que nous pouvions faire nôtre sans autre devoir que la décence et la mesure de la solennité spirituelle qu'avaient pour certains ces lieux de culte. La moindre église italienne est à la fois une offrande à Dieu, à la peinture et à la sculpture. Florence le savait plus que quiconque.
Mais les temps ont changé et ceux qui, toujours modestes, sont venus jusque là, découvrent une ville convertie comme nulle autre, plus encore qu'au tourisme, lequel sévit depuis des décennies, à ce qu'il faut bien appeler l'économie artistique. On sait combien l'art a cédé à la logique du marché et aux considérations spéculatives. La gestion fort libérale du patrimoine, la place accrue des structures commerciales (1) ne sont pas des nouveautés. Ce qui l'est davantage réside dans le progressif glissement du monde religieux dans les techniques du mercantilisme le plus éhonté. On me rétorquera que l'affaire n'est pas nouvelle là encore : les pèlerinages en sont un flagrant exemple, et passer une fois à Lourdes vous guérit, si j'ose dire, de la tentation d'y remettre un jour les pieds. Soit, c'est là affaire de foi et cette question, dans ma position d'athée, ne m'intéresse guère. En revanche, ce que je vois à Florence m'irrite au plus haut point. Ainsi les églises de cette ville se sont-elles dotées de véritables péages, dont sont exempts les autochtones, et auxquels l'étranger doit se soumettre s'il veut admirer Giotto, Cimabue ou della Robbia. Encore pourrait-on admettre le procédé (2) si la somme exigée était symbolique, mais il n'en est rien. La catholicité (3) florentine voit le monde de haut. Elle a la condescendance des bien nourris. Elle a, en période estivale, car en hiver la libre circulation de l'intrus et de l'esthète reprend ses droits, des allures de maquerelle ou de mafieux : c'est le pizzo ecclésiastique (4).
Une telle pratique heurte à plus d'un titre. Celui qui eut le droit au temps béni d'une contemplation sereine (parce que plus que la gratuité, il se souvient de n'être pas entré dans une église comme client) peut toujours vivre avec ses souvenirs, aussi imprécis soient-ils, et refuser le diktat. Sans doute n'est-ce pas d'ailleurs le choix dont il se sentira le moins heureux : il accepte les défauts de sa mémoire en compensation des impressions vives qui lui restent. Mais pour le néophyte désargenté, ayant rêvé d'une longue promenade en Renaissance et Baroque, le goût sera amer. Renouvelée à Pise et à Sienne, à San Gimignano, la confrontation avec les boutiquiers finira par lasser. L'injustice et le mépris dans l'endroit de la miséricorde ! Un comble. N'est-ce pas, d'ailleurs, évoquer une aberration plus magistrale encore, que de ne pouvoir prier son dieu parce que des marchands du temple en soutanes et cornettes y ont établi leur quartier d'été...
Si mon athéisme m'épargne ce désarroi, mon sens du sacré, fruit d'un long chemin entre les piliers romans, gothiques, classiques ou baroques exaltant une indéniable spiritualité, s'indigne que soit de fait trahi le droit à la Présence, que soit bafouée l'originalité d'une culture ayant à ce point exalté la puissance des images. L'exemple florentin est non seulement crapuleux ; il est funeste. Il marque, de la part des autorités de l'Église, une allégeance à l'ordre libéral, un renoncement à l'Histoire, une capitulation matérialiste. Dès lors, qu'elles ne s'étonnent pas du vide pendant les offices, des appréciations sévères à leur encontre. Et ce ne sont pas les happenings papaux aux JMJ qui peuvent sauver du déclin...
Florence est boutiquière et prétentieuse, jusque dans sa religiosité. Nefs et chapelles ne sont que des enseignes de plus. Les églises ont leurs saisons, basse, haute, c'est selon, et leur temps de soldes. Il n'y a rien à acheter. Tout est vendu, l'âme comprise. Inutile d'y revenir...
(1)Puisque l'on est à Florence, remarquons qu'au sortir de la Galerie des Offices, les nouveaux aménagements permettent de repartir avec des livres (normal), des posters (soit), mais aussi des friandises ou du vin toscans. Petit bonheur sans doute, mais d'une grand imbécillité, que de passer en quelques pas de Raphaël à l'épicerie, dans un même endroit.
(2)Évidemment, il n'en est rien. C'est ici affaire de principe
(3)Rappelons au passage que catholique signifie universel. On en est loin.
(4)Le pizzo est l'impôt mafieux. Sa pratique s'est d'abord développée en Sicile.
-
Jarry, écrivain cycliste

En ce jour de repos dominical, où il nous faut concilier le devoir sacré et matinal de la messe et l'excitation d'une étape du Giro s'achevant au Monte Zoncolan (aux pourcentages affolants), Jarry s'impose. Il est la parfaite illustration d'un esprit littéraire divinement sportif. Il nous reste d'ailleurs de lui la célèbre photographie que nous reproduisons (où on voit qu'élégance et activité sportive ne sont nullement incompatibles : le chapeau melon, s'il vous plaît, nous change des casques contemporains, ridicules, il faut le dire). Outre qu'il écrivit romans, poèmes et pièces de théâtre, Jarry eut une activité de journaliste dont on a gardé souvenir dans le volumineux recueil intitulé La Chandelle verte. Le texte qui suit fut écrit pour Le Canard sauvage, n° 4, du 11-17 avril 1903, soit trois mois avant que Maurice Garin ne gagnât, à la moyenne de 25,679 km/h, le premier Tour de France.
LA PASSION CONSIDÉRÉE COMME UNE COURSE DE CÔTE
Barabbas, engagé, déclara forfait.
Le starter Pilate, tirant son chronomètre à eau ou clepsydre, ce qui lui mouilla les mains, à moins qu'il n'eût simplement craché dedans - donna le départ.
Jésus démarra à toute allure.
En ce temps-là, l'usage était, selon le bon rédacteur sportif saint Mathieu, de flageller au départ les sprinters cyclistes, comme font nos cochers à leurs hippomoteurs. Le fouet est à la fois un stimulant et un massage hygiénique. Donc, Jésus, très en forme, démarra, mais l'accident de pneu arriva tout de suite. Un semis d'épines cribla tout le pourtour de sa roue avant.
On voit, de nos jours, la ressemblance exacte de cette véritable couronne d'épines aux devantures de fabricants de cycles, comme réclame à des pneus increvables. Celui de Jésus, un single-tube de piste ordinaire, ne l'était pas.
Les deux larrons, qui s'entendaient comme en foire, prirent de l'avance.
Il est faux qu'il y ait eu des clous. Les trois figurés dans des images sont le démonte-pneu dit une minute.
Mais il convient que nous relations préalablement les pelles. Et d'abord décrivons en quelques mots la machine.
Le cadre est d'invention relativement récente. C'est en 1890 que l'on vit les premières bicyclettes à cadre. Auparavant, le corps de la machine se composait de deux tubes brasés perpendiculairement l'un sur l'autre. C'est ce qu'on appelait la bicyclette à corps droit ou à croix. Donc Jésus, après l'accident de pneumatiques, monta la côte à pied, prenant sur son épaule son cadre ou si l'on veut sa croix.
Des gravures du temps reproduisent cette scène, d'après des photographies. Mais il semble que le sport du cycle, à la suite de l'accident bien connu qui termina si fâcheusement la course de la Passion et que rend d'actualité, presque à son anniversaire, l'accident similaire du comte Zborowski à la côte de la Turbie, il semble que ce sport fut interdit un certain temps, par arrêté préfectoral. Ce qui explique que les journaux illustrés, reproduisant la scène célèbre, figurèrent des bicyclettes plutôt fantaisistes. Ils confondirent la croix du corps de la machine avec cette autre croix, le guidon droit. Ils représentèrent Jésus les deux mains écartées sur son guidon, et notons à ce propos que Jésus cyclait couché sur le dos, ce qui avait pour but de diminuer la résistance de l'air.
Notons aussi que le cadre ou la croix de la machine, comme certaines jantes actuelles, était en bois.
D'aucuns ont insinué, à tort, que la machine de Jésus était une draisienne, instrument bien invraisemblable dans une course de côte, à la montée. D'après les vieux hagiographes cyclophiles sainte Brigitte, Grégoire de Tours et Irénée, la croix était munie d'un dispositif qu'ils appellent suppedaneum. Il n'est point nécessaire d'être grand clerc pour traduire : pédale.
Juste Lipse, Justin, Bosius et Erycius Puteanus décrivent un autre accessoire que l'on retrouve encore, rapporte, en 1634, Cornelius Curtius, dans des croix du Japon : une saillie de la croix ou du cadre, en bois ou en cuir, sur quoi le cycliste se met à cheval : manifestement sa selle.
Ces descriptions, d'ailleurs, ne sont pas plus infidèles que la définition que donnent aujourd'hui les Chinois de la bicyclette : "Petit mulet que l'on conduit par les oreilles et que l'on fait avancer en le bourrant de coups de pied."
Nous abrégerons le récit de la course elle-même, racontée tout au long dans des ouvrages spéciaux, et exposée par la sculpture et la peinture dans des monuments ad hoc :
Dans la côte assez dure du Golgotha, il y a quatorze virages. C'est au troisième que Jésus ramassa la première pelle. Sa mère, aux tribunes, s'alarma.
Le bon entraîneur Simon de Cyrène, de qui la fonction eût été, sans l'accident des épines, de le tirer et lui couper le vent, porta sa machine.
Jésus, quoique ne portant rien, transpira. Il n'est pas certain qu'une spectatrice lui essuya le visage, mais il est exact que la reporteresse Véronique, de son kodak, prit un instantané.
La seconde pelle eut lieu au septième virage, sur du pavé gras. Jésus dérapa pour la troisième fois, sur un rail, au onzième.
Les demi-mondaines d'Israël agitaient leurs mouchoirs au huitième.
Le déplorable accident que l'on sait se place au douzième virage. Jésus était à ce moment dead-head avec les deux larrons. On sait aussi qu'il continua la course en aviateur... mais ceci sort de notre sujet.
-
La force du détail


Le Caravage, La Madone des Pèlerins, 1604-1606, Basilique Sant'Agostino, Rome
Dans ce tableau, où se penche sur la dévotion misérable et sincère le plus beau visage jamais peint, il faut regarder les pieds des personnages. Ceux du paysan, crasseux et énormes, où Panofsky lit une «citation» de L'Agneau mystique de Van Eyck, nous pèsent. Ils sont au premier plan, alors que le corps s'incline d'une manière improbable. On remarque moins ceux de la Vierge, dans leur position dissymétrique. Ils sont fins, légers. Mais lorsqu'on les a fixés, et le gauche particulièrement, cambré comme pour un pas de danse (et la Vierge, brune et mate, prépare-t-elle le futur mythe de Salomé ou la figure d'Esméralda ?), ils deviennent l'énergie profonde du tableau. Comme Caravage est revenu depuis longtemps des strictes conventions de la peinture religieuse, il a placé la Madone un peu en hauteur, certes, mais sur une marche d'escalier, pas un trône, et ce pied qui danse immobile en finit, en quelque sorte, avec toutes les élucubrations assomptives. Sa légèreté signe aussi la place de Marie dans le monde, qui porte l'Enfant dans ses bras. Il n'est pas si éloigné de la semelle calleuse du pauvre qui la vénère ; il est juste plus beau et plus doux. C'est justement cette beauté-là qui nous tient en haleine, nous pétrifie dans l'église Sant' Agostino déserte (parce qu'il n'y a jamais personne pour venir la contempler, pour venir les comtempler) puisqu'elle doit une part de sa force à l'adoration simple et poussiéreuse, à ce visage, qu'on ne voit qu'à peine, illuminé de cette délicatesse si humaine qu'elle dégage, à ces pieds marqués du chemin parcouru dans la ferveur pour que la rencontre se fasse. Elle doit sa grandeur à ces différences (le sale-le propre, le lourd-le léger, l'humble-le précieux) réhaussées de ce détail, les pieds, qui, en même temps, les relie et les attache irréductiblement au sol, lui comme modeste adorateur, elle comme Mère vivante de toutes les mères à venir.
De lui à elle, une autre histoire que le simple texte biblique, histoire sublime et poignante, celle de l'art et sa capacité de transfiguration pour revenir vers nous. Voilà où est le miracle du Caravage.
