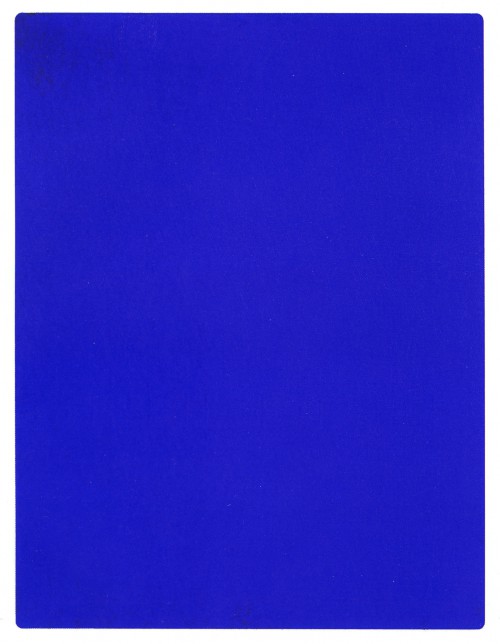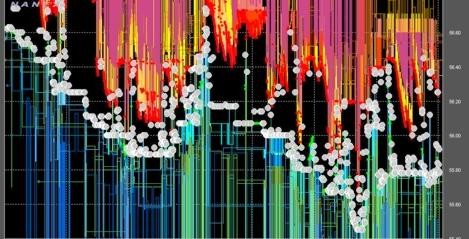Dans un texte écrit en 1733, une Lettre à un premier commis, lequel commis n'est pas un gratte-papier mais un important de ce qu'on ne peut pas encore appeler le corps des fonctionnaires, Voltaire énumère les raisons majeures qui doivent présider à la suppression de la censure pour les livres. C'est un texte que les voltairiens aiment à citer pour rappeler combien cet écrivain représente une figure éminente de la pensée libre et libérée. Ils y voient un esprit très français, une sorte de spiritualité toute hexagonale qui fonde, en partie, l'idée que les Lumières de ce pays forment le sommet de notre pensée. Référence discutable dont on peut ne pas se réclamer...
Ce texte, donc, contre la censure. Et parmi les objections, le passage qui suit :
"Les pensées des hommes sont devenues un objet important de commerce. Les libraires hollandais gagnent un million par an, parce que les Français ont eu de l'esprit. Un roman médiocre est, je le sais bien, parmi les livres, ce qu'est dans le monde un sot qui veut avoir de l'imagination. On s'en moque mais on le souffre. Ce roman fait vivre et l'auteur qui l'a composé, et le libraire qui le débite, et le fondeur, et l'imprimeur, et le papetier, et le relieur, et le colporteur, et le marchand de mauvais vin, à qui tous ceux-là portent leur argent. L'ouvrage amuse encore deux ou trois heures quelques femmes avec lesquelles il faut de la nouveauté en livres, comme en tout le reste. Ainsi, tout méprisable qu'il est, il a produit deux choses importantes : du profit et du plaisir."
Ce qui frappe aussitôt tient à l'abandon de toute considération proprement littéraire ou, nonobstant l'anachronisme du terme, culturelle. Ici, il est question d'affaires, de revenus, de commerce, d'économie pour le dire en simplifiant. C'est le Voltaire anglais qui transpire dans cette analyse, celui qui voit dans le libéralisme et les lois du commerce un moyen d'émancipation. À voir... Ne s'agit-il pas surtout de brasser de l'argent, de s'intégrer dans une logique de concurrence, de considérer les livres comme une marchandise qui "produit deux choses importantes : du profit et du plaisir". L'ordre n'est pas indifférent, je crois, surtout quand le plaisir fait écho à ces "deux ou trois heures" pendant lesquelles "l'ouvrage amuse (...) quelques femmes".
La littérature ainsi conçue n'a plus rien à voir avec les Belles Lettres. Elle n'a pas pour objet d'élever l'esprit mais d'entrer dans le cycle vertueux de la comptabilité et des échanges commerciaux. On est loin alors du commerce des esprits tel qu'on l'envisageait encore au XVIIe siècle et que des âmes nostalgiques évoqueront encore dans les temps suivants. Avec Voltaire, nous sommes pleinement dans l'esprit du XVIIIe, lequel fut moins spirituel (1) que sinistrement hanté par l'omnipotence de la raison, une raison qui n'avait plus rien à voir avec l'usage que voulait en faire, par exemple, un Descartes, dans l'équilibre qu'elle trouve avec le mystère de la foi. Avec Voltaire, on plonge dans l'ordre d'une rigueur utilitariste et mercantile : sa raison est, quand on y regarde bien, celle qui préside aujourd'hui à la grandeur du marché, à l'intelligence marketing, à la gouvernance indexée sur les équations économiques.
C'est cette raison-là que l'on nous vend depuis la Révolution et la propagande républicano-maçonnique en a fait une de ses œuvres majeures. Certainement, la libre expression, la fin de la censure sont de bien belles choses. Encore faudrait-il que ces dernières ne soient pas des leurres et que les étais culturels de notre histoire n'aient pas été à ce point minés, si l'on veut bien considérer en ce début de XXIe siècle l'extension phénoménale de la bêtise et de l'ignorance...
(1)Particulièrement en France où l'anti-cléricalisme trouva dans les horreurs révolutionnaires de quoi fonder un discours politique dont le bourgeon funeste est la laïcité actuelle, laquelle se prévaut d'une haine anti-chrétienne délirante et d'une collaboration avec l'islamisme radical.