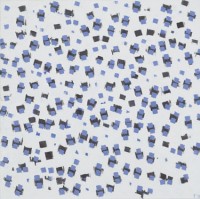Un jour je ne vis plus mes parents. Ils demeuraient sur le seuil de ma vie nouvelle et si, pour eux, je n'étais pas porté disparu, je n'étais plus qu'un enchevêtrement de souvenirs. Peut-être. Des photos, aussi, me dis-je un jour devant le déballage enfantin de deux amis qui croyaient qu'ainsi nous les connaîtrions mieux. Ils avaient le sourire béat des vies sans accrocs. Devant ces puzzles, j'éprouvai une gêne insidieuse. Je ne pensai pas un seul instant qu'ils aient eu le courage de tout jeter, mes parents.
Je retournai mon petit appartement dans l'espoir d'avoir sauvé d'un naufrage antérieur des clichés, parce qu'un jour je m'étais acharné à faire le vide, et la colère, comme on dit, est mauvaise conseillère. Et cet espoir, c'était déjà comme le désagrément d'un membre ankylosé, dont on craint toujours un instant qu'il soit plus durement touché.
Dans le fouillis de lettres maintenant inutiles, je retrouvai cinq photos : deux de ma mère, trois de mon père. Jamais les deux ensemble. Je ne sais si elles devaient au hasard d'avoir survécu, ou si j'avais fermé les yeux sur elles, par pudeur. Un oubli de sécurité, en quelque sorte. Deux d'entre elles remontaient à des temps incernables, sur des fonds si éteints qu'on avait du mal à préciser l'occasion qui les avait vu naître.
Une concernait ma mère ; une concernait mon père. Je les posai sur mon bureau presque aussitôt. Ils avaient encore les traits d'une trentaine posée. On sent que sur ces clichés, ils découvrent les joies d'être pris, par delà une occasion sérieuse. Les trois autres avaient pour moi une histoire plus conforme à mes désirs. Elles collent à mes propres souvenirs, à ce que je peux accrocher à mes pas, quand, dans la rue ou les jardins publics, leurs êtres bruissent auprès de moi.
Ma mère, assise dans un fauteuil de camping, regardait l'objectif par-dessus ses lunettes, avec le désir inaccessible pour elle d'être naturelle. Ses cheveux décolorés par la teinture, le soleil et la mer faisaient ressortir son bronzage et le prune de la robe à bretelles (je me souviens qu'elle est prune) noie le bas du tronc. Elle a le pincement aux lèvres que je lui ai toujours connu quand elle vient d'entendre quelque chose qui lui a déplu. Et cela peut tenir à des détails. Son monde est comme une chambre meublée de célibataire où tout doit être en ordre. Cela ne l'a pas empêché de faire des enfants. Mes deux sœurs lui ressemblent beaucoup. Nous nous en tenons à des coups de téléphone lointains.
Les lunettes de ma mère sont les dernières avec lesquelles je l'ai vue et qu'elle a eu tant de mal à accepter parce qu'elles étaient à double foyer. Ils habitaient encore le troisième étage et mon père l'entendit pendant des semaines qu'elle ne sortirait plus jamais, à cause des escaliers où elle tomberait sûrement. Elle a un verre à la main. Un vin blanc. Pineau des Charentes, Porto, Pacherenc peut-être. Je ne puis me déterminer. Je ne sais pas qui l'a prise ainsi, cette photo. Ce n'est pas moi. La mise au point n'est pas parfaite.
Mon père, lui, est dans l'entrée de l'auvent. Elle est de moi. Je n'ai pas de doute. J'ai choisi une diagonale en contre-plongée parce que sans doute je suis assis sur une chaise de camping. Dans le bas droit de la photo, son coude est en avant ; et à l'opposé, pointe la légère avancée de l'auvent. Cela le rend plus impressionnant. Il a encore la musculature de quelqu'un qui a eu un travail physique et son tee-shirt le serre au niveau du biceps. Sa peau raisonnablement ridée dégage la matité que je lui ai toujours enviée. Les cheveux que lui a laissés la calvitie de ses trente ans sont très courts, si courts qu'on distingue à peine qu'il a grisonné petit à petit. Je le sais. On ne peut pas lire autre chose qu'une certaine fierté dans ce regard qui me guette, dans cette pupille qui cherche le fond de l'objectif.
Sur le second cliché, il est de trois-quarts face, absorbé par son journal. C'est donc le matin, quand il revenait de sa promenade, vers la digue et qu'il nous disait à quelle heure, approximativement, la mer serait haute. Il doit réfléchir à ses mots croisés.
Durant les deux semaines qui suivirent, il n'y eut pas un soir sans ouvrir le livre où je les tenais serrées, comme on vérifie la dent de lait sous l'oreiller, encore et encore. On ne voudrait pas être oublié. Je ne rêvais pas de ce temps perdu avec lequel je ne renouerais jamais. Je suis imperméable à la nostalgie. Je n'aime que les histoires. Non, je les contemplais et toujours, au fond, je regagnais les mêmes zones, les mêmes chemins. La parentèle de leurs rides avec mon visage qui vieillit. Et il n'y a bien que dans les photographies où l'on rejoint ceux qui nous ont précédés, qu'on finit par leur ressembler, quels que soient les efforts mis à leur échapper.
Je montrai ces clichés (les trois qui me touchaient. Le reste était en pièces, trop révolu) à Marianne qui fit le tour de mon héritage, entre pommettes saillantes et maxillaire inférieur à coup de serpe.
Puis, un soir, je compris pourquoi je souffrais en regardant mon père. Surtout mon père. Il est dans l'entrée de l'auvent et son œil, dans lequel j'avais cru s'ouvrir le fruit de la complicité, est une coque vide et frileuse. Un naevus noir et un cercle plus clair. Quelle était la couleur des yeux de mon père ? Je voudrais me souvenir. Je vais y répondre. Je pense à Marianne qui pourrait me le demander si je lui remontrais les photos. Bien sûr, je peux mentir. Et d'abord à moi-même. Face à l'œil de mon père. Comme une ponctuation. Au centre, la bille rétractile avec laquelle joue la lumière et qu'on ne voit jamais tant elle s'accorde au reste du corps qui vous observe ou vous accueille. Ce n'était que maintenant, dans la posture rendue à l'éternité, que je la saisissais. Cette bille, me dis-je en riant d'amertume, est la chose la mieux partagée, la moins solitaire de nos possessions. J'allai chercher des photos de mes amis et aucun d'eux n'avait à cet endroit une identité. Restait l'iris. Cet anneau qui, chez moi, oscillant entre le bleu, le vert et le gris, selon les humeurs du temps, me sauve du dégoût de moi-même. On me dit que j'ai de beaux yeux. Je les devais à ma grand-mère, quoique les siens fussent, dans mes souvenirs (et il ne me reste rien d'autre d'elle), moins indécis. Bleus, pour tout dire. Je dirai que mon père avait les yeux clairs. Mais la clarté n'est pas une couleur. Juste un contraste, une simple marque sur une échelle de valeurs qui, dans une photo noir et blanc, surtout amateur, envisage un spectre étroit.
Nous étions-nous si peu contemplés pour que ma mémoire se soit à ce point soustraite d'un passé dont je croyais jusqu'alors qu'il partait en voyage avec nous et finissait dans la tombe, comme les armes des anciens guerriers ? J'étais sensible à ses mains, très larges, des doigts démesurés, et cet ongle du pouce qui manquait, arraché dans un accident du travail, sur une Heidelberg (ville allemande que j'ai traversée, un soir, en me rappelant de sa prononciation à lui -édelberg-, très française.). Et sur le dessus de ses mains ressortaient de grosses veines bleutées, que j'ai, moi aussi, et qui faisait dire à ma mère : qui voit ses veines, voit ses peines. Pour qu'il puisse répondre qu'il n'était absolument pas malheureux, en lui souriant.
Il y eut des soirs bleus ; il y eut des soirs verts. Mais personne ne pourrait croire que cela changeât quelque chose à mon paysage. Les souvenirs circulaient. Le plus souvent, ils portaient sur des faits, sur des anecdotes qui avaient le don de le sortir du courant central de l'histoire. On raconte et les personnages sont fictifs. Ils sont en mouvement, présents et invisibles. Mes souvenirs, le regard perdu à la fenêtre ou fixé au plafond, avaient moins de netteté que mes rêves (mais il n'y apparaissait pas. Plus le désir était fort, plus sa présence était improbable. A la place, les êtres les plus secondaires envahissaient ma tête.). Je voulais rêver de mon père. Mes nuits ouvraient leurs portes au facteur, au buraliste, à l'inconnu aigri de l'autobus...
Par un après-midi morose, cédant à l'esprit romanesque, j'envisageai devant un café en terrasse, de revenir sur les lieux de mon enfance, et de le guetter, avec un gros objectif. J'en ris et n'en parlai à personne. Je ne savais si je voulais oublier cette question, sinon je ne me serais pas servi de cette photo comme marque-page. Mais c'est aussi cet usage fétichiste qui m'amena à me battre contre cet œil insistant. J'écornai un peu de la marge blanche. Alors je pris conscience que le cliché s'usait peut-être autant que moi. Je choisis des photographes (trois) à l'autre bout de la ville pour essayer de savoir si l'on pouvait deviner la couleur de l'iris. Il fut difficile d'entrer chez eux pour une requête aussi absurde. Je me sentais rougir à chaque fois. J'avais peur qu'ils fassent comme s'il était mort, aussi. Leur réponse ne m'apportèrent aucun repos.
C'était une déambulation sans fin dans mon enfance et quand, en fixant son œil, ma mémoire se mettait à fonctionner, j'avais l'envie de tout déchirer. Mais c'était impossible. Je retournai chez le dernier photographe pour lui demander un agrandissement centré sur le visage de mon père. Il me dit qu'aux dimensions que je lui imposais, l'image perdrait en netteté. Je lui répondis que ce problème m'était indifférent.
L'auvent avait maintenant disparu. Le grain du cliché original devenu plus sensible, c'était comme si un voile s'était posé entre lui et moi, comme si on avait glissé le papier dans un bas et que ce temps mort s'était recueilli inégalement. Son regard gris clair semblait faire son miel de mon obsession. Oui, son regard gris avait une odeur de métal et la posture chic que l'on trouvait dans les magazines de mode, pour des parfums moins exotiques qu'étrangement urbains. Mes souvenirs se prirent dans la glace de cet œil improbable. Mes relations pâtirent un peu de ce duel à distance. J'y pensais jusqu'à plus soif.
Je demandai un nouvel agrandissement, sur le haut du visage. Sa bouche disparut. Il devint un être mutilé dont on aurait pu s'amuser, comme dans la page loisir des hebdomadaires de plage, quand il s'agit de retrouver une figure qui fait l'actualité. Ses yeux oscillaient maintenant entre de grands soleils éteints et de tragiques nébuleuses, avec ce trou noir au milieu. L'imagination devait suppléer à la vision. Ce fond gris de plus en plus dilué se regardait de loin, parce que de près, je me perdais dans les points. Il travaillait dans l'imprimerie et cela me rappela l'imperfection des photographies dans les journaux. C'était un peu comme d'examiner les clichés d'une autre planète.
Marianne me demanda où je l'avais acheté, ce plan gigantesque sous verre, et pourquoi je ne lui en avais jamais parlé avant. J'étais retourné une dernière fois chez le photographe et j'avais demandé à ne garder que l'œil droit. Ainsi agrandi, l'œil de mon père n'était plus qu'une pulvérisation de gris semblable à une queue de comète et, sur un bord, l'esquisse d'une lune noire.
-C'est le principe des Perpetual photographies d'Allan Mc Collum. Tu prends une photo quelconque et tu en agrandis autant que tu peux un détail. Au bout d'un moment, le réel n'est plus rien d'autre qu'une trace indicible.
-Et c'est quoi, à l'origine ?
-Je ne sais pas. Mais il faut croire que cela me plaisait. J'ai trouvé cela dans une galerie.
-Un peu sombre, non ?
J'acquiesçai. Il était inutile que je m'étende sur le sujet. Je pensai tout à coup à une gerbe de cendres s'apaisant dans la neige. A moins que ce ne fût l'inverse. Nous vivions maintenant dans un monde où l'on colorisait les films, et moi, je ne reconnaissais toujours pas l'iris de mon père. Alors, faute de mieux, comme d'autres se tatouent leurs passions ou leur dérisoire philosophie, j'avais décidé de vivre avec ma question.
Je me dis que ces yeux-là, je ne les reverrais jamais, peut-être, que par le fil du temps qui court, leurs paupières, un jour closes, leur garderaient tout leur mystère, à moins que les hasards de nos vies ne nous ramènent l'un face à l'autre et que je puisse enfin retrouver la couleur de son amour.