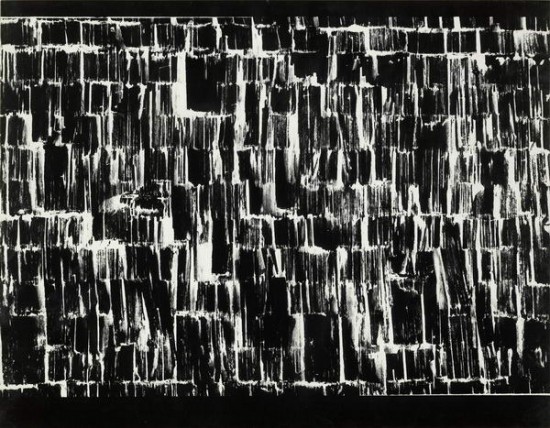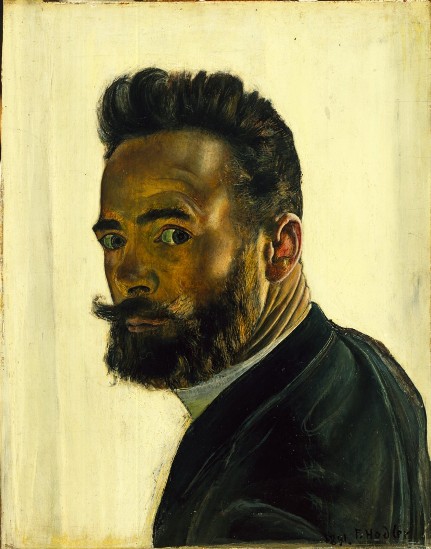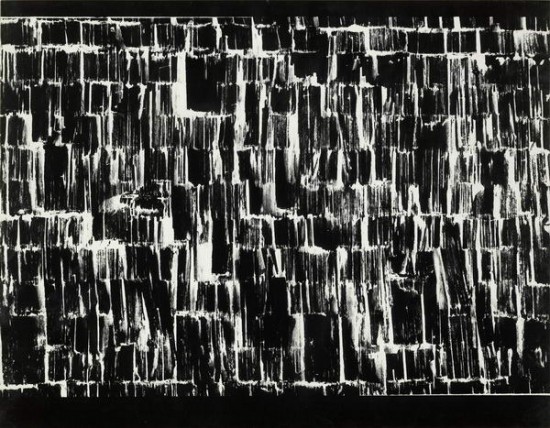
C'est en apprenant l'abdication de Juan Carlos au profit de son fils Felipe que m'est revenu à l'esprit un propos paternel concernant Jean-François Copé.
Celui-ci est empétré dans l'affaire Bygmalion, énième version affairiste de la politique dont on ne s'étonnera d'ailleurs pas puisqu'il serait fort naïf de croire que le pouvoir est un territoire où l'argent, le cynisme et les (petits) arrangements ne seraient pas des clés pour en comprendre l'esprit. Pour l'heure, l'homme qui prend un retour de bâtons est le pauvre Jean-François. Il est contraint de démissionner et comme il convient en ce genre d'occasion, les notices biographiques du bla-bla médiatique ont des allures de nécrologie. Copé n'abandonne pas seulement la tête de l'UMP, il est mort. Et cette mortalité brutale et politique apparaît plus encore spectaculaire que les multiples portraits qu'on lui consacre insistent sur l'ambition fougueuse de l'intéressé. Devant le désastre de la normalité, il avait pris tous les risques pour être l'homme de 2017. La réussite ne sera pas au rendez-vous. Il en rêvait pourtant et depuis longtemps. C'et alors que sort la confidence paternelle : la première fois qu'il se serait vu en président, il avait sept ans. Un précoce ardent : la chute est plus dure encore.
Cette anecdote est-elle vraie ou participe-t-elle de la mythologie au rabais des temps contemporains ? La question n'est pas là ; sa vraisemblance nous suffit. Elle nous suffit parce qu'elle induit tout un cadre social et culturel rendant une telle nouvelle non seulement crédible mais acceptable, par quoi le père Copé ne passe ni pour un prétentieux ni pour un bavard sénile.
Le goût enfantin et présidentiel de JFC (il a dû regretter de ne pas s'appeler Kopé. C'eût été un signe imparable) fait ressurgir deux autres figures, peut-être moins précoces, mais tout aussi centrées sur les fastes élyséens : Sarkozy et Valls. En voilà trois qui ont donc cru très tôt en leur étoile, en leur destin, ou pour mieux dire : qui se sont cru un destin, ce qui revient à être l'auto-promoteur de son exception. Et l'on voit bien l'évolution même de la notion de destin, comment cet élément du tragique, très grec, quand le héros ne peut échapper à une œuvre qui le dépasse, n'a plus aucune signification aujourd'hui. L'histoire s'étant étrangement absentée dans les bénéfices de la paix européenne et de la confiscation bureaucratique, il n'y a plus rien de décisif. C'est sans doute un des traits majeurs de l'époque, le signe de son épuisement et de sa décrépitude.
Imagine-t-on de Gaulle ou Pompidou se rêver, dans une cour de récréation, en maître de la France ? L'un était avant tout un militaire, l'autre un lettré. Les envisager dans cette posture, c'est sentir le ridicule du propos. Pour VGE, MItterrand et Chirac, l'opportunité a dû assez vite mûrir dans leur esprit, et pour les deux derniers le trône républicain fut un hochet obsessionnel dont ils ne surent rien faire : le premier parce qu'il vivait avec la hantise de la mort, le second parce qu'il n'a jamais rien pensé ni fait... Avec ceux qui leur succèdent et qui s'agitent, un pas a été franchi dans l'esprit démocratique.
Au marché commercial du politique s'ajoute sa déréalisation sublimée dans le rêve d'enfant. La démocratie ou la confusion des âges. À la vacuité des pouvoirs correspond, comme un symptôme, la justification fantasmagorique. Ce ne sont pas des adultes qui nous gouvernent (ou veulent nous gouverner) mais des adolescents convaincus d'eux-mêmes, et seulement d'eux-mêmes (1). Pathétique, sans doute, mais fallait-il espérer autre chose d'un ordre politique réduit à la soumission aux marchés et la spectacularisation médiatique. Il ne faut pas négliger l'impact du passage à l'écran qui rend la carrière politique semblable à celle des stars de cinéma (2). Sans ce miroir existentiel, la compensation narcissique à la vacuité politique n'aurait pas une telle occasion de se répandre.
Si le pouvoir est désormais fait pour ceux qui se croient destinés, déduisons que celui-ci est une baudruche et la démocratie un simple parcours d'obstacles pour obstinés et chanceux. Ce ne sont plus les événements qui déterminent les hommes, mais la configuration puérile d'un système forcément dévalué. Copé y croyait, s'y croyait. On en rirait presque si un peu de lucidité ne nous forçait à conclure que son échec (définitif ?) est moins le fait de sa médiocrité que d'un manque de précaution.
L'effet de croyance est telle qu'à l'heure où j'écris ce billet je découvre la dernière phrase historique de ce cher Sarkozy, qui sent qu'il va devoir revenir en politique parce qu'"on n'échappe pas à son destin". Petit pitre recalé qui se croit une lumière. Et quelle lumière, que de répondre aux appels au secours de l'ami Hortefeux et de la si sotte Morano. On voit bien à quel niveau se situe alors le destin : sauver un parti, sauver des places, jouer des coudes, avec en arrière-plan le pays, la crise et une certaine idée de soi à défaut de pouvoir/vouloir affirmer une "certaine idée de la France."
Telle est la réalité : l'histoire n'est plus. Reste le fait divers, que les médias travaillent pour lui donner un semblant de consistance. La loterie démocratique tourne au manège, quand certains petits prétentieux pensent qu'à eux seuls est promise la queue du Mickey.
Ainsi revenons-nous à ce cher Felipe, qui n'eut jamais ces mesquineries narcissiques, puisqu'il devait être roi. En vertu de cette désignation, que d'aucuns jugeront injuste, illégitime, quand ils ont fondé l'histoire française à partir d'une exécution en place de Grève, le successeur de Juan Carlos est infiniment plus précieux pour son pays que ne le seront jamais nos roitelets autoproclamés en culottes courtes. Paradoxalement, son héritage l'oblige à savoir où il est et ce qu'il doit à son passé. Il ne pourra jamais, lui, avoir la vanité centrée sur son seul mérite. Il ne peut pas faire outre le protocole, l'ordre qui le précède et l'ordre qu'il doit transmettre. Il est à la fois lui-même et un autre (3) quand nos pantins arrogants sont des ectoplasmes (4).
Ce constat ne signifie nullement qu'il y aurait une puissance génétique de l'aristocrate et que tous les hommes ne soient pas également estimables. Nous laissons évidemment de côté les considérations de sang bleu et autres balivernes à particule. La question est ailleurs. La démocratie est une belle idée, sans doute, mais elle tourne de plus en plus, en ce début de XIXe siècle, à la farce, une farce qui n'a même plus la discrétion des IIIe et IVe Républiques. La démocratie désormais n'est plus une pensée, une perspective mais un job. Un job de prestige pour des âmes communes...
(1)Un ami qui a passé quelques années à Science-Po m'expliquait un jour que cette école (funeste, ô combien funeste, de par son endogamie intellectuelle) pullulait de futurs présidents qui fixaient déjà l'année de leur élection. Des présidents partout, riait-il...
(2)Sur ce point, la victoire de Reagan sonne la charge des confusions. Elle est bien plus significative que de voir Shirley Temple nommer à un poste d'ambassadeur.
(3)Selon l'analyse des deux corps du roi de Kantorowicz
(4)À commencer par l'actuel locataire de ce qui fut en des temps révolutionnaires un garde-meubles. Une prémonition, en somme...
Photo : Otto Steinert