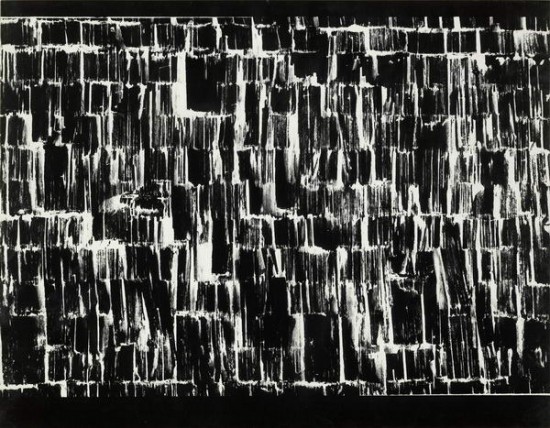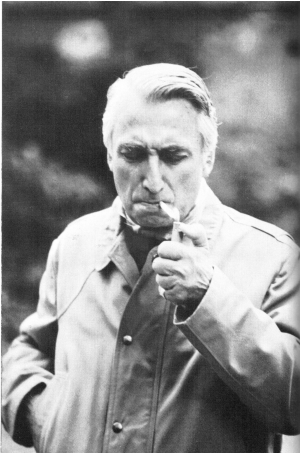À la suite d'un extrait des Essais, publié dans un manuel scolaire destiné à des lycéens, on trouve la très belle mention suivante : Mise en français moderne par... Peu importe le nom de celui qui s'y est attelé, à cette histoire de modernisation. Retenons néanmoins ceci : il ne s'agit nullement de s'en tenir à une simple correction orthographique permettant d'unifier/uniformiser un texte écrit dans une époque de plus grande liberté en la matière, ou de gommer des lettres étymologiques qui masqueraient le mot venu jusqu'à nous avec un visage un peu différent. Il s'agit bien plutôt d'un exercice de dénaturation de Montaigne au nom d'une lisibilité affadissante et traitresse (car ce serait réduire la difficulté de Montaigne à une question de pure forme. Où l'on voit le ridicule de la chose). Exercice de traficotage qui touche à la fois le vocabulaire et la syntaxe. Ainsi, Montaigne écrit, dans le Livre II, chapitre X :
Quant à mon autre leçon, qui mesle un peu plus de fruit au plaisir, par où j'apprens à renger mes humeurs et mes conditions, les livres qui m'y servent, c'est Plutarque, dépuis qu'il est François, et Sénèque. (collection Quadrige chez PUF)
La version du manuel donne ceci :
Quant à mes autres lectures qui ajoutent au plaisir davantage de profit, et où j'apprends à plier mon caractère et mes états d'âme, les auteurs qui m'enseignent et m'enrichissent sont Plutarque, depuis qu'il est traduit en français, et Sénèque.
Substitution de mots, ajouts, bouleversement de la syntaxe (et donc du phrasé de Montaigne) : la mise en français moderne est peu ou prou une traduction ! Cela signifie que Montaigne est un auteur traduit, et admis comme tel par l'institution censée défendre l'histoire de la langue et de la littérature de ce pays. Il est ni plus ni moins qu'un auteur étranger ! Il n'est pas le seul à qui l'on fasse subir le même châtiment. Rabelais y a droit. Le XVIe siècle français est donc tout à coup rejeté dans un temps si lointain qu'il devient un pays lointain, une contrée exotique. En procédant ainsi, c'est la pensée même de l'auteur que l'on trahit. Tous les arguments pédagogiques du monde ne peuvent suffire à justifier un tel traitement, à commencer par celui de l'accès facilité au texte. C'est d'abord un acte de renoncement. Un renoncement parmi d'autres sans doute. La simplification bienveillante (mais il faut toujours se méfier de la bienveillance) entérine soit la bêtise de la jeunesse, soit le refus d'un pays de maintenir, quel qu'en soit le prix, le lien avec une partie d'elle-même. Plutôt que Montaigne vivant, on choisit Montaigne empaillé, momifié. Plutôt que le souffle perpétué, le tombeau.
Cette situation va bien au delà de la question du niveau intellectuel des individus (qui monte ou descend ?). Elle trace l'avenir sombre de la littérature, son effacement comme style, c'est-à-dire comme marque, différence, singularité. Elle nous alerte sur notre rapport à l'Histoire. Alors, on imagine subitement ce que deviendrait un Racine modernisé (tâche compliquée car il a écrit des monuments avec un vocabulaire fort restreint. Des mots simples, qui reviennent, qu'il manie infiniment jusqu'à les épuiser. Pour le coup, je crois qu'il est voué à disparaître). On se prend à rêver d'un Proust, dont on reverrait la ponctuation, parce que ses phrases sont décidément trop longues (un peu comme on corrige une copie d'élève à qui l'on dirait : très bien, jeune homme, mais faites plus simple parce que, parfois, on s'y perd.)
Tout cela sent le mépris, et pour les écrivains, et pour les potentiels lecteurs. Et lorsque la France institutionnelle en vient à renier Montaigne, que d'aucuns doivent juger aussi ennuyeux que La Princesse de Clèves, une certaine mélancolie vous gagne. Alors, on décide de se taire et de lui laisser la parole, parole pleine et entière, telle qu'on la trouve dans le Livre III, chapitre XIII, pour méditer sur la vanité des vacations farcesques de certains :
Esope ce grand homme vid son maistre qui pissoit en se promenant : «Quoy donq, fit-il, nous faudra-il chier en courant ?» Mesnageons le temps; encore nous en reste-il beaucoup d'oisif et mal employé. Nostre esprit n'a volontiers pas assez d'autres heures à faire ses besongnes, sans se desassocier du corps en ce peu d'espace qu'il luy faut pour sa necessité. Ils veulent se mettre hors d'eux et eschapper à l'homme. C'est folie; au lieu de se transformer en anges, ils se transforment en bestes; au lieu de se hausser, ils s'abbattent. Ces humeurs transcendantes m'effrayent, comme les lieux hautains et inaccessibles; et rien ne m'est à digerer fascheux en la vie de Socrates que ses ecstases et ses demoneries, rien si humain en Platon que ce pourquoy ils disent qu'on l'appelle divin. Et de nos sciences, celles-là me semblent plus terrestres et basses qui sont les plus haut montees. Et je ne trouve rien si humble et si mortel en la vie d'Alexandre que ses fantasies autour de son immortalisation. Philotas le mordit plaisamment par sa responce; il s'estoit conjouy avec luy par lettre de l'oracle de Jupiter Hammon, qui l'avoit logé entre les Dieux : «Pour ta consideration, j'en suis bien ayse, mais il y a de quoy plaindre les hommes qui auront à vivre avec un homme et luy obeyr, lequel outrepasse et ne se contente de la mesure d'un homme.» Diis te minorem quod geris, imperas.(1)
La gentille inscription dequoy les Atheniens honnorerent la venue de Pompeius en leur ville, se conforme à mon sens :
D'autant es tu Dieu, comme
Tu te recognois homme.
C'est une absolue perfection, et comme divine, de sçavoir jouyr loiallement de son estre. Nous cherchons d'autres conditions, pour n'entendre l'usage des nostres, et sortons hors de nous, pour ne sçavoir quel il y fait. Si, avons nous beau monter sur des eschasses, car sur des eschasses encores faut-il marcher de nos jambes. Et au plus eslevé throne du monde, si ne sommes nous assis que sus nostre cul.
(1)"C'est en te soumettant aux dieux que tu règnes sur le monde." (Horace, Odes, III, VI, V)
PUF, collection Quadrige