
Caravage, Narcisse, 1599, Palais Barberini, Rome
Se rappeler d'abord l'histoire racontée par Ovide, dans Les Métamorphoses
Comme cette nymphe [Écho], d'autres, nées dans les eaux ou sur les montagnes, et auparavant une foule de jeunes hommes s'étaient vus dédaignés par Narcisse. Aussi une victime de ses mépris, levant les mains vers le ciel, s'écria : « Puisse-t-il aimer, lui aussi, et ne jamais posséder l'objet de son amour ! » La déesse de Rhamnonte exauça cette juste prière. Il y avait une source limpide dont les eaux brillaient comme de l'argent ; jamais les pâtres ni les chèvres qu'ils faisaient paître sur la montagne, ni aucun autre bétail ne l'avaient effleurée, jamais un oiseau, une bête sauvage ou un rameau tombé d'un arbre n'en avait troublé la pureté. Tout alentour s'étendait un gazon dont ses eaux entretenaient la vie par leur voisinage, et une forêt qui empêchait le soleil d'attiédir l'atmosphère du lieu. Là le jeune homme [Narcisse], qu'une chasse ardente et la chaleur du jour avaient fatigué, vint se coucher sur la terre, séduit parla beauté du site et par la fraîcheur de la source. Il veut apaiser sa soif ; mais il sent naître en lui une soif nouvelle ; tandis qu'il boit, épris de son image, qu'il aperçoit dans l'onde, il se passionne pour une illusion sans corps ; il prend pour un corps ce qui n'est que de l'eau; il s'extasie devant lui-même ; il demeure immobile, le visage impassible, semblable à une statue taillée dans le marbre de Paros. Étendu sur le sol, il contemple ses yeux, deux astres, sa chevelure digne de Bacchus et non moins digne d'Apollon, ses joues lisses,son cou d'ivoire, sa bouche gracieuse, son teint qui à un éclat vermeil unit une blancheur de neige ; enfin il admire tout ce qui le rend admirable. Sans s'en douter, il se désire lui-même; il est l'amant et l'objet aimé, le but auquel s'adressent ses vœux; les feux qu'il cherche à allumer sont en même temps ceux qui le brûlent. Que de fois il donne de vains baisers à cette source fallacieuse ! Que de fois, pour saisir son cou, qu'il voyait au milieu des eaux, il y plongea ses bras, sans pouvoir s'atteindre ! Que voit-il ? Il l'ignore ; mais ce qu'il voit le consume ; la même erreur qui trompe ses yeux les excite. Crédule enfant, pourquoi t'obstines-tu vainement à saisir une image fugitive? Ce que tu recherches n'existe pas ; l'objet que tu aimes, tourne-toi et il s'évanouira. Le fantôme que tu aperçois n'est que le reflet de ton image ; sans consistance par soi-même, il est venu et demeure avec toi ; avec toi il va s'éloigner, si tu peux t'éloigner.(1)
La beauté du récit, sa dramatisation qui se prolongera jusqu'à la tragique dissolution de l'être, font de ces quelques lignes une pure merveille. Elles ont ouvert sur la thématique désormais archi-connue du narcissisme, dont la société postmoderne hédoniste fait ses choux gras. Et l'œil qui fascine (2) se transforme en nombril. On pense alors à tout ce que la psychologie et la psychanalyse ont exploité en la matière, sans parler de l'érotisme, si l'on veut bien relire la retorse Histoire de l'œil de Bataille.
C'est sans doute de venir au palais Barberini avec autant de valises qui fait que le point crucial du tableau du Caravage aura mise autant de temps à poindre. Toujours la même question, dans le fond : qu'es-tu capable d'accepter qui te dérange ? dans quelle mesure la tentation de l'ignorance, sous le vernis du savoir, te mène loin ? loin de la réalité, loin de toi, loin des autres (en bien comme en mal). Il faut pourtant se méfier de ce peintre, de sa forme ultime d'art, comme point suprême de ralliement d'une envie de vivre et d'une terrible lucidité.
Le tableau n'est pas spectaculaire, s'il faut oser ce paradoxe. Il lui manque, à première vue (!), une force dramatique, une tension brusque pour une attention remarquable. On lui préfère, en ce lieu muséal, le serpent de la Madone des Palefreniers, par exemple. Il y a une forme d'injustice devant un tel chef d'œuvre à ne pas être plus attentif. Dans cette histoire, on regarde l'eau, le reflet. On connaît, se dit-on, le fin mot de l'affaire, et le tour est joué. Erreur. Caravage n'en fait qu'à sa tête. Il détourne, et démonte donc, le texte. Il en donne sa version. Une version, ni plus belle ni plus profonde que celle du texte d'Ovide, ce n'est pas la question, mais une version qui creuse un autre sillon du lien que nous créons avec le mythe.
Dire qu'il n'y a pas de tension est d'abord une erreur. Il faut regarder le bras de Narcisse dans sa verticalité franche. Dans la même pièce (mais le proche est souvent le plus lointain...) du musée, il suffit de faire quelques mètres et l'on retrouve son semblable, mortifié d'une terrible fin : Holopherne cédant sous le coup de Judith...
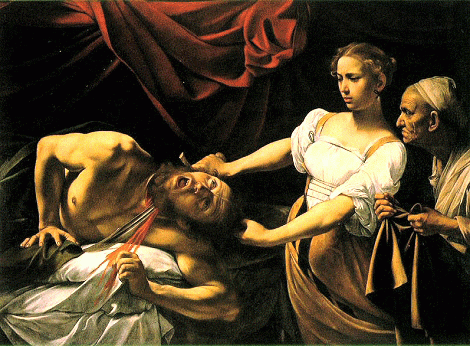
Judith tuant Holopherne, 1598, Palais Barberini
Ainsi Narcisse est-il, en partie, le compagnon d'infortune d'un cruel qui se croyait au-dessus des lois et qui le paie de son sang. Le calme et la légèreté du cadre dans lequel Narcisse est peint ne sont que des apparences, des semblants de quiétude. On pourrait dire alors que c'est justement cet ensemble délicat qui projette un trouble invisible sur l'eau. Le bras s'appuie au sol, alors même que l'histoire se joue dans l'eau (3). L'autre main sert aussi, formant un cadre supplémentaire, un tableau dans le tableau, une mise en abyme, dont la ligne d'horizon n'en est pas une, dont la ligne horizontale n'est pas une perspective mais une ligne de partage, et plus encore : une limite, une déchirure, une faille qui ouvre à la fausse ressemblance, au semblable factice... On s'y perd, en fait, et le résultat sera terrible.
Mais tout cela n'est rien à côté de l'élément qui forme le cœur de l'étonnement. Narcisse a les yeux fermés. Les yeux fermés...
Le regard, chez Caravage, n'est pas rien. C'est le dramatique par excellence, ce par quoi la vieille qui assiste Judith dans son crime jouit de la vengeance, ce par quoi l'autoportrait en Goliath décapité devient un cri abominable de souffrance. Les yeux, le savoir des yeux. Pas leur expressivité, seulement. Un élément moteur.
Narcisse mourrait de se regarder mais le peintre le représente paupières closes. Est-ce l'indication de la disparition prochaine ? Peut-être. À moins que ce ne soit la captation de ce moment d'orgueil où le plaisir de se regarder recourt à l'œil clos, comme un plaisir muet et ravi ? Peut-être.
Mais ne faudrait-il pas y lire une autre signification, un autre motif que la perdition promise à qui trop se regarde, à qui cède à trop de contemplation fabuleuse ? Caravage laisse le miroir de côté et fouille ailleurs, dévoile un sens supplémentaire à la commune mésaventure de Narcisse. Ce dont il est le signe porte non seulement sur le désir de se voir, pas la peine d'y revenir, mais aussi sur le désir de ne pas se voir. Tel est le secret, double, du trouble narcissique : ne voir que soi, et n'être pas capable de se regarder en face. Se gonfler de toute sa suffisance et ignorer sa réalité, être au-delà et en-deçà de soi. Le Narcisse n'est pas seulement l'être qui ne veut que soi en finalité ; il est celui qui, pour y parvenir, doit faire de sa propre personne le point aveugle du tableau. Il est le faux sage (4) qui ne peut arriver à rien d'autre qu'à se supprimer.
Caravage a choisi cette discrète expérience. La moins spectaculaire, la plus étrange, la plus intime, celle qui nous renvoie à nos propres mensonges, à l'inamicale rêverie dans laquelle nous nous plongeons parfois, tant il arrive souvent que nous soyons notre pire ennemi.
(1)Traduction Georges Lafaye, édition des Belles Lettres.
(2)On reconnaîtra là une allusion au poème de Baudelaire À une passante dont la thématique oculaire est centrale, et tout aussi douloureuse
(3)Un peu comme l'inscription funéraire de Keats, à Rome, au cimetière protestant : Here lies one whose name was written in water (ci-git celui dont le nom était écrit dans l'eau).
(4)À l'inverse de Tirésias, et même d'Œdipe arrivé au bout de son hybris...
