Il y a la volubilité du temps, la basse continue de la réminiscence, et l'écheveau de la vigne envahissant le mur...
-
-
Rabbia e Amore
Pour Guilhem, indéfectiblement
Une mienne connaissance revenant d'un court séjour de travail à Rome me raconte qu'il a lu un graffiti politique sur un mur de la Ville : rabbia e amore. La rage et l'amour. Il vit loin de l'Europe, en Afrique de l'Est et ce à quoi il est confronté, nous n'en avons pas la moindre idée, à l'abri de notre quotidien européen (n'excluant pas pourtant que la misère et la violence soient présentes). Rabbia et amore. Cette perspective gaucho-révolutionnaire ne le fait même pas rire, même s'il sait fort bien quels sont les tenants et les aboutissants d'une telle position. Il s'agit sans doute de revendiquer une autre société, de mettre en jeu les iniquités du monde, de se gonfler de la droite exigence de la justice, et pour cela, il serait nécessaire d'invoquer la légitime colère. Et cette légitime colère le dérange, comme moteur politique s'entend, non dans sa dimension éthique.
Car cette légitime colère qui se transforme, selon les moments, en une revanche cruelle d'une communauté sur une autre, d'un clan sur un autre, d'une famille sur d'autres, il a l'occasion d'en voir les effets désastreux lorsqu'elle se pare de mépris et de bon droit, au nom des humiliés d'avant. La rage, au-delà de la colère vue comme mauvaise conseillère, n'est ni un programme ni un regard réel sur le monde mais un aveuglement. Ceux qui l'invoquent en sont encore à croire que la politique ne se fait qu'avec des (bons) sentiments. Et dans cet ordre, l'amour n'est pas mieux. Que signifie-t-il en effet en politique ? Est-ce un prolongement à tous des liens qui nous unissent à quelques-uns ? S'agit-il d'éradiquer, de bannir ou d'interdire cette singularité de la vie qui fait que nous restons parfois interdits ou réticents, presque d'instinct, à autrui ?
Il y a dans ce rabbia e amore un fond de romantisme politique un peu dérisoire alors que c'est de rationalité que le monde a besoin. Le pouvoir, pour qu'il dure et soit le moins nuisible possible, se doit de garder la tête froide. Cela n'a rien à voir avec la real politik ou le cynisme machiavélien mais concerne le devoir indissociable de l'exercice des responsabilités d'évacuer l'immédiat de la vindicte et de la justice expéditive. Le tag romain est en soi une humeur, et les humeurs sont avant tout les prétextes à transformer la justice en injustice, le raisonnable en arbitraire. Ce sont proprement les déjections de la pensée.
On s'est parfois étonné qu'après les horreurs du Rwuanda les bourreaux et les survivants aient pu cohabiter, comme auparavant les populations khmer, yougoslave, les résistants et les collabos. Souvent, d'ailleurs, nous qui avons vécu depuis longtemps en ce milieu si tempéré y allons de notre couplet moralisant, parce que nous usons de la rage d'une manière somme toute abstraite et ce que nous ne comprenons pas est là, justement : dans le fait qu'elle ne peut être une réponse à celle qui l'a précédée. Rabbia e amore sonne comme ces ridicules revendications adolescentes venues directement de la grotesque poésie soixante-huitarde : d'il est interdit d'interdire à lycée = prison. La liberté de la formule, sa poétique en forme de slogan sont des illusions, et des illusions parfois funestes. Elle n'est d'ailleurs que l'inversion un peu simple d'un film à sketchs (genre très en vogue dans les années 60) où se commit, entre autres Godard, Amore e rabbia.
Le gauchisme romain qui nous promet d'abord la violence en prévision de relations tout en douceur est aussi inquiétant que les graffitis fascistes et racistes qu'on lit parfois dans cette ville (notamment quand des supporters de la Lazio ont voulu montrer qu'ils étaient alphabétisés)
La rabbia est une aporie et ce tag me rappelle alors ce livre virtuose d'Alessandro Baricco dont le titre français, Les Châteaux de la colère, manque l'essentiel du titre italien. I Castelli di rabbia, que le lecteur déchiffre aussi en I Castelli di sabbia. La rage, comme du sable en devenir. Châteaux de sable... Vision immature de la politique, pour finir, sans doute, comme bien des trotskystes ou des anciens jeunes de l'extrême-droite, plus tard, dans les ors ministériels du confort bourgeois libéral, loin de ce que cette mienne connaissance, si chère et précieuse, connaît, lui, dans les zones dangereuses du Darfour...
-
Schubert, loin du bruit...
Quand tu n'as rien à dire, rien envie de dire, donne à ton tour ce qu'on t'a donné. -
Apologie du Proche et du Retour
Fontaine des Tortues (détail), Piazza Mattei, Rome
Une mienne connaissance s'étonnait un jour de mon attachement à Rome, du besoin que j'ai désormais d'y retourner une fois l'an (ou à peu près). Je dois la connaître, cette ville, me disait-elle, à moins que tu n'y aies des attaches familiales. Absolument pas. Dès lors, pourquoi une telle constance, un besoin quasi viscéral de revenir.
La réponse la plus immédiate concernerait la ville elle-même, ce qu'elle abrite, ce qu'elle raconte, les traces que j'y (re)trouve, son caractère de concrétion qui dérange parfois certains. Mais il me semble un peu facile d'invoquer l'inscription de Rome dans l'Histoire : ce n'est paradoxalement qu'une réalité se surajoutant à un problème de fond plus indispensable à la vie elle-même. Il suffirait alors de se transporter à Venise ou à Florence pour éprouver ce bonheur similaire, et ce n'est pas loin s'en faut le cas. S'interroger sur la matière n'est peut-être pas toucher à la rigueur de ce frisson qui gagne l'échine du voyageur se sentant enfin chez lui. Encore n'est-ce qu'une formule, car il serait prétentieux d'affirmer que je connais Rome. Telle est l'une des raisons majeures de la quête, jusque dans les quartiers paisibles de San Lorenzo ou de Garbatella, jusque dans ces heures entières assis en terrasse ou au Campidoglio (tout un après-midi à voir des cortèges de mariage et l'élégance avec parfois trois fois rien des Italiennes...), à ne rien faire que regarder, à perdre du temps que les émissaires du tourisme agité diraient si précieux.
Car jamais comme là-bas je ne m'engage autant à perdre, à dilapider les matins ou les fins de journée, et ce n'est pas le soleil, la chaleur parfois écrasante qui en sont la cause, mais un sentiment bien plus tendu en moi, que l'infini de la Ville est à ce point sensible : une gargouille vue pour la première fois sur un bâtiment piazza del Quirinale, Santa Maria della Pace enfin ouverte, une école repeinte aux couleurs de la Roma, une cour intérieure entrevue, comme un patio espagnol, rien qui ne soit décisif mais me remplit, passant pourtant attentif, de cette inépuisable promenade dans le temps, dans la vie, en moi-même.
C'est à Rome que j'ai compris la vanité d'une prise à bras le corps du monde. Quinze, vingt fois revenir au Campo de' Fiori, quel dommage, quand la planète est si grande, les espaces si vastes et les peuples si nombreux ! À cela il n'y a rien à répondre, sinon que justement cette conscience soudain aiguë que l'acharnement contemporain à comprimer les distances nous a fait croire que nous pourrions, dans les bornes de notre existence, en toucher les limites, être une sorte de globe-trotter impénitent pour soirées photos épatantes, est un leurre. Et c'est dans la verticalité d'une Histoire qui prend racines dans l'Antiquité et se poursuit jusque dans les traces grotesques du fascisme à l'UER, verticalité si magistrale que ce qu'il me reste à vivre (trente ans disons) me donne l'impression d'être ainsi devant un mur incommensurable dont je déchiffrerais les inscriptions les plus faciles, guère plus, cette verticalité où se rejoignent, au-delà des architectures, des peintures, des sculptures, toute une civilisation, c'est face à elle que j'ai compris combien l'horizontalité du voyage perpétuel qu'on nous vend désormais comme le comble du bonheur est une escroquerie. Aller du nord au sud, aller d'est en ouest, et pouvoir parler du Japon, de l'Argentine ou de la Malaisie, au gré de ses séjours top chrono, tout cela est certes passionnant dans le jeu social de la mobilité (qui n'est pas qu'un leitmotiv de la contrainte économique : c'est le jeu du déracinement) mais ne mène pas loin.
Dès lors, le retour régulier à Rome outrepasse l'endroit lui-même. Pour d'autres ce sera le Cotentin, la Lozère, l'outback australien, Tokyo ou Casablanca, la ville où nous vivons sans jamais vouloir la quitter, peu importe. Nous allons simplement y creuser notre propre source.
Nous ne pouvons pas être de n'importe où. Cela ne signifie nullement que nous devions nous enterrer dans l'assignation sociale et économique de nos existences. Nous ne sommes pas à résidence. En revanche, je suis convaincu que nous n'aspirons pas à cette frénésie sociale de ce que j'appellerais le voyage résiduel, celui qui s'ajoute à la liste des destinations que nous avons faites, sans qu'elles nous aient façonnés justement. Nous ne pouvons nous engager avec une égale force dans ces parenthèses souvent oiseuses que sont devenues les aventures contemporaines (et qui n'ont d'aventures que le nom). Il ne s'agit pas d'évaluer ce que chacun en a retenu mais plus modestement de se demander si nous y avons vécu. Tous les lieux n'ont pas pour l'un ou l'autre la même exigence, ni la même résonance. Peut-être y en a-t-il qui chercheront toujours l'endroit qu'ils voudraient faire leur, sans jamais y parvenir. Heureux celui qui a touché cette rive, et a la chance autant qu'il lui est possible, de la revoir, d'en observer les changements, les variations, et de sentir en soi les changements et les variations qui lui sont propres...
Photo : Thierry Jamard
-
Nature morte
En voyant les chiens, ils avaient sauté dans un taillis et lui avait senti sa cheville gauche se fracasser contre une pierre, mais il s'était retenu de crier. Le ciel était pur bleu, mais le fond de mars faisait encore frissonner la fin de matinée. Des plaques de neige, ça et là, subsistaient : il sentit immédiatement l'humidité dans son dos au sol. Ils étaient à peine cachés ; la végétation n'était pas en avance.
Il fallait attendre, considérer qu'ils étaient peut-être là, dans les maisons du hameau, à manger et se reposer, ou dans un moment de désœuvrement, qui réactiverait leurs goûts violents. D'où ils étaient, l'entrée des quatre bâtisses était invisible. Le soleil glissait. Sa cheville avait enflé. Il la frottait de temps à autre. Ils ne bougeaient ni ne parlaient. Il ne se passait rien et Michel lui murmura enfin que sans doute ils étaient déjà repartis. Ils pouvaient toujours réapparaître à la nuit tombante, mais c'était improbable. Ces milices avaient l'habitude de filer sans cesse en avant, à corps perdu. Elles revenaient rarement sur leurs pas. Alors, quand le jour déclina, ils se décidèrent. Sa cheville tenait le choc. Ils descendirent doucement le chemin. Il était inutile de se faire discrets. À découvert désormais, les autres les auraient eus en ligne de mire.
Il pensa comme rarement à sa mort, quand ils arrivèrent à la hauteur des chiens, qu'ils avaient abattus à l'arme automatique. Mais cela ne leur avait pas suffi, de les faire taire. Le berger et le corniaud avaient été égorgés ; le sang avait séché.
Ils arrivèrent au pignon de la bâtisse la plus proche, s'arrêtèrent quelques instants pour humer l'air silencieux et trois mètres de plus pour voir sur le pas de la porte le corps criblé d'un homme qui avait voulu, sans doute, se défendre, mais ils ne virent pas d'arme. Ils avaient dû la récupérer. Avant de l'enjamber, Michel prit des clichés en rafale. Ils parcoururent les pièces et ne trouvèrent personne. Des chaises avaient été renversées. On devinait quelques traces de lutte. L'ameublement était pauvre et les miliciens n'avaient pas dû s'attarder. Les placards n'étaient pas ouverts et le si peu qu'ils purent y trouver laissait supposer que la nourriture n'était pas le motif de leur descente. C'était les habitants du hameau qui les intéressaient et tous avaient été emmenés.
Il revint dans la cour et sans rien dire gagna la deuxième maison. La porte était entrouverte. Il la poussa et le grincement attendu s'éternisa, lui semblait-il dans son souvenir. S'engageant dans le couloir, il remarqua à sa droite dans ce qui faisait office de cuisine une grande table de bois massif et rude et il resta interdit devant un étrange spectacle. Deux assiettes étaient posées, en face à face, pleine d'une soupe un peu épaisse où nageaient de gros morceaux de pommes de terre ; les cuillères étaient posées contre le rebord, à angle droit ; deux verres à demi remplis d'eau, une tranche de pain, pour chacun des convives, près de la fourchette ; et les chaises étaient glissées, ne laissant voir que le dossier.
Il sentit Michel dans son dos, comme lui silencieux. Il prit son appareil et bombarda cette singulière nature morte. Comment pouvait-il là imaginer une telle rectitude dans une demeure dont les occupants avaient été victime d'une descente sinistre ? Tel qu'était disposé le repas de ces deux êtres, il fallait supposer que l'arrivée des miliciens avait été compris pour ce qu'elle était certainement : un arrêt de mort, et plutôt que de s'enfuir, de résister, même en vain, ils avaient choisi que les barbares n'entacheraient pas le dernier moment l'un face à l'autre. Alors ils avaient fini leur cuillerée, s'étaient levés, avaient rangé leur chaise et gagné la porte d'entrée, sans illusion sur leur destin funeste.
En noir et blanc, cela donnait une photo de genre, d'un intérêt très relatif, mais qu'il avait punaisé au-dessus de son bureau, et qu'il retrouvait à chaque retour de ses quêtes à travers le monde. Il avait vu bien des horreurs et des détresses, senti des douleurs muettes, béni des morts, accompagné des à peine vivants, mais jamais comme dans le jour fatigué de cette demeure il n'avait autant été imprégné d'une gloire humaine qui le dépassait. Il n'y voyait ni résignation ni héroïsme : c'était un besoin de préserver son monde, jusqu'au bout, d'une manière qui lui aurait paru, a priori, dérisoire. Sans doute n'avaient-ils rien prémédité... Ils s'étaient regardé dans les yeux, entendant les cris dehors, les coups de feu qui abattaient les chiens.
Selon les saisons, il se perdait différemment dans la contemplation de la photo. En plein hiver, quand le plateau de Langres se figeait de neige, ou même aux premières heures du printemps, il avait l'impression, en regardant par la fenêtre, d'avoir accompli la distance le ramenant à ce hameau perdu ; au cœur de l'été, c'était l'inverse : un sentiment d'irréalité qui mettait cette fois le cliché à distance, comme une œuvre composée pour la circonstance : une étude pour une nature morte... Jamais il ne pensa à la décrocher.
Avec Michel, il n'avait jamais reparlé de ce dernier repas sauvé de l'agitation horrible du dehors. On retrouva le lendemain, dans une clairière, à quelques kilomètres, l'ensemble du hameau atrocement mutilé. Michel mourut au Libéria quatre ans plus tard. Il attendit près de cinq ans pour expliquer à Émanuèle la raison, au fond très banale et peut-être pure affabulation de sa part, de son attachement ; et plus encore pour lui avouer ce dont il n'était pas très fier : d'avoir ouvert armoires et tiroirs, sans succès, pour trouver une photographie de ces deux commensaux disparus, d'avoir, d'une certaine manière, bafoué ce qui leur était sacré, de n'avoir pas été plus digne, se disait-il parfois, que les hommes armés aux visages eux aussi inconnus...
-
Le Livre de Matthias
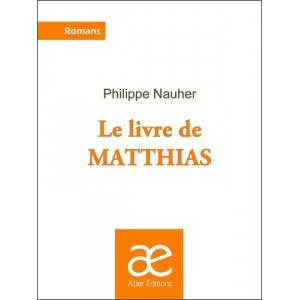
Le Livre de Matthias, édité il y a déjà sept ans grâce à la bienveillance de Maurice Glaymann (une belle rencontre, hors de toutes ces considérations éditoriales. L'homme à lui seul mérite hommage et amitié), reparaît chez Alter Éditions, en format e-book.
En guise de présentation, j'écrivais ceci en 2005 :
Pour Cécile, être morte n'est rien.
Encore faut-il ne pas être morte pour rien. Dès lors, elle qui était partie dans le Nord pour travailler et s'éloigner de tous a imaginé de revenir au cœur des choses. Agir pour que tout son univers dispersé se retrouve : le père et l'oncle qui s'occupent de son ancien appartement, le frère qui navigue loin depuis trop longtemps, l'amie rencontrée au hasard d'une nomination. Et tout ce monde doit se tenir, comme la corde soutient le pendu.Je n'ajouterai aucun commentaire. Je n'ai rien à dire de plus. Sinon, on le trouverait certainement quelque part, dans le roman...
-
L...
La vie n'a pas de pagination, jouant selon le temps de chapitres occultés, de paragraphes raturés, de palimpsestes. Ainsi va notre chair...
-
Pouvoir d'achat (groupe nominal)
Voici l'un des astres les plus brillants de la politique contemporaine, l'étoile du Berger d'une société qui s'achève dans la pure consommation. S'achève, oui, car je crains que, derrière ces esprits absorbés dans l'avoir, il n'y ait une course vers l'abîme autrement plus périlleuse que celle évoquée par Dominique Fernandez lorsqu'il écrivait sur le Caravage.
Le pouvoir d'achat...L'expression demande une réflexion, non pour en définir le sens strict sur le plan économique, mais au niveau de la charge symbolique induite par le choix sémantique. Cet objet de référence, que l'on trouve aujourd'hui dans la bouche de tous les leaders politiques et syndicaux, est en effet l'alpha et l'omega de la réussite. Les uns veulent le maintenir, d'autres le faire progresser. Aucun ne nous précise à quoi il renvoie, ce qu'on peut en faire, s'il nous rendra plus heureux, s'il est le signe d'une société plus juste. Rien de tout cela. En revanche, tous, en le magnifiant de la sorte, désignent volontairement ou par défaut, la ligne directrice de la société dans laquelle nous vivons. Ils renvoient le bonheur ou son approche à deux éléments déterminants.
Plus que le politique ou le social, il s'agit de poser que le vrai pouvoir est dans l'économique désormais, que toute réussite personnelle tient dans notre capacité à intégrer le circuit commercial, à en être un acteur certes anonyme mais efficace sur le plan de la consommation. Le rappel constant de ce paramètre dans les discours contemporains marque l'adhésion, y compris des "forces de contestation", à un modèle où ce qui tient lieu d'existence est jugé à l'aune d'un mouvement participatif à la grande foire mondialisée des produits et des biens. La course au pouvoir d'achat n'a évidemment rien de révolutionnaire mais signe la volonté de chacun, pauvres compris, d'entériner le système, de le valider en apportant sa pierre à l'édifice du consumérisme jusqu'au boutiste, dans l'esprit d'un après moi le déluge magistral.
Plus que les conditions mêmes du travail, du droit social (mais il faut s'adapter. Cela aussi, on nous le répète. Il faut être moderne...), de la défense des miséreux, du partage des richesses, le pouvoir d'achat, comme borne de la pensée, fait office de sésame vers un futur meilleur. C'est le deuxième élément essentiel : le pouvoir d'achat, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'est pas un idéal collectif. Il est un indice économique qui ne prend pas en compte les conditions de vie propres à chacun. Preuve en est que les statistiques vous diront que le pouvoir d'achat des Français a progressé depuis 25 ans. Donnée abstraite, nous semble-t-il, eu égard aux difficultés croissantes rencontrées par beaucoup pour vivre le quotidien, boucler les fins de mois, supporter le stress d'un précarité galopante et les déchirements d'une société qui a rendu le rêve spectaculaire, tous les soirs sur les chaînes de télévision.
Il y a donc une ironie certaine à définir ce pouvoir-là comme essentiel parce qu'il qualifierait une liberté fondamentale du sujet, quand, justement, il caractérise une aliénation imparable de ce même sujet. Une société qui n'a que cela à offrir est proprement mortifère car il est illusoire de croire que c'est en accroissant le pouvoir d'achat de 1 ou 2% l'an que les plus pauvres vivront mieux. On les a tellement conditionnés, tellement travaillés par un marketing ciblé, tellement embrigadés dans le branding de toutes sortes, que le si peu qu'ils récupèrent ne sert qu'à combler (pour être plus précis, essayer de combler) la frustration produite par un monde où l'objet, l'achat, la possession sont les maîtres. Et, sur ce plan, rien ne peut atténuer la soif d'avoir : il suffit d'observer la soumission de toute la jeunesse, banlieue ou beaux quartiers, aux impératifs des signes extérieurs de richesse pour constater que nous avons atteint un stade de non-retour.
C'est d'ailleurs à partir de ce constat que l'on regardera comme caduques les programmes électoraux de 2012 (mais l'histoire remonte à bien plus loin. Mai 68, une fois démystifié l'angélisme baba-cool, est un cimetière majeur de la pensée alternative). Le travailler plus pour gagner plus de Sarkozy n'a pas été attaqué sur le fond mais sur l'inefficacité des procédures qui ont été mises en œuvre pour en faire une réalité. Question de forme, tout au plus. Ce qu'on nous annonce est du même tonneau. Fussent-ils d'extrême-gauche, ils ont la même logique : un consumérisme permanent, plus ou moins assumé, sur lequel se greffe la variable de la répartition des richesses, ce que certains appelleront une politique plus juste. Or, ce n'est pas de cette manière que l'avenir peut se dessiner autrement que comme une catastrophe économique, politique, écologique...
-
Notule 14
Il ne s'agit pas de raconter les livres, d'en dévoiler la matière, les tenants et les aboutissants mais de les faire connaître, sans chercher un classement cohérent, sans vouloir se justifier. Simplement de partager ce «vice impuni» qu'est la lecture.
Puisque l'année est politique, électorale, et donc forcément spectaculaire, autant se (re)plonger dans des romans politiques (laissons de côté -manière de parler- les écrits théoriques)
1-Jack London (États-Unis), Le Talon de Fer, 1908
2-Robert Penn Warren (États-Unis), Les Fous du roi, 1947
3-Nurrudin Farrah (Somalie), Du lait aigre-doux, 1979
4-Don DeLillo (États-Unis), Les Noms, 1982
5-Ahmadou Kourouma (Côte d'Ivoire), En attendant le vote des bêtes sauvages, 1994
-
Regarde-moi (sur une photographie de Georges A. Bertrand)

De sa misère, guerrière et hallucinée, faire sa chemise et la peau, la sauver dans ce portrait de pilote cinémascope. Les avions au-dessus du territoire, parfois. Il faut dire la bande. Furtivité du bruit menaçant. Toujours le bruit. Tu me regardes. Top Gun. La peau imprimée
d'un lointain univers, de ce qui est, peut-être, l'ennemi. Mais je te dis : rien qu'un film, un acteur, comme je voudrais être, moi,
acteur. Alors j'oublie, j'essaie du moins, devant la glace, face à ce visage, et au mien. Tom
Cruise, dis-tu ? Je sais. Je ne connais pas. Moi, j'ai lu Gun, et cela m'a suffi. Dans l'idée
de se battre pour vivre. Américain, dis-tu ? Je sais... Pourquoi pas ?
Mais d'abord, oublie mon tee-shirt. Regarde-moi.
Regarde-moi.
