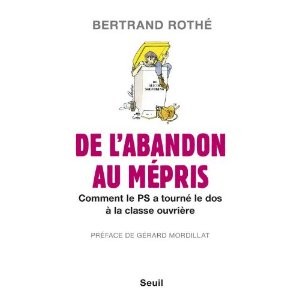Van Dyck, Mary Ruthven, Lady Van Dyck, c.1639, Prado, Madrid
Toute intention a son mystère, et si le temps fait son office, et notre manière de regarder s'en trouve bouleversée, alors, il n'est pas sûr que nous puissions retrouver le motif autour de quoi se construit une œuvre.
Van Dyck paraît aisément identifiable, cernable, comme s'il y avait une lisibilité propre à sa peinture. La rigueur des poses, la majesté recherchée des individus, leur étrange dignité concourent à inscrire ses tableaux dans une distance sévère. On connaît le début du poème que lui consacre Proust, pour une musique de Reynaldo Hahn :
Douce fierté des coeurs, grâce noble des choses,
Qui brillent dans les yeux, les velours et les bois ;
Beau langage élevé du maintien et des poses
Héréditaire orgueil des femmes et des rois !
Il y a donc dans l'esthétique de Van Dyck un imparable souci de ne pas engager l'histoire de l'œuvre dans celle de celui qui est représenté, comme s'il fallait que sa peinture soit au delà de la réalité peinte, pour faire les êtres plus beaux qu'ils ne sont. C'est à cette condition que le Hollandais, qui finira par être si anglais, peut nous impressionner, quand on admet qu'il s'obstine à grandir ses modèles et que pour ce faire s'instaure une distance qui excède de beaucoup les mètres ou les centimètres séparant effectivement l'artiste du sujet.
On n'est pas outre mesure troublé lorsqu'il s'agit de contempler une royauté ou une aristocratie quelconque. C'est une sorte de loi du genre. Il n'en est pas de même pour ce tableau.
Van Dyck y peint sa femme. Elle est en habit de belle distinction sans que ce soit en même temps trop cérémonieux. Lady Ruthven ne s'apprête pas à sortir. Elle est, en quelque sorte, dans son espace privé. Elle a dans les cheveux une coiffure de feuille de chêne, allusion au nom hollandais de ce mari peintre. C'est un signe entre eux, pourrait-on dire : un aveu d'intimité. Il porte son regard sur elle, pour l'immortaliser par la peinture, et lui, qui est absent, de fait, qui n'existe plus alors que dans le nom qui signera ce traité d'éternité, vient s'inscrire dans l'œuvre, par le détail à la fois le plus symbolique (puisque ce signe existe comme chose -le feuillage-, désignation de la chose -le mot qu'on y associe-, et suggestion de l'artiste invisible -son nom propre masqué) et le plus futile, ce qui dépare un peu dans l'ensemble. Ainsi l'intime n'est pas si facile à dévoiler.
Puisqu'il s'agit bien d'un tableau privé, mise en scène d'un amour de l'un à l'autre, on comprend mieux la légèreté des mains qui jouent avec le collier. Est-ce une manière de souligner leur finesse ? Le jeu de ces perles, autour du poignet, glissant entre les doigts, en partie invisibles est-il lui-même la suggestion d'une union plus complexe que ne peuvent l'admettre les règles de la bienséance ? Doit-on penser à la théâtralisation en quasi forme d'ombre du désir et d'un certain art de l'amour ? Ce regard de biais, avec la paupière qui semble sur le point de se fermer, est-il celui d'un aveu, d'une invitation, malgré la sévérité du reste du visage ? Invitation dont lui seul, Van Dyck, peut mesurer l'étendue...
Tout cela est bien difficile à dire, parce que lorsqu'on se trouve devant ce tableau, au Prado, avant que d'en connaître le titre, le sujet, on penserait d'abord à quelque femme un peu acariâtre, pas très jolie, à l'air pimbêche... Ce n'est que dans un second temps, lorsque les mots se posent sur la peinture, que l'œil recompose autrement la scène, que l'on se projette dans le désir retenu de l'artiste. Où se tient le piège de cette dérangeante infirmité (relative certes) du regard, à plus de trois siècles de distance ? Les canons contemporains de la beauté rendent peut-être lady Ruthven moins attirante mais faut-il croire à cette explication, quand d'autres figures, plus anciennes -à commencer par celles du Caravage- éblouissent. Ne faut-il pas plutôt penser qu'en l'espèce notre esprit, malgré la rassurante idée qu'il sait ce qu'il regarde (c'est-à-dire qu'il est capable d'en donner le sens le plus imprécis qui soit : portrait d'une femme), manque à l'essentiel, qu'il se laisse prendre au piège de l'illusion du réel ? Serait-ce la preuve (ou l'expérience) que bien souvent nous venons moins nous confronter au mystère de l'art, avec toute l'humilité que requiert une œuvre, par principe nouvelle, que nous n'arrivons avec l'œil du dehors, celui d'un quotidien anesthésiant ? Et de ne plus réussir à deviner très vite ce qu'il y a de suggestif dans la dissimulation, d'intempestif dans le guindé, parce que nous sommes d'un monde racoleur, de flamboyant dans le glacé (et la couleur du vêtement, sombre vers le bas, s'éclaire à mesure qu'il remonte vers la poitrine et le visage, comme une incandescence)...
De là, l'injustice faite l'épouse de Van Dyck, immortel amour en bleu, et plus encore à Van Dyck, dont nous n'avons pas compris sur le champ la passion modeste, habitués que nous sommes désormais aux preuves grandiloquentes et aux mots qui ne coûtent pas cher.