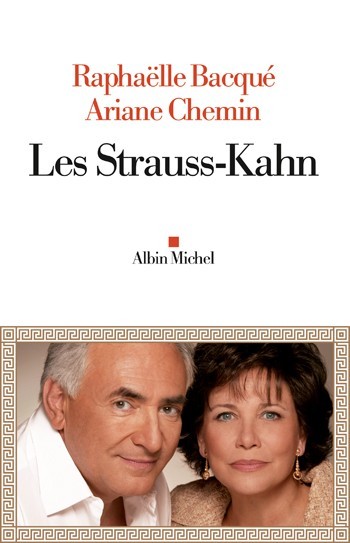Alors même que le volcan islandais clouait le voyage au sol, en avril 2010, le voyageur pénétrait dans l'antre du MoMA pour se retrouver, entre autres, dans une grande salle bruissant des interrogations visiteuses parce qu'en son centre une dame, avec des allures de prêtresse sanglante, assise, immuable, attendait que se succèdent les quidams qui viendraient fixement, silencieusement, la défier du regard.
Autour il y avait tout un appareillage technique, parce qu'on filmait ce qu'on appelle une performance. Les inconnus qui se prêtaient au jeu renonçaient à leur droit à l'image : ils participaient à une œuvre d'art, a work in progress. Dès lors, l'opportunité d'une petite éternité valait bien cet abandon.
Vous pouviez ainsi contempler cette plaisanterie pour autant que vous eussiez la patience et le ridicule de croire qu'il se passait, là, quelque chose sous prétexte qu'une institution en avait ainsi décidé. Et la première de ces institutions était l'artiste elle-même.
Elle s'appelle Marina Abramovic et elle n'en est pas à son coup d'essai en matière de provocation et d'apparent questionnement sur l'état et le devenir du monde. Il faut dire que ce genre de posture est devenu, dans le tournant de l'art (toujours en état d'être) contemporain, courant. C'est l'histoire du concept, dans le fond : une escroquerie à coup de "tu peux croire mon affaire obscure et confuse mais elle te dira plein de choses sur toi et ce qui t'entoure"... Pour cette expérience new yorkaise, elle avait intitulé cela "The artist is present". Pour le coup, elle ne mentait pas. Elle payait de sa personne : il n'est pas facile de rester ainsi immobile dans un monde qui a érigé la bougeotte en mode existentiel majeur. Sa rigidité de statue mérite le respect, cette mise en danger dans une confrontation avec l'inconnu force l'admiration. Souvent, on reproche à l'artiste d'être dans sa tour d'ivoire, de contempler le commun à distance, d'être élitiste. Dans cette expérience Marina Abramovic revient sur terre. On pourrait, de cette façon, enfiler les perles et ratiociner sur la profondeur de l'engagement. Seulement, la casuistique, comme toujours, a ses limites.
En fait, ce qui trouble tient d'abord au titre : "The artist is present". On aurait compris que cela s'intitulât "The woman is present", "The people is present", "we are present" (1). Point du tout : The artist is present. Titre où se mélangent le constat, c'est clair, et l'affirmation, pour ne pas dire la revendication. Nous sommes à la fois dans l'évidence et ce qui est censé la dépasser. Et de nous demander si, alors, il ne s'agit pas d'une épiphanie, une expérience quasi mystique. Ce fut une apparition... On connaît la suite : l'ironie y gagne ses galons d'art littéraire. Pour l'heure, au MoMA, nous en sommes loin. La phrase cingle d'abord comme une extension maximale d'un ego démesuré. Nous avions connu l'œuvre sans signature, l'œuvre signée (le tournant renaissant, quand Vasari se permet des biographies), l'œuvre pensée mais pas faite (le conceptuel). Nous en arrivons à l'artiste comme finalité et preuve de sa propre détermination. Plus rien à faire que d'être un nom. C'est bien au delà que n'importe quel happening. C'est le moi qui couvre toute la surface et devant lequel nous ne sommes que des supplétifs.
On méditera sur cette évolution narcissique et médiatique qui permet désormais à l'artiste (ou prétendu tel) d'être sa totalité servie sur un plateau (ou dans un film). Alpha et oméga du monde, il est là effectivement. Tout discours est superflu. Il nous donne à penser. Il est une incarnation de la pensée. En ces temps de scepticisme (au moins pour l'espace culturel occidental), cela laisse rêveur, que l'on puisse ainsi adhérer à une telle escroquerie car la présence de Marina Abramovic ferait rigoler les réelles présences de Georges Steiner. Il en va de ce monde qui substitue l'introspection et la pensée sur la longueur pour une immédiateté qui peut durer (et un quart d'heure devant le travail d'Abramovic semble une éternité).
Cette présence (fausse, artificielle) fait penser à son contraire : à un jeu sur l'absence possible dont Piero Manzoni, dans une autre époque, gratifia ses contemporains. En 1961, il proposa des boîtes de conserve contenant de la Merde d'artiste.

Il appartenait au mouvement de l'Arte Povera. Faire quelque chose avec peu. Et ici, il n'allait pas chercher bien loin. Il recyclait et proposait une part de lui-même. C'était aussi une question de présence. Fallait-il ouvrir la boîte pour vérifier l'annonce (et découvrir que ce n'était qu'un effet d'annonce...), ce qui revenait à détruire l'œuvre ? Fallait-il n'en rien faire et prendre acte, ce qui revenait à dire que dans ce cas-là l'artiste était en partie absent, puisque invisible ?
Ce genre d'interrogations est fort drôle, quand on en discute un soir, après avoir un peu bu, quand on cherche des solutions, un concept, pour atteindre la notoriété... Très drôle, parce qu'on peut avancer les solutions les plus farfelues. Mais au petit matin, après avoir cuvé, l'individu sérieux, et honnête, que n'agite pas l'illusion de la pompe à phynance (d'où peut surgir la merdre, dirait Jarry), en rigole et passe à autre chose. Il a mieux à faire que de se ridiculiser, comme Marina Abramovic.
(1)Et j'aurais eu envie de fredonner, par dérision, "we are the world"...