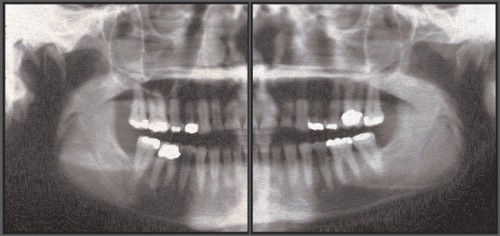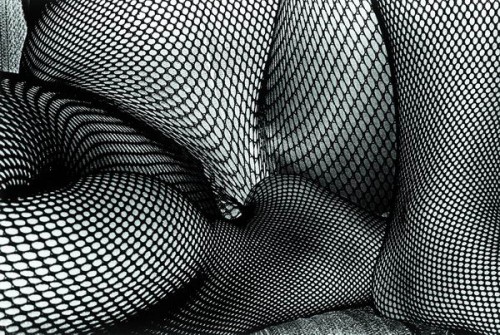Il s'appelle Tich Quang Duc. Il est bonze et le 13 juin 1963, en signe de protestation contre le régime de répression anti-bouddhiste instauré dans son pays, il s'immole par le feu. C'est un acte politique. Un engagement définitif et sans retour possible. La mort est au bout. On peut imaginer que tout religieux qu'il est, inscrit dans une longue tradition méditative, il n'ignore pas que le monde des images mondialisées est en marche, que de cette rue, son geste vont se multiplier, se répandre et que de ce point surgiront commentaires et discours.
A-t-il vu le photographe, Malcolm Browne, avant de s'asperger d'essence ? A-t-il su qu'il établissait avec lui une relation qui se prolongerait indéfiniment ? Possible, mais cela n'est pas décisif parce que, lancé qu'il est dans l'histoire de sa propre disparition, il en est réduit au pari (très pascalien) de l'autre comme œil témoin.
Il faut se contenter, plutôt, de regarder cette image-choc, de celles qui pétrifient le spectateur et le remplissent d'horreur. On éprouve, certes de façon purement symbolique, la souffrance de ce corps incandescent. On ne voudrait pas être à sa place. On se demande même à quel degré de désespoir ce bonze est tombé pour s'infliger une telle douleur. La force d'âme et l'oubli de soi ne sont pas des explications assez tenables pour qu'on ne puisse pas être démuni (1).
Je veux m'arrêter sur les choix du photographe. Un cliché découpe la réalité. S'il a un contenu, il a aussi des limites, des bords. S'il a deux dimensions, il a aussi une profondeur. S'il saisit ce qui lui est extérieur, il a toujours un angle de vue. La photographie est une prise : saisissement du réel, fragmentation du réel, déformation du réel.
Ici, Malcolm Browne, sans voyeurisme, dynamise la scène. Ses choix (conscients ou non) participent de l'empathie que peut éprouver le spectateur. Si le bonze est au centre du cliché, le choix du plan d'ensemble moyen oblige l'œil à faire le tour du lieu, et ce n'est pas rien. La route, la voiture (celle du bonze), les passants, le jerrican sont autant d'éléments qui servent deux objectifs. En les conservant, Browne définit le contexte et le contexte est un condensé de vérité (2). Tich Quang Duc n'agit pas hors du monde mais dans le monde. Le photographe ne veut pas qu'on faire abstraction de l'espace. Cela ne signifie pas qu'il transforme ce geste en spectacle, bien au contraire. La distance incluant l'entourage du bonze n'est justement pas un effet de distanciation, une protection plus ou moins affirmée mais la condition nécessaire pour que le spectateur s'incorpore le destin de cet homme. Les quelques mètres séparant le martyr de l'objectif (mètres qui partent aussi de toutes parts, avant, arrière-plan, côtés) marquent la continuité du monde. Des mondes pourraient-on dire : celui du bonze, dans cet espace oriental que nous ne sommes pas obligés de connaître mais que nous savons être là ; le nôtre, parce que cette voiture, ces passants, ce jerrican, nous les connaissons aussi pour savoir qu'ici aussi, nous pourrions en voir des exemplaires. C'est par cette moindre concentration autour du sujet violent que Browne replie l'horreur qu'il prend en photo sur notre propre monde, et ainsi en appelle à notre conscience. Cela s'est passé. Il y avait la vie qui tournait, des gens qui passaient. Pas de décor en feu, pas de trace de guerre, mais le quotidien. L'immolation est survenue et personne n'a bougé. La photographie, en fait, introduit la durée, et la durée est effrayante. Plus, peut-être, que l'action fixée sur l'argentique. L'instant capturé par l'appareil ne prend sa pleine valeur que si notre œil développe l'avant de la scène : les préparatifs, l'aspersion, l'installation, la mise à feu. Il n'est pas question de se faire un film, de jouer avec son imaginaire mais de ne pas pouvoir détourner son esprit (son œil intérieur...) de la rigueur logique par quoi un homme met fin atrocement à ses jours. Pas pour lui, mais pour les autres (et ces autres pourraient être nous). Malcom Browne ne s'en tient pas à la douleur de la crémation, c'est-à-dire à ce qui s'est poursuivi après le cliché ; il concentre tout le cheminement de l'homme à ses cendres.
À ce titre, le capot ouvert de la voiture et le jerrican sont essentiels à la compréhension du moment. Ils sont une mise en demeure à ce que nous ne nous méprenions pas sur le sens de ce que nous voyons. Ils sont les signes du temps écoulé qui nous amène à la combustion et au stoïcisme du bonze.
La photographie est prise de trois-quarts face. Impossible sans doute de faire face, de regarder dans les yeux la mort. Le corps est encore intact, comme s'il y avait incompatibilité entre le bonze et la flamme. Moment du corps toujours préservé et qui, donc, nous ressemble, et ressemble à ceux qui regardent. Solidarité de l'un pour les autres, identité des différences qui donne à la scène une allure de manifestation improvisée. Les autres, là, semblent comprendre. Ils partagent et cette longue flamme, au sol, est une part d'eux-mêmes. L'un prend sur lui la souffrance des autres, et le mouvement général du feu amène le spectateur à considérer la foule : des bonzes, qui entourent et respectent le geste. Browne fait comme eux, il devient l'un d'eux et nous, qui sait, l'un d'eux aussi.
Le caractère déchirant de cette photo tient à ce qu'elle rejette tout traitement héroïque du geste. Elle ne cherche pas à singulariser l'acte, tout en refusant de le banaliser. Browne prendra d'autres clichés, la crémation avançant. Ils ont moins de force que celui-ci, le premier de la série. Il aurait pu être le seul, parce que la suite on la connaît et doublement. Pour le geste, c'est la mort. Pour sa symbolique, c'est la misère des armes à la disposition des opprimés, qui espèrent une mobilisation, ailleurs, loin, à l'autre bout du monde, après eux, après n'être plus rien sur l'asphalte.

Le cliché de Browne a été repris près de trente ans plus tard, pour illustrer (le problème est déjà là : illustrer...) le premier album éponyme du groupe Rage against the machine. La comparaison est sans appel.
Le plan est serré, concentré sur l'étrangeté immatérielle du feu qui lèche le corps. Ce sont les flammes que l'on montre, avec l'illusion, presque, qu'elles viendraient de l'homme. Combustion spontanée. Acte sans origine, figé dans sa spectaculaire volatilité. Cela pourrait se passer n'importe où et n'importe quand. Ce qu'il faut, c'est que ça cogne, que dans une devanture, on ne l'oublie pas. Il faut que le nom du groupe récupère au maximum l'effet. C'est la deuxième mort du bonze Tich Trang Duc, sa réduction commerciale d'icône protestaire pour de petits musiciens popeux, pompeux qui nous feront croire qu'ils sont rebelles, forcément rebelles. Rage against the machine exploite la fascination de la violence, joue avec le feu, facilement, gratuitement. Le temps n'a plus de substance. On est dans le pur événement. Il a fallu zoomer sur le bonze. La photographie est moins nette. Un peu de flou qui synthétise tout. On a évacué le sens de l'acte. On en a fait un exemple, un signe quasi indépassable. Il y a, dans le fond, quelque chose de warholien dans ce choix : la même recherche de l'impact facile, la même lisibilité, la même rentabilité.
Cela peut impressionner l'âme sensible, donner du grain à moudre à ceux qui croient naïvement à la portée du message pop-rock. Laissons-les à leurs illusions
La dimension politique du rock, du rap, de la pop, etc. est, me semble-t-il, à l'image de cette différence symbolique. Un recadrage : tout est dit. Recadrer, comme des gosses, parce que derrière il y a la pompe à fric et tout le saint-frusquin. Bien des pochettes de musique commerciales jouent avec la provocation : sexuelle, gore, parfois politique. La liste est infinie. Celle de Rage against the machine est à mon sens la pire qui soit...
(1)Quoique des actes similaires de la part d'employés licenciés ou de chômeurs en fin de droit rendent aujourd'hui ce geste moins "hors de pensée". Il serait bon, dans tous les cas, de réfléchir à cette similitude. Certains diront pour se rassurer que ce sont des exceptions. D'autres feront le parallèle entre la guerre économique et la guerre tout court, l'oppression des rentabilités exponentielles et celles des armes et des prisons.
(2)On rappellera que Hitchcock ou G. Stevens, pour filmer les camps nazis, recommandaient des plans larges pour éviter les soupçons de manipulation.