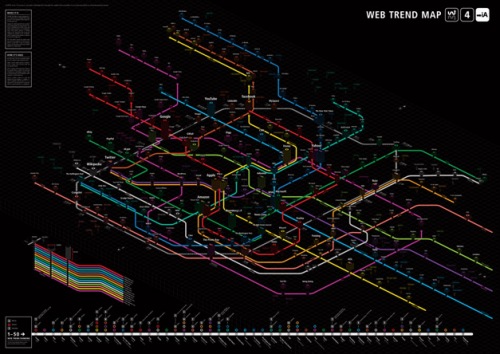L'État des choses est le dernier film de Wenders qu'on ait envie de regarder. C'est plus qu'une envie : une nécessité, un impératif esthétique doublé d'une langueur pleine d'humanité. L'argument scénaristique est mince, d'une certaine manière. Un film en tournage au Portugal, sur la côte, à Cascais. Une histoire de survivants en quête d'un nouveau coin pour vivre. Encore quelques scènes avant que l'imparable n'arrive : il n'y a plus de pellicule, plus de fond. Le film s'arrête au bord de l'océan, dans un dédale hôtelier en déshérence. Chacun n'a plus qu'à passer son temps, entre ennui et désir froissé. Le film est lent, dans un noir et blanc fabuleux que l'on doit à Henri Alekan. On aimerait que le temps s'étire à l'infini et que les heures déliées de toute obstination se multiplient. Mais il faut bien que le film (dans le film) se continue et le réalisateur, Friedrich Munro, parte chercher de quoi rebondir. Il file aux États-Unis pour récupérer l'argent nécessaire auprès de son producteur.
On comprend vite que L'État des choses est une œuvre en abyme. Le cinéma est en miroir. Un certain état du cinéma, auquel Wenders tournera bientôt le dos (1). Le personnage principal est surnommé Fritz. On saisit l'allusion et quand il va à Hollywood, c'est l'étoile de Fritz Lang qui apparaît sur un plan. L'État des choses n'est pas un prolongement du Mépris : il en est la forme reconstruite. Quand, dans le premier tout s'achevait presque parodiquement (et Fritz Lang finit L'Odyssée), dans le second, tout s'achève définitivement. Dans le film de Godard, le cynique et imbécile Prokosch était encore un personnage visible et cherchant à paraître ; dans celui de Wenders, la menace économique est invisible. La puissance fait main basse sans montrer son visage.
Les huit dernières minutes du film sont centrées sur le tour en camping-car que font Fritz et son producteur escroc. Bavardages creux, faux détachement, risibles amitiés. On revient alors au point de départ.
Un coup de feu. Un homme s'écroule. Et la caméra au poing, comme un moyen de répondre. Un balayage sans objet, sinon la seule volonté de filmer, coûte que coûte, comme un témoignage. Une sorte de cinéma vérité grotesque, dont meurt évidemment le héros. Alors vient le plan fixe, au ras du sol, l'immobilité de l'objet dans la disparition induite du sujet. La caméra est là. La pellicule, celle qui manquait tant quand il avait des choses à dire, peut se dérouler maintenant qu'aucune main ne la tient.
C'est une scène spectaculaire, dont les trente ans sans la revoir, n'avait pas altéré la profondeur. Ce qui pouvait passer pour un effet un peu simpliste a pris entre temps une tout autre valeur. De même que la métaphore initiale de Cinecittà dans Le Mépris signifiait la mort prochaine du cinéma (ou du moins d'un certain cinéma), de même cette disparition de l'être et la possibilité de voir l'objet durer infiniment semblent prémonitoire de cette inexorable décomposition du réalisateur au profit des faiseurs techniciens. Fritz Munro pointe sa caméra, son ultime caméra, comme une arme alors même qu'il est désarmé. Il ne pense plus. Il est cyclopéen. Il n'est personne. Réduit à sa fonction scopique, il ne sait où regarder, ne sait que filmer. Il ne voit plus rien. Sa caméra erre. Et on se dit que bien des prétendants au titre de réalisateur, ces trente dernières années, ne valent même pas ce balayage.
En revoyant ce si beau film, si beau que vous oubliez la suite de Wenders, et vous ne lui en tenez pas rigueur : n'eût-il fait que ce film que vous lui en seriez reconnaissant, en le revoyant, on perce une partie (une partie seulement) du mystère qui, au-delà de la nostalgie, peut nous attacher à des images fortes. Elles sont à la fois souvenir, reste d'une présence jamais effacée, et présage, ce qui nous aide à un peu plus de lucidité, laquelle lucidité se paie, mais cela, c'est une autre histoire.
(1)À moins de considérer le pitoyable Paris Texas comme une réussite. Wenders passe à la couleur et c'est fini. Quand il y reviendra, dans Les Ailes du désir, le charme et la profondeur auront disparu. Ne demeurera que l'exercice de style.