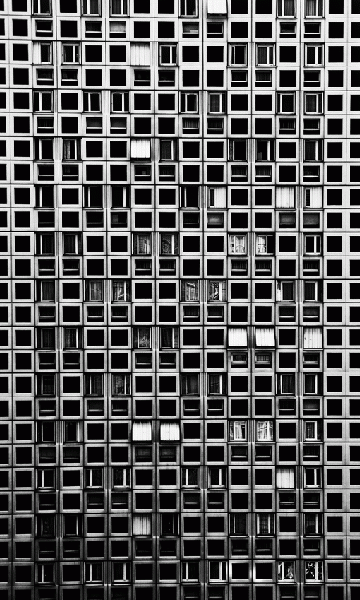L'été dernier, la place Clichy était en travaux. C'est un endroit qui n'a aucun intérêt. Ni majestueuse, ni singulière. Un de ces lieux dont on ne souviendrait sans doute pas si ne s'y associaient deux oeuvres littéraires majeures du XXe siècle français, écrites par deux auteurs qu'à plus d'un titre tout opposerait : Louis-Ferdinand Céline et Georges Perec. Voyage au bout de la nuit et L'Homme qui dort. Le premier roman est publié en 1932, le second en 1967. Entre temps, la débandade d'un continent et les pires atrocités. Y a-t-il une continuité dans l'Histoire, celle dont Perec écrit qu'elle s'impose avec sa grande Hache ? Faut-il envisager ainsi,dans une cohérence implacable, la désagrégation de l'Europe à partir de la Grande Guerre jusqu'aux prémices d'une logique de crise qui, depuis le milieu des années 70 nous a installés dans une angoisse permanente tant sur le plan économique que social et politique ? En relisant ces deux romans, on cerne, sous-jacente, la même fracture, dans laquelle les individus courent peu à peu à leur perte.
Le Voyage commence place de Clichy, dans une sorte d'enthousiasme illusoire avec laquelle Céline joue à merveille. Le lecteur sait de quoi il retourne. La guerre, la fleur à la bouche, est une mystification dont s'est nourrie l'opinion publique. Bardamu incarne, d'une certaine manière, la puissance aveugle de la reconquête : les boches vaincus, l'Alsace-Lorraine revenue dans le giron de la mère-patrie. Bonne blague. Toutes les pérégrinations, toutes les aventures du monde n'y pourront rien. Les tranchées monstrueuses et le dépucelage de l'horreur inaugure une odyssée dans le désordre. Les épisodes africain et américain ne démentiront rien. Le retour en France conclut cette expérience du pire. La place Clichy est donc le point symbolique d'où se déploie toute la violence visible du monde. Le héros se lance dans le mouvement et comme un principe centrifuge dévastateur tout valdingue. Il ne sait pas ce qui l'attend, ou plutôt il essaie de ne pas trop y penser. Son cynisme n'y résiste pas. On pourrait dire, d'une certaine manière, que cet endroit est celui autour duquel toute son existence s'était jusqu'alors réduite. Avant, rien. Après, c'est autre chose (soit : une différence mais aussi un désarroi qui progressivement sera sans contrôle...).
Le héros de Perec, lui, ne bouge pas. Il est l'incarnation d'une inertie quasi maladive. Quand Bardamu entre, peut-être malgré lui, dans le cours de l'Histoire, l'homme qui dort regarde s'effondrer le sens de cette Histoire. Quand Bardamu rejoint la tradition picaresque, l'homme qui dort continue celle du roman psychologique, d'une certaine façon, sauf qu'ici la psychologie est une sorte d'outre percée par laquelle le sujet (qui tend à devenir l'objet de ses propres apories) se disperse. L'homme qui dort n'est pas des Esseintes. Il n'a pas pour se protéger la misanthropie aristocratique se réfugiant dans l'art. Il n'est pas hors du monde ; il ne peut pas l'être. Bien au contraire : sa lente évolution l'amène à une décomposition de la volonté et du désir telle que rien ne peut plus le sauver. Son indifférence est l'aboutissement d'une porosité de l'être jusqu'à la dissolution dans un tout qui l'écrase, qui le conduit à n'être plus qu'un ectoplasme. Dissolution de l'être ouvrant l'étrange sensation que cet homme pourrait être aisément réarmé. La transparence qu'évoque Perec n'est qu'un moment, une pause dans une processus dont on imagine qu'il pourrait s'avérer redoutable. L'homme qui dort n'est pas Meursault : il est dans un en-deçà de la violence inquiétant. Et Perec conclut donc l'histoire place Clichy. L'histoire ou l'Histoire ? Pour le fils de juifs disparus pendant la guerre (et la mère notamment, jamais revenue des camps), cette angoisse de la disparition est essentielle. Double disparition : celle physique bien sûr, mais celle aussi d'une conscience à même de concevoir l'autre disparition, la première, celle, irrémédiable, qui nous lie, dès le départ, à la mort. Perec avait déjà donné un aperçu de cette abyssale terreur deux ans auparavant en publiant Les Choses. Mais à la frénésie consumériste succède déjà la glaciation d'un univers qui échappe à celui qui le contemple. Et l'histoire (comme récit) échappe à son auteur place de Clichy.
L'écho à l'épopée célinienne est évidente. Il y a ainsi entre l'enthousiasme belliciste, moteur de l'action (et de l'écriture...), et l'indifférence glacée une parenté. Ce ne sont, peut-être, que les modalités variables d'une même horreur enfouie dans l'homme. La marotte bifrons de notre capacité à la violence. Et l'insistance avec laquelle Perec creuse la thématique du détachement renvoie aux pires heures d'une Histoire commune, pendant lesquelles les individus détournèrent le regard, par lâcheté, sans doute, par peur, évidemment, par désir aussi, pour certains que tout finisse par retrouver sa place. Parce que pour eux la catastrophe avait commencé bien avant : dans un temps où justement ils auraient pu être place de Clichy (mais ils étaient ailleurs, et c'était parfois la place du village, la place de l'Eglise), comme Bardamu, prêts à tout, confiants et guerriers d'abord, habités de néant ensuite, disposés désormais à une indifférence salvatrice.
Lire (ou relire) ces deux romans, dans un effet de miroir, est une expérience qui en révèle bien plus sur nos failles et nos limites que toutes les pages de sociologie fondées sur la statistique. Ils portent en eux une vérité advenant certes par des chemins fort différents, en des temps bien distincts, mais qui, dans le fond, répercutent le même scepticisme sur la capacité de l'homme au bien. Le mal règne : par désespoir, par peur, par omission, nous y adhérons. Il a littérairement un lieu fétiche (comme la gare de Perpignan était pour Dali le centre du monde) : la place de Clichy...
Incipit du Voyage au bout de la nuit.
"Ça a débuté comme ça. Moi, j'avais jamais rien dit. Rien. C'est Arthur Ganate qui m'a fait parler. Arthur, un étudiant, un carabin lui aussi, un camarade. On se rencontre donc place Clichy. C'était après le déjeuner. Il veut me parler. Je l'écoute. " Restons pas dehors ! qu'il me dit. Rentrons ! " Je rentre avec lui. Voilà. " Cette terrasse, qu'il commence, c'est pour les oeufs à la coque! Viens par ici ! " Alors, on remarque encore qu'il n'y avait personne dans les rues, à cause de la chaleur ; pas de voiture, rien. Quand il fait très froid, non plus, il n'y a personne dans les rues ; c'est lui, même que je m'en souviens, qui m'avait dit à ce propos : " Les gens de Paris ont l'air toujours d'être occupés, mais en fait, ils se promènent du matin au soir ; la preuve, c'est que lorsqu'il ne fait pas bon à se promener, trop froid ou trop chaud, on ne les voit plus ; ils sont tous dedans à prendre des cafés crème et des bocks. C'est ainsi ! Siècle de vitesse ! qu'ils disent. Où ça ? Grands changements ! qu'ils racontent. Comment ça? Rien n'est changé en vérité. Ils continuent à s'admirer et c'est tout. Et ça n'est pas nouveau non plus. Des mots, et encore pas beaucoup, même parmi les mots, qui sont changés ! Deux ou trois par-ci, par-là, des petits... " Bien fiers alors d'avoir fait sonner ces vérités utiles, on est demeuré là assis, ravis, à regarder les dames du café.
Après, la conversation est revenue sur le Président Poincaré qui s'en allait inaugurer, justement ce matin-là, une exposition de petits chiens ; et puis, de fil en aiguille, sur Le Temps où c'était écrit. " Tiens, voilà un maître journal, Le Temps ! " qu'il me taquine Arthur Ganate, à ce propos. " Y en a pas deux comme lui pour défendre la race française ! - Elle en a bien besoin la race française, vu qu'elle n'existe pas ! " que j'ai répondu moi pour montrer que j'étais documenté, et du tac au tac.
- Si donc ! qu'il y en a une ! Et une belle de race ! qu'il insistait lui, et même que c'est la plus belle race du monde, et bien cocu qui s'en dédit ! Et puis, le voilà parti à m'engueuler. J'ai tenu ferme bien entendu.
- C'est pas vrai ! La race, ce que t'appelles comme ça, c'est seulement ce grand ramassis de miteux dans mon genre, chassieux, puceux, transis, qui ont échoué ici poursuivis par la faim, la peste, les tumeurs et le froid, venus vaincus des quatre coins du monde. Ils ne pouvaient pas aller plus loin à cause de la mer. C'est ça la France et puis c'est ça les Français.
- Bardamu, qu'il me fait alors gravement et un peu triste, nos pères nous valaient bien, n'en dis pas de mal !...
- T'as raison, Arthur, pour ça t'as raison ! Haineux et dociles, violés, volés, étripés et couillons toujours, ils nous valaient bien ! Tu peux le dire ! Nous ne changeons pas ! Ni de chaussettes, ni de maîtres, ni d'opinions, ou bien si tard, que ça n'en vaut plus la peine. On est nés fidèles, on en crève nous autres ! Soldats gratuits, héros pour tout le monde et singes parlants, mots qui souffrent, on est nous les mignons du Roi Misère. C'est lui qui nous possède ! Quand on est pas sages, il serre... On a ses doigts autour du cou, toujours, ça gêne pour parler, faut faire bien attention si on tient à pouvoir manger... Pour des riens, il vous étrangle... C'est pas une vie...
- Il y a l'amour, Bardamu !
- Arthur, l'amour c'est l'infini mis à la portée des caniches et j'ai ma dignité moi ! que je lui réponds.
- Parlons-en de toi ! T'es un anarchiste et puis voilà tout !
Un petit malin, dans tous les cas, vous voyez ça d'ici, et tout ce qu'il y avait d'avancé dans les opinions.
- Tu l'as dit, bouffi, que je suis anarchiste ! Et la preuve la meilleure, c'est que j'ai composé une manière de prière vengeresse et sociale dont tu vas me dire tout de suite des nouvelles : LES AILES EN OR ! C'est le titre !... Et je lui récite alors :
Un Dieu qui compte les minutes et les sous, un Dieu désespéré, sensuel et grognon comme un cochon. Un cochon avec des ailes en or qui retombe partout, le ventre en l'air, prêt aux caresses, c'est lui, c'est notre maître. Embrassons-nous !
- Ton petit morceau ne tient pas devant la vie, j'en suis, moi, pour l'ordre établi et je n'aime pas la politique. Et d'ailleurs le jour où la patrie me demandera de verser mon sang pour elle, elle me trouvera moi bien sûr, et pas fainéant, prêt à le donner.
Voilà ce qu'il m'a répondu.
Justement la guerre approchait de nous deux sans qu'on s'en soye rendu compte et je n'avais plus la tête très solide. Cette brève mais vivace discussion m'avait fatigué. Et puis, j'étais ému aussi parce que le garçon m'avait un peu traité de sordide à cause du pourboire. Enfin, nous nous réconciliâmes avec Arthur pour finir, tout à fait. On était du même avis sur presque tout.
- C'est vrai, t'as raison en somme, que j'ai convenu, conciliant, mais enfin on est tous assis sur une grande galère, on rame tous à tour de bras, tu peux pas venir me dire le contraire !... Assis sur des clous même à tirer tout nous autres ! Et qu'est-ce qu'on en a ? Rien ! Des coups de trique seulement, des misères, des bobards et puis des vacheries encore. On travaille ! qu'ils disent. C'est ça encore qu'est plus infect que tout le reste, leur travail. On est en bas dans les cales à souffler de la gueule, puants, suintants des rouspignoles et puis voilà ! En haut sur le pont, au frais, il y a les maîtres et qui s'en font pas, avec des belles femmes roses et gonflées de parfums sur les genoux. On nous fait monter sur le pont. Alors, ils mettent leurs chapeaux haut de forme et puis ils nous en mettent un bon coup de la gueule comme ça : " Bandes de charognes, c'est la guerre ! qu'ils font. On va les aborder, les saligauds qui sont sur la patrie n° 2, et on va leur faire sauter la caisse ! Allez ! Allez ! Y a de tout ce qu'il faut à bord ! Tous en choeur ! Gueulez voir d'abord un bon coup et que ça tremble : " Vive la Patrie n° 1 ! " Qu'on vous entende de loin ! Celui qui gueulera le plus fort, il aura la médaille et la dragée du bon Jésus ! Nom de Dieu ! Et puis ceux qui ne voudront pas crever sur mer, ils pourront toujours aller crever sur terre où c'est fait bien plus vite encore qu'ici ! "
- C'est tout à fait comme ça ! que m'approuva Arthur, décidément devenu facile à convaincre.
Mais voilà-t-y pas que juste devant le café où nous étions attablés un régiment se met à passer, et avec le colonel par-devant sur son cheval, et même qu'il avait l'air bien gentil et richement gaillard, le colonel ! Moi, je ne fis qu'un bond d'enthousiasme.
- J'vais voir si c'est ainsi ! que je crie à Arthur, et me voici parti m'engager, et au pas de course encore.
- T'es rien c... Ferdinand ! qu'il me crie, lui Arthur en retour, vexé sans aucun doute par l'effet de mon héroïsme sur tout le monde qui nous regardait.
Ça m'a un peu froissé qu'il prenne la chose ainsi, mais ça m'a pas arrêté. J'étais au pas. " J'y suis,- j'y reste ! " que je me dis.
- On verra bien, eh navet ! que j'ai même encore eu le temps de lui crier avant qu'on tourne la rue avec le régiment derrière le colonel et sa musique. Ça s'est fait exactement ainsi.
Alors on a marché longtemps. Y en avait plus qu'il y en avait encore des rues, et puis dedans des civils et leurs femmes qui nous poussaient des encouragements, et qui lançaient des fleurs, des terrasses, devant les gares, des églises: II y en avait des patriotes ! Et puis il s'est mis à y en avoir moins des patriotes... La pluie est tombée, et puis encore de moins en moins et puis plus du tout d'encouragements, plus un seul, sur la route.
Nous n'étions donc plus rien qu'entre nous ? Les uns derrière les autres ? La musique s'est arrêtée. " En résumé, que je me suis dit alors quand j'ai vu comment ça tournait c'est plus drôle ! C'est tout à recommencer ! J'allais m'en aller. Mais trop tard ! Ils avaient refermé la porte en douce derrière nous les civils. On était faits, comme des rats.
Excipit d'Un Homme qui dort :
"Nulle malédiction ne pèse sur tes épaules. Tu es un monstre, peut-être, mais pas un monstre des Enfers. Tu n’as pas besoin de te tordre, de hurler. Nulle épreuve ne t’attend, nul rocher de Sisyphe, nulle coupe ne te sera tendue pour t’être aussitôt refusée, nul corbeau n’en veut à tes globes oculaires, nul vautour ne s’est vu infliger l’indigeste pensum de venir te boulotter le foie, matin, midi et soir. Tu n’as pas à te traîner devant tes juges, criant grâce, implorant pitié. Nul ne te condamne et tu n’as pas commis de faute. Nul ne te regarde pour aussitôt se détourner de toi avec horreur.
Le temps, qui veille à tout, a donné la solution magré toi.
Le temps, qui connait la réponse, a continé de couler.
C’est un jour comme celui-ci, un peu plus tard, un peu plus tôt, que tout recommence, que tout commence, que tout continue.
Cesse de parler comme un homme qui rêve.
Regarde ! Regarde-les. Ils sont là des milliers et des milliers, sentinelles silencieuses, Terriens immobiles, plantés le long des quais, des berges, le long des trottoirs noyés de pluie de la place Clichy, en pleine rêverie océanique, attendant les embruns, le déferlement des marées, l’appel rauque des oiseaux de la mer.
Non. Tu n’es plus le maître anonyme du monde, celui sur qui l’histoire n’avait pas de prise, celui qui ne sentait pas la pluie tomber, qui ne voyait pas la nuit venir. Tu n’es plus l’inaccessible, le limpide, le transparent. Tu as peur, tu attends. Tu attends, place Clichy, que la pluie cesse de tomber."
(les blancs entre les paragraphres sont d'origine)