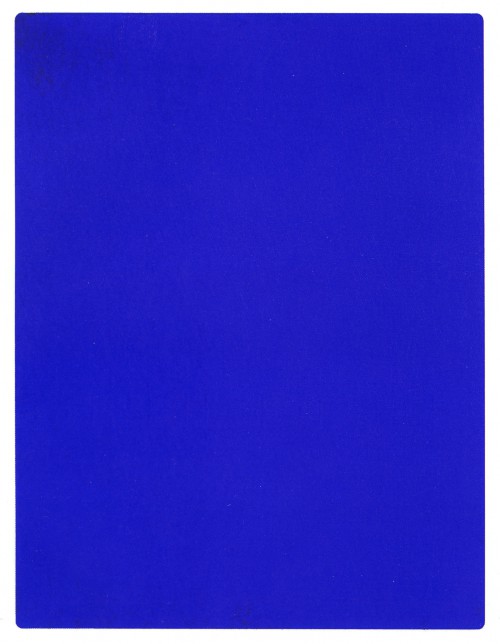Je ne connais pas Philippe Ridet. Je n'ai rien contre lui. Je pourrais éventuellement envier le fait qu'il vive à Rome, c'est tout. Il est le correspondant du Monde dans la Ville éternelle.
Ce n'est pas l'homme qui m'intéresse mais la fonction, et dans la fonction la posture implicite qui se dévoile, et qui me paraît refléter l'hypocrisie majeure de l'univers médiatico-journalistique.
À la suite des résultats électoraux de la fin février, dont les faits les plus remarquables (ceci écrit sans jugement de valeur) sont l'insubmersibilité de Berlusconi, l'émergence du mouvement protestaire de Beppe Grillo, la défiance envers la social-démocratie et le rejet de la politique « technique » de Monti, à la suite de ce grand chambardement, le sieur Ridet s'est fendu d'une lettre à ses amis italiens : « Chers amis italiens, cette fois, vous avez fait fort », en date du 4 mars, consultable sur le site du Monde.fr...
On sait quelle forme prend l'amitié, le plus souvent, dans ce genre de circonstances. C'est moins une déclaration d'amour que l'expression d'un dépit. L'auteur se place délibérément dans le registre de l'affect, ce qui ne laisse d'étonner quand on fait du journalisme. Les humeurs ont-elles leur place à cet endroit ? Oui, si un espace y est clairement dévolu. J'ai plus de doute, quand le geste procède des circonstances. Les sentiments de Philippe Ridet, ou d'un autre journaliste, m'importent peu. Ils sont même la dernière chose que j'attends de lui (1).
Il n'est pas question de faire une analyse exhaustive de l'objet. Je renvoie à sa lecture complète toujours possible. Je m'en tiendrai à deux pièces symptomatiques.
Après avoir rappelé combien il aimait l'Italie, ses singularités, sa culture, ses mœurs, l'espace et les gens, Ridet finit par écrire que devant les résultats de février, il est «en colère». Monsieur Ridet est en colère ! Fâché tout rouge, il est ! Il avait jusqu'alors supporté beaucoup de l'inconséquence transalpine mais cette fois, ils sont allés trop loin ! Ils lui ont déplu ! Ils n'ont pas fait ce que lui, le sieur Ridet, attendait d'eux. On peut difficilement faire plus fort dans le registre de l'outrecuidance. Il aurait donc fallu, du moins peut-on le supposer, qu'avant d'aller aux urnes, les citoyens italiens consultassent la lumière Ridet afin de rester dans les clous. Le journaliste se fait donneur de leçon. Au-dessus de la mêlée, il est la voix de la sagesse devant le désordre ambiant. Cela rappellera au lecteur, je pense, les cris d'orfraie de la caste journaleuse au moment du vote, en 2005, pour (et plutôt contre) la Constitution européenne. La petite phrase de Ridet n'est pas une erreur, une faute de style, pas un excès de langage : elle est la trace de ce droit que s'est arrogé le monde journalistique face aux événements. Ils sont progressivement devenus des « généraux sans armée qui voudraient s'assujettir le monde » (Musil).
Dans le cas d'un vote, on s'étonne. À moins de considérer que Ridet, comme d'autres de son espèce, ait une conception assez étroite de l'expression démocratique... Celle-ci ne serait plus un droit au choix mais un devoir à voter comme il faut ! Magnifique perspective ! Concernant le vote d'un pays étranger, on frise le délire d'ingérence. Depuis quand puis-je être en colère pour un vote où je ne suis pas moi-même pas impliqué (2) ? Quand la Russie vote Poutine, l'Espagne Rajoy, le Royaume-Uni Cameron, les États-Unis Obama, je dois être en mesure, si je suis journaliste, d'en analyser les motivations, les conditions et les effets, nullement de traiter le choix des autres en termes épidermiques. Mais la caste journalistique, dans la bulle médiatique hypertrophiée où elle opère, s'est persuadé qu'elle savait mieux que tout le monde. En regard de cet effet, elle a substitué à la pensée le sentiment et la croyance. Elle s'est forgé une légitimité dont elle assure elle-même la promotion. Philippe Ridet peut exprimer sa colère, sa colère être publiée comme une information, comme un sens face aux contre-sens démocratique, et nul n'y voit un excès de pouvoir, la prétention d'un ballon de baudruche.
Cet artifice égocentrique ne serait rien s'il ne célait un problème bien plus grave, une terreur intellectuelle plus funeste.
Le sieur Ridet est en colère devant les dérives populistes du vote italien. Et par populisme, il désigne deux directions contradictoires : le refuge berlusconien et ses alliés de la Ligue du Nord ; le vote protestataire du M5S de Beppe Grillo. Un populisme de droite et un populisme de gauche. Il y aurait lieu, déjà, de contester ces démarcations et l'usage qui s'est répandu de voir du populisme partout, avec en toile de fond la préfiguration du fascisme.
Comme souvent, c'est dans ce qui est dénié mais écrit que la vérité indicible affleure. Ainsi le journaliste fait-il le tour du malaise de l'élection transalpine :
«Voici les politologues et les sociologues (ainsi qu'une armée de journalistes) au chevet de l'Italie. Tous ont cerné une partie du problème : la crise (- 2,4 % de croissance selon le dernier chiffre), la baisse du pouvoir d'achat (- 4,3 % de consommation), le chômage (11,2 % de la population active), l'austérité imposée par Bruxelles et Francfort (300 milliards d'euros d'économie et de taxes nouvelles jusqu'en 2014). Ces experts ont écouté vos plaintes sur la corruption, sur la "caste des élus" et ses privilèges. J'ai aussi parlé avec des jeunes diplômés qui n'en peuvent plus de cette gérontocratie qui s'accapare les postes. Avec des retraités qui, chaque premier du mois, font la queue à la poste pour une pension de moins de 1 000 euros.»
Devant ce constat d'un délabrement profond tant politique, économique, social que culturel, il tire la conséquence logique pour lui que la raison démocratique doit trouver sa voix dans une confiance nécessaire en la social-démocratie. Devant le tableau de la démocratie transalpine déliquescente, il est plus qu'urgent et censé de s'en remettre à ceux qui ont été les fossoyeurs de la démocratie :
«Partout ailleurs, le résultat aurait été couru d'avance. Mais vous, vous avez bien failli élire le premier pour une quatrième fois (il s'en est fallu de 150 000 voix à la Chambre), vous avez éliminé l'économiste qui, il est vrai, vous avait assommés d'impôts, et vous avez probablement empêché le social-démocrate de devenir un jour président du conseil.»
Ce n'est même pas la reprise de la formule du comte Salinas (« Il faut que tout change pour que rien ne change »). Ridet pose comme acte raisonnable : « il faut que rien ne change pour rien ne change ». Peut-il envisager, soit : faire entrer dans le périmètre intellectuel de son analyse, hors des beaux quartiers romains, du Montecitorio, du Quirinale et du Palazzo Madama, que c'est le cadre désolant lui-même dans lequel évolue le peuple italien qui le pousse à récuser la social-démocratie. Les voix de Beppe Grillo sont le fruit des compromissions, du népotisme, des concussions, des ententes mafieuses, etc. Demander à ce que ces voix se taisent, c'est non seulement absoudre les fautifs mais aussi culpabiliser les électeurs sans autre forme de procès.
Le vote, à tort ou à raison, est pour certains le dernier moyen de s'y retrouver, de ne pas sombrer. Exiger qu'ils fassent comme si de rien n'était, telle est l'escroquerie morale et intellectuelle qui couvre l'indignation du sieur Ridet. Moraliste saumâtre qui demande aux pauvres, en plus de leur misère, d'être irréprochables. Robespierre dénonçait déjà ce travers bourgeois vis-à-vis de la populace : la misère et en plus la vertu.
Le vote dit protestataire n'est pas le fait d'une tension épidermique mais l'endroit d'une faillite qu'on ne veut pas reconnaître comme faillite. Et si l'on veut, pour un temps, revenir en France, c'est sur le même mode que l'on considère le soutien au Front national ou à Mélenchon. Un geste de mauvaise humeur, des relents fascistes, xénophobes, poujadistes, etc., alors qu'on ne veut pas voir que les partis de gouvernement se caractérisent par leur pourrissement (3). Or, de ce pourrissement-là, il n'est jamais question. C'est une abstraction ! Les belles âmes ne veulent pas croire qu'il puisse bouleverser l'électorat et l'engager hors des sentiers de la social-démocratie libérale, version eurocrates bruxellois !
On peut toujours comme le sieur Ridet se draper de toutes les vertus. C'est facile ! Comme il est facile, et c'est mon cas, de se réfugier dans l'abstention, quand son statut de petit bourgeois, vivant bien, en milieu protégé, ne sait rien, ou si peu, de ce que sont les existences douloureuses des relégués du travail, du droit, et de la reconnaissance. Ceux-là même qui sont les rejetés de l'agora, et dont on voudrait, comme le réclame Ridet and co qu'ils votent juste. Voter juste, c'est-à-dire qu'ils votent bien, comme il faut, et qu'ils se contentent de cela, et qu'ensuite ils ferment leur gueule !
Que devant cette réalité, celle d'un vote désespéré (plus qu'il n'est désespérant : ce serait trop simple), un journaliste du Monde détourne le regard et joue les délicates du XVIIIe qui s'offusquent. Il est pitoyable, mais le pire est évidemment qu'il n'est pas un phénomène isolé. Il est en quelque sorte le modèle qu'on nous impose...
(1)On se souviendra de l'emportement ridicule de Mazerolles sur BFM au moment de l'élection du président de l'UMP.
(2)Je laisse de côté le débat ici secondaire du droit de vote accordé aux citoyens européens dans le cadre de l'EU.
(3)C'est Fillon qui parle, au sein de son parti, de pratiques mafieuses, pas moi. C'est le PS dont les fédérations les plus importantes, Nord-Pas-de-Calais et Bouches-du-Rhônes, sont empêtrées dans des affaires désastreuses.
Photo : Gaëlle Josse.