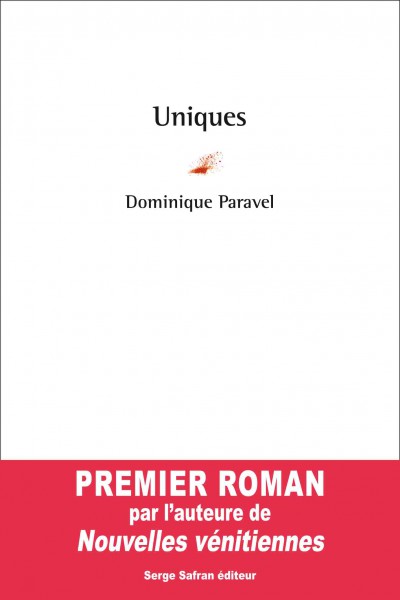Un article de Philippe Muray, de la fin des années 90, ridiculisait trente-et-un auteurs réunis par le journal Le Monde pour se dresser "face à la haine" (1). Beau programme philanthropique où la littérature (ou ce qu'on présente telle) s'en allait, bonne fille un peu simple pour le coup, du côté de la mise en garde et de l'engagement massif (comme il y a des armes de destruction du même genre). Consternant, n'est-ce pas ? Écrire le bien sur commande (car il n'est pas interdit d'écrire ce qui pour soi est le bien, à la manière d'un Claudel ou d'un Bernanos par exemple...), agiter ses feuillets en pancartes révoltées. Le crétinisme a de beaux jours devant lui et l'an dernier il fleurissait de plus bel sous la main d'Annie Ernaux qui voulait à peu près qu'on pendît Richard Millet haut et court.
La lecture de Philippe Muray m'a donc ramené à la haine.
Peut-on faire l'éloge de la haine ? Non. Pas plus que celui de la vérité, du mensonge, de l'amour, du doute, de Dieu ou du diable. Et ce serait plus encore ridicule aujourd'hui, quand nos temps ténébreux ont substitué à la morale une politique du droit individuel qui doit s'étendre jusqu'aux endroits ultimes de notre existence. Dès lors, si l'on veut bien se conformer à la terreur en poste, celle de l'affect et de la subjectivité combinées (2), il faut simplement réclamer le droit à la haine.
Puisque la haine est un sentiment, puisque le sentiment est la matrice sans partage du moi contemporain, la haine est légitime, elle fait partie de mon droit inaliénable de Narcisse démocratique et il est attentatoire à ma liberté de me contredire sur ce point. Je ne vois guère ce que les droits-de-l'hommiste de la pensée pourraient trouver à y redire, à moins qu'ils ne soient à la fois juges et parties, discoureurs et policiers de la pensée, faux nez de la liberté et vrais godillots de l'encasernement soft...
Est-ce être méchant homme que d'écrire cela ? Est-ce honteux que de l'humanité abstraite et éparpillée je me moque éperdument ? Est-ce être un barbare que de connaître le mépris et de ne pas vouloir s'en départir ? Que ne pas se soucier du bien-être pour tous ?
Attaquer le droit à la haine revient à amputer autrui de son intériorité et de sa puissance créatrice.
Et tout à coup, une idée : il y aura bien trente-et-un nouveaux couillons pour dire non à la haine, pour dire non à Poutine, invectiver l'âme russe (ce qui au passage nécessitera qu'on brûle et Dostoïevski et Tolstoï, chez lesquels on trouve tant de pages russes, très, très russes : gageons que les combattants de la haine savent faire des autodafés) et chanter la liberté du marché, de l'OTAN, d'Obama qui s'assoit sur le droit des peuples à l'autodétermination.
Parce qu'on l'aura compris, le droit à la haine existe déjà : il est mondialisé et nous dirige sans vergogne.
(1)Dans Après l'histoire, "Homo festivus face à la haine", en date de mai 1998.
(2)Vous savez : tous les goûts se valent, sont dans la nature et ne se discutent pas.
Photo : Florentine Wüest