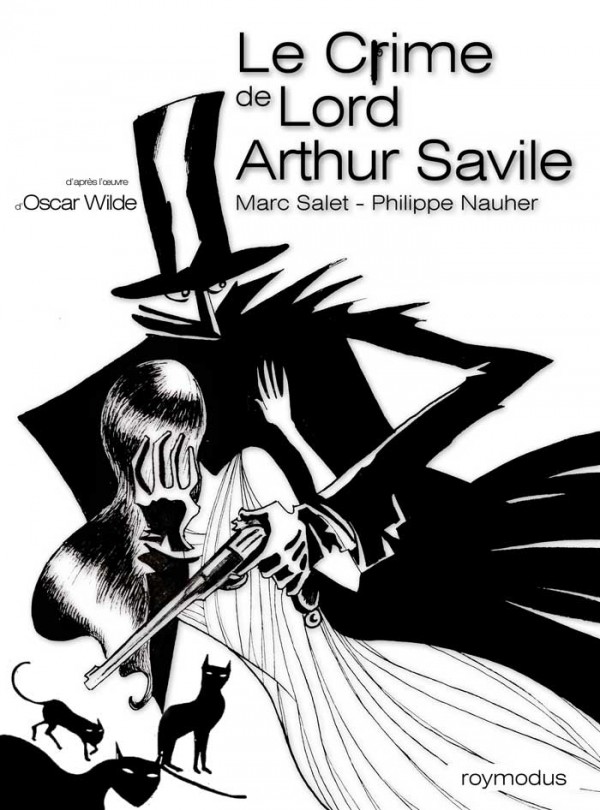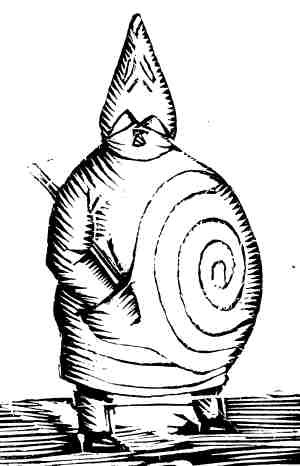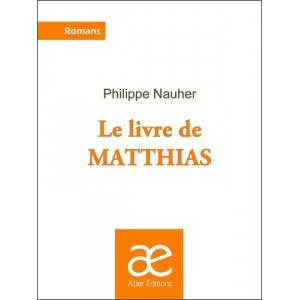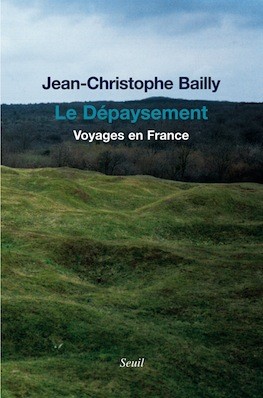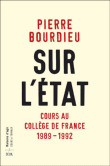Je n'ai pas pour Renaud Camus une passion littéraire inconsidérée mais dans le paysage désolant et consensuel de la littérature française (entre repenti post-colonial, gender studies dissimulées et avant-garde creuse), il n'est pas non plus, loin s'en faut, l'indigne écrivaillon dont on ferait des pages dithyrambiques pour vendre de la feuille. Ses positions que d'aucuns qualifieront de réactionnaires sont connues depuis longtemps. Il fait partie, avec Richard Millet, de ces écrivains non négligeables qui, devant l'extase cosmopolite, ont décidé depuis longtemps de faire entendre une voix/voie classique.
Sans doute est-elle trop hexagonale, trop peu dans l'air du temps. Mais je ne sache pas qu'il faille être à la pointe de la mode pour être un écrivain. Touours est-il que Renaud Camus a commis, et c'est son droit, un texte public dans lequel il défendait Marion Le Pen. On peut, et c'est mon cas (1), ne pas soutenir cet engagement sans pour autant vouer aux gémonies l'écrivain qu'il est. Parce que si l'on introduit le moralisme bourgeois dans l'historique de ce qui fait notre culture, il va falloir sérieusement faire le ménage, vu le nombre d'énergumènes qui la peuplent et qui feraient bondir les Homais de service, lesquels sont fort nombreux à mesure que se répand, à la place de l'instruction, une éducation fade, consensuel et petite-bourgeoise (2).
Prenons un exemple.
« Les éditions P.O.L et Fayard ont décidé de ne plus publier Renaud Camus après le soutien de celui-ci à Marine Le Pen (Le Monde, 19 avril). D’aucuns pleurnicheront encore sur une liberté d’expression qui s’amenuise… Or il faudrait rappeler que la liberté d’expression ne concerne pas seulement les auteurs, mais les éditeurs aussi : un éditeur a le droit de s’exprimer contre l’un de ses auteurs, de ne plus désirer publier un facho. »
Ainsi commence l'argumentaire, si toutefois le mot convient, du billet commis par Nelly Kaprièlan le 4 mai 2012 pour les Inrockuptibles. On appréciera le sophisme de la démarche qui consiste à utiliser la bonne méthode du paradoxe : la liberté tolère que l'on fasse taire les écrivains. Il y a un petit côté Saint-Just chez cette plumitive : pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Ce qu'elle n'aime pas, comme à peu près tous les enragés d'un camp ou de l'autre, c'est autrui, un autrui si différent, si problématique qu'elle le juge sectaire et dangereux. Dès lors, il faut le réduire au silence. Et l'on comprend bien que nous sommes, défenseurs (quoique le mot ne convienne pas) potentiels de Renaud Camus, toxiques et que nos objections relèvent de la niaiserie et de la sensiblerie : nous ne nous indignons pas (c'est bon pour Hessel et sa clique : ils se sont accaparé la dignité), nous ne contestons pas, nous pleurnichons. Magnifique rhétorique du mépris et de la suffisance qui passe fort bien, qui est même très tendance, puisqu'elle est de gauche. Encore que cela soit une approximation : il s'agit d'une certaine gauche, celle qui distribue le mone en deux camps. Elle-même et les fascistes, peu ou prou.
La défense des éditions P.O.L. est pathétique. Outre le fait que Nelly Kaprièlan revendique un droit à faire ce qu'on veut quand on veut, lequel ressort d'une pure logique libérale (mais il est vrai que les artistes et les écrivains ne sont pas protégés par les droits du travail. Ils ne travaillent pas ; ils créent (3)). On prend, on publie, on vire. Pathétique, dis-je, parce que les orientations de Renaud Camus, son amour de la France, sa défiance devant l'idéologie cosmopolite et différentialiste, tout cela ne date pas d'hier et ce n'est pas sa lettre de soutien à Marion Le Pen qui doit tromper son monde. Pour être cohérent, il aurait fallu le dénoncer depuis plus longtemps et en tirer les conséquences les plus élémentaires sur son éditeur : le dénoncer comme un éditeur de fachos, appeler à son boycott.
Cela fait fi évidemment de l'écriture de Renaud Camus (4). Mais il est vrai qu'il n'est pas très trash, très rock, très hype, Renaud. Pour le moins. Or, c'est ce qui importe à une culture clinquante et forcément moderne comme la promeut la revue. C'est ainsi qu'il y a des sujets qui ne peuvent plus porter, qui ne peuvent plus avoir de sens. La vindicte contre Renaud Camus va bien au-delà de son engagement lepéniste (encore que l'expression soit excessive (5)). Elle recouvre cette distinction définie à l'aube du XXe siècle, quand, sous prétexte des suites de l'affaire Dreyfus, s'opposèrent Barrès et Gide. Derrière cela, des orientations intellectuelles qui s'inscrivent dans l'espace : la campagne, le terroir, la tradition, le passé (ou ce que l'on tient pour tel) d'un côté, de l'autre, la ville, le mouvement, le mélange, le présent et l'avenir.
À partir de là, il faut choisir son camp. Du moins est-ce le diktat d'une contemporanéité qui n'a qu'un souci, c'est de liquider le passé. Au fond, il n'y a pas loin entre une plumitive des Inrocks et Sarkozy qui trouvait qu'on faisait chier le monde avec La Princesse de Clèves. Et c'est toujours très drôle (un peu affligeant aussi) de voir de tels amis s'étriper ainsi, quand ils ont sur la tradition culturelle la même vision méprisante.
Le retour de la gauche au pouvoir est donc inauguré par le renvoi de Renaud Camus sur ses terres. Pourquoi pas ? Le plus marquant, dans le papier de Nelly Kaprièlan, est le plaisir à peine dissimulé d'avoir obtenu la peau de celui dont l'intelligence aurait sans doute beaucoup à lui apprendre (mais c'est bien connu : chacun selon ses moyens...). Elle a eu son facho. Elle pourra, plus tard, le soir, à la chandelle, raconter sa guerre, son maquis d'écrivaillon, luttant tant et plus que le félon rendit gorge. Car il en fallait, sachez-le, pour obtenir des têtes telles que la sienne. Son éditeur P.O.L. s'obstinait. Enfin Hollande vint et son élection annoncée coupa le nœud gordien. Et tout fut paisible en ce beau pays de France (6).
(1)Autant l'écrire vite : les séides du Politburo sont prompts à faire de vous un fasciste. C'est d'ailleurs ce que détermine chez eux l'aphasie dont ils sont atteints. Le fasciste est l'autre qu'ils ne veulent pas prendre en charge, parce qu'il leur rappelle des souvenirs chinois ou cambodgiens, sans doute...
(2)Au loisir de chacun d'aller fouiller la biographie de Baudelaire, Flaubert, Chateaubriand, Caravage, Pasolini, Céline, Grass, Henri MIller, Genet, Maïakovski,
(3)C'est d'ailleurs au nom de cette capacité à la création ex nihilo qu'est célébré Lang, le héraut de la culture de gauche, et que fut, en 1992, attaqué Bourdieu pour avoir démenti de façon magistrale ce credo romantique ridicule, dans Les Règles de l'art. Mais Bourdieu n'était pas très... parisien.
(4)Comme la remarque incidente sur Richard Millet. Nelly Kaprièlan néglige la beauté classique de la langue et confond en une seule veine, sans doute, le polémiste de L'Opprobre et le prosateur magnifique des Sœurs Piale et de Ma Vie parmi les ombres.
Il est vrai que cette plumitive ne sait pas écrire : « Quant à Richard Millet, dont nous fûmes peu nombreux à nous ériger contre le racisme de ses livres,... ». Voilà ce qui s'appelle malmener la grammaire...
(5)On trouvera néanmoins un peu inutile et ridicule ce soutien. À quoi peut-il, en effet, correspondre ? Quel lien profond existe-t-il entre un esthète misanthrope comme Camus et l'idéologie frontiste ? Certains diront : la haine. Soit, mais ce serait un peu court car si la haine était circonscrite à l'extrême-droite, nous aurions quelque espoir de voir le monde s'améliorer...
(6)La dernière phrase est évidemment à rayer. Trop tradi, trop cul terreux, trop facho...
Les commentaires sont fermés.