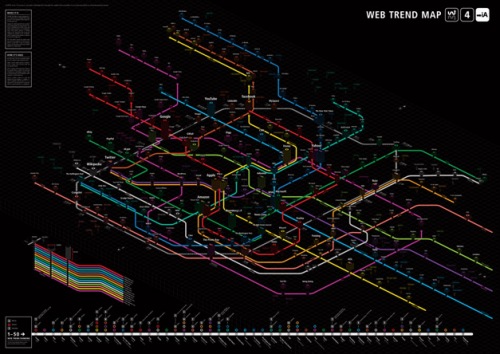C'est curieux, parfois, d'être loin, même si la distance est modeste. Mais simplement dans un endroit où la langue maternelle ne circule pas et qu'on ne fait pas attention aux kiosques à journaux, pour guetter des nouvelles de chez soi. D'être à l'étranger, et de trouver cette situation assez reposante, parce qu'elle n'a pas besoin d'éveiller en vous une tension, un mouvement d'indignation. Il y a comme une manière, même, de relativiser, d'ajouter une couche à la dérision de ce qu'on nous monte en épingle, qu'on nous fait prendre pour l'alpha et l'omega du monde, parce que nous ne cessons jamais d'être au centre, et de tracer des ronds autour de ce cœur hypertrophié. Pourquoi pas ?
Mais rire, donc, de suivre à la RAI la déconfiture politique jusqu'à l'extrême du jeu démocratique, de voir des gens débattre sur ce qu'il faudrait désormais engager comme réforme pour qu'on sorte de ce bourbier, et qu'un vulgaire Cavaliere puisse sans cesse être sur le retour, et que le premier parti péninsulaire soit aujourd'hui celui d'un comique qui vitupère, charge, crie, éructe en voulant renvoyer tout le monde a casa.
On s'engueule sur les plateaux télé, on réclame qui Monti, qui un nouveau vote, qui un gouvernement d'union nationale. C'est comme ici, le ici de chez vous, de chez moi. La duplication d'un air qu'on a connu. Seule la version change, je veux dire : la langue. Encore faudrait-il dire : l'idiome, car sur le fond, c'est la même langue de bois, la même putréfaction.
On hésite entre le désarroi, de cette classe politique à demeure alors qu'elle pue de tous ses pores, et le sentiment honteux qu'il s'agit d'un état général, que ce serait même, peut-être, le fondement de la démocratie : des crabes, une marée basse, la vase, des urnes...
Sur la RAI, c'est Grillo, le trublion, dont l'establishment attaque le populisme. Air connu qui rappelle à chacun des jours passés. Grillo, c'est, à certains égards, le Le Pen spaghetti. Pas le même bord, pas les mêmes idées (pour le si peu qu'il en développe), mais la même indignation contre lui des gens sérieux et responsables, ceux du déni démocratique de 2005, ceux de l'euro contre les peuples, ceux du parlement bidon à Strasbourg, ceux de l'espace Schengen, ceux du libéralisme à fond la caisse...

Sinon, il y a CNN, et là, c'est Benoît XVI resigns, avec vue sur la place Saint-Pierre, les dernières minutes pontificales, John Allen qui développe des hypothèses, le cardinal Dolan ironisant sur ses chances, de comiques journalistes s'interrogeant sur les chantiers du futur pape : le mariage des prêtres ?, l'ordination des femmes ?, et alors, dit l'un, pourquoi pas des femmes évêques, archevêques, cardinaux et... Celui-là a dû relire La Papesse Jeanne de Lawrence Durrell en buvant un double scotch.
On reste sérieux. Un homme se retire ; un homme qui a parlé au monde, qui parle encore au monde. Un vieil homme qui marche avec une canne, dont la diction est bien moins claire qu'il y a encore quelques mois, un homme annonçant sa révérence et son obéissance à celui qui lui succèdera, un homme ému au balcon de la résidence de Castel Gandolfo venant remercier les gens du lieu qui lui rendent hommage, leur parlant de ce qu'il est redevenu, « un simple pèlerin qui commence la dernière partie de son pèlerinage sur la terre » (1), avant de leur dire « bonne nuit ».
Chaque soir, CNN essaie de creuser le mystère de ce renoncement et ceux d'un chapître imprévu (et imprévisible) de l'Église catholique et du monde. Chapître dont n'ont évidemment rien à faire les illuminés gauchistes dont j'avais oublié la logorrhée libertaire. Car, d'une certaine façon, j'en suis là : la RAI et CNN, Grillo et Benoît XVI, en version originale, sur les manchettes de journaux, aussi, me reposent de toute cette lie gauchiste qui s'arroge le droit de dire le vrai et le faux, le juste et l'injuste, le bon et le mauvais, l'original et le passé, le moderne et le réactionnaire, la tendance et le croupissant.

Je les oublie jusqu'au dernier jour, quand, sur le chemin de la gare, je m'attarde devant un kiosque. Le Monde, Le Figaro, Libération. Libération : son titre et le haut d'un crâne. Je tire le journal pour savoir à qui est dévolu cette pleine page. Et, en une fraction de seconde, je les retrouve tels que je les avais laissés (sinon qu'alors c'était le visage de Marcelu Iacub...) : pathétiques et creux. Daniel Darc est mort. Paix à son âme. Le journal est lui plus en verve. Daniel Darc en ciel (2). Que ne feraient-ils pas pour un jeu de mots...

Je ris, évidemment. Pour les gens de ma génération, Daniel Darc, c'est un minois un peu efféminé, une musique composée sur un orgue Bontempi (après trois leçons, on pouvait se lancer), Cherchez le garçon, le titre qui a fait connaître son groupe. Daniel Darc, c'est Taxi Girl. Rien de mémorable, et sans doute n'en aurais-je qu'un souvenir vague si un ami, au lycée, ne jurait que par eux. Taxi Girl, c'est un titre, dans un format musical d'une médiocrité confondante. Une chanson, et on ferme. L'après Taxi Girl est une odyssée cahotique entre la drogue et les tentatives underground pour resurgir quelque part. C'est de la mythologie de midinette, comme on peut en fabriquer au kilo, au mètre ou à la page. Cela s'appelle pisser de l'encre.
Tout est dans la photo choisie, dans ce noir et blanc expressionniste, ce jeu facile et mille fois reproduit, d'un homme lumineux hanté par ses démons (3). La réactivation de l'artiste maudit.
Et puis, c'est revival, pour les uns, et nostalgiques pour les autres. Parce qu'il ne s'agit pas de se méprendre. Libération et ses troupes ne détestent pas la nostalgie. Loin de là. Mais dans ce domaine encore ils décrètent. Le portrait de Daniel Darc en une est une forme d'appropriation multiple du passé (passé proche, il faut le dire). Nos jeunes années, nos premières soirées, le retour des années 80 dans les soirées branchées (4), la contre-culture, le rejet des conventions et des normes. Il y a dans la récupération de ce visage (parce que je ne suis pas certain que l'intéressé eût apprécié...) une manière de définir ce qui mérite hommage, ce qui fait la culture, ce qui fait le monde, ce qui fait le contemporain. Libération a le droit d'être nostalgique, parce que sa nostalgie est propre, digne, respectable. Elle ne se construit dans la culture bourgeoise, s'entend ; sa nostalgie est jeune, libertaire, vivante, et elle compte bien plus que les vieux débris qui s'émerveillent encore de la littérature (5).
Le monde continue de s'entre-déchirer. La politique s'agite. Le désordre règne. Peu importe : une icône est morte. Pleine page ! Disons-le nettement : il y a comme un déficit dans la représentation. Aller chercher Daniel Darc pour faire la différence (6), c'est faire les fonds de tiroir. Il fallait vraiment ne pas faire un titre sur le départ de Benoît XVI.
C'est, en effet, sur ce plan que l'affaire se joue. Ce chanteur est mort au bon moment. Une affaire de timing. Pour occulter le visage du souverain pontife, pour faire que rien de lui ne soit visible. À la place, un artiste. N'importe lequel, pourvu qu'on puisse broder sur lui. Le lecteur moyen pouvait comprendre les unes sur Bashung ou Salvador, sur Yves Saint-Laurent ou Michael Jackson. Mais Daniel Darc... Mais il meurt le 28 février, le jour où Benoît XVI renonce...
Du coup, si l'on revient à la photo en une, on comprend mieux son choix. La croix tatouée. La vie tatouée à même la peau. Une spiritualité à même la peau. Pendant qu'un vieux con se barre à Castel Gandolfo, Libération (alleluia) nous offre une silhouette quasi christique. Un mec qui chante, qui vous chante, pas un has-been qui jacte en latin. Benoît XVI ou Daniel Darc : choisis ton monde, ta religion, ton temps...
Y a-t-il lieu de s'indigner ? Pas arrivé à ce point. Cela ressemble trop à ce qu'est devenu Libération : un repaire d'adolescents attardés qui voudraient assujettir le monde à leur fantasme libertaire. Ils veulent être les seuls à dire ce que doit être le monde. Staline demandait : « Le pape, combien de divisions ? ». Ils en sont encore là. Ils sont pathétiques de puérilité.
Mais le pire est que dans le marais du parisianisme, ils ont des appuis, et nombreux. Pas de doute que des gens bien, ouverts, à la nostalgie ciblée auront apprécié ce gimmick underground, cette ironie subtile (forcément subtile) qui efface le pape.
C'est une manière de populisme mondain, fier cul et arrogant. Ils peuvent baver sur Grillo, ils peuvent baver sur le pape. Je leur préfère, et de loin, et Grillo et le pape (le présent et celui à venir). Ils sont, pour détourner Pascal, « inutiles et incertains ».
(1)Ce qui nous vaut des traductions fausses, comme celle du Point qui écrit : « un simple pèlerin qui achève la dernière partie de son pèlerinage », ce qui n'est absolument pas la même chose. Passons...
(2)Réutilisable pour Mireille Darc...
(3)Pas lu une ligne de Libération, bien sûr, mais faut-il être grand clerc pour deviner ce qui s'y écrit.
(4)Mais sur un mode distancié. La distance est un fondement de la distinction sociale. Relire Bourdieu sur ce point. C'est l'accordéon de VGE.
(5)Libération fera-t-il une pleine page à la mort d'Yves Bonnefoy ? Je parie que non.
(6)Certain qu'une telle une, ni Le Monde, ni Le Figaro, ni La Croix, ni même Le Parisien n'y auraient pensé. Les Inrocks, oui... Mais Les Inrocks....