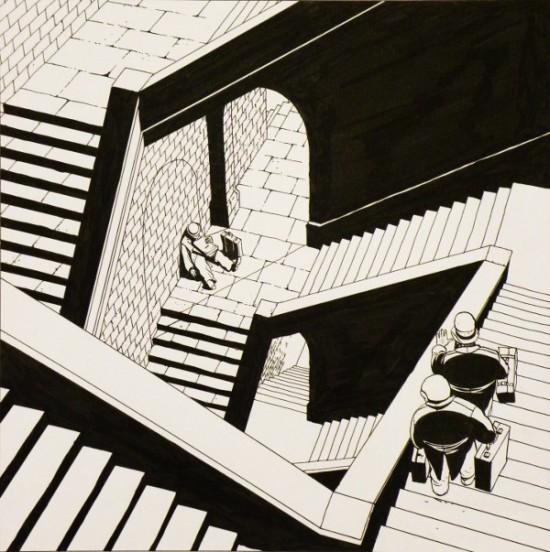Les esprits comptables qui voient dans les frasques berlinoises de Manuel Valls une énième preuve de la fracture, voire de la rupture, entre les élites et le peuple, et un énième épisode des libertés budgétaires de ceux qui nous demandent de la rigueur, ces esprits-là n'ont pas tort, évidemment, mais ils manquent ce supplément de consternation propre à cette échappée germano-footballistique.
D'une certaine manière, j'eusse,à titre personnel, préféré que le sieur en question se fît la belle pour rejoindre sa maîtresse à Lisbonne ou à Palerme. Je n'y aurais vu qu'une liberté adulte dans un emploi du temps étouffant, nonobstant les considérations financières bien sûr. Ce n'était pas plus justifié sur le plan politique que ce qui va nous occuper mais, pour le moins, on aurait le sentiment d'être gouverné par quelqu'un qui, au delà de la fonction, cherche à trouver dans son hyper-activité un moment pour souffler. En l'espèce, nous sommes loin du compte et c'est l'arrière-plan symbolique qui, dans le fond, est choquant, et cela, à deux niveaux.
Valls s'en va du congrès de son parti (1) pour aller voir un match. Un match phare de la saison, certes, mais qui vaut surtout pour lui, parce que l'une des équipes, le FC Barcelone, est le club de son enfance. Plus encore, le club de ses origines. Ce n'est pas seulement la référence à un quelconque attachement sportif (2) mais la revendication d'un lien que le premier ministre ne veut en aucune façon couper (ce qui peut sur le plan humain se comprendre), et cela, en passant outre le cheminement de sa propre histoire qui l'a fait devenir, et par sa volonté, français en 1982. Cet acte est en somme le premier signe de la régression. En quittant la France pour l'Allemagne, c'est-à-dire en abandonnant sa situation politique hexagonale (premier ministre au cœur d'un débat important concernant le parti au pouvoir), Vals fait un autre trajet qui le ramène en Catalogne, à cette Espagne des origines dont il possède encore la nationalité. La faute de jugement, ou ce que lui-même veut présenter désormais comme telle, n'en est pas une. Bien au contraire. Cet acte est le signe en creux de ce qu'il est : un narcissique infantile dont le désir d'être passe outre toutes les considérations proprement politiques. Il ne faut pas s'y méprendre. Réduire ce voyage au bon plaisir du puissant est une erreur. Ces quelques heures berlinoises dévoilent le politique sous son angle le plus fulgurant : un jeu d'enfant où, le pouvoir réel n'existant plus, le bonheur se trouve dans l'accomplissement de ses rêves d'enfant. Vals n'est pas allé à Berlin pour voir un match de football ; il y est allé pour joindre son désir profond (et passé) à sa puissance présente.
Certains s'étonnent, notamment dans l'entourage présidentiel, qu'il ait pu commettre une telle erreur. Raisonnement doublement ridicule. D'abord parce qu'en matière d'infantilisme, Hollande n'a de leçon à donner à personne. Ses amours en scooter, comme un adolescent qui passerait par la fenêtre pour retrouver son premier flirt, sont du même tonneau. Ensuite, parce que la lucidité politique est de facto oblitérée par le pouvoir politique, quand celui-ci se met au service d'un désir aussi fervent. Il ne pouvait pas faire autrement. L'écœurement vient de là, dans ce que cette impossibilité à résister souligne de déréliction au niveau du pouvoir. L'immaturité soudain au vu et au su de tous. Cette hispanité régressive de Vals est bien pire que le passe-droit financier sur lequel on met l'accent. Bien pire, en effet : il est premier ministre du gouvernement français, et comme tel, il se devrait à une certaine réserve. Que dans sa salle à manger, il revêt le maillot blaugranes, grand bien lui fasse ; qu'il file à l'étranger pour changer symboliquement de passeport, voilà qui est bien plus gênant. Et de se demander si, dans l'affaire, la marche consciente vers le pouvoir ne se double pas d'une autre, inconsciente, pour ne jamais abandonner l'origine. Le quidam s'interroge alors : qu'en aurait-il été, au profond ministériel, si la finale avait opposé le FC Barcelone au PSG ? Nul doute qu'on aurait sorti la langue de bois sur la beauté du sport, le meilleur qui gagne, l'importance du beau jeu, etc., etc., etc..
Cette observation eût été discutable s'il n'y avait pas eu une deuxième articulation dans la régression, et celle-là plus imparable encore. Vals, dans son retour au bercail, a emmené ses fils. On passera sur la parade qui ne résout rien : ils adorent le foot. On s'en fiche. On mettra de côté le coût tant la grandeur de cette République exemplaire est une foutaise. Que reste-t-il alors de si terrible ? Rien moins qu'un père (mais l'air du temps et le psychologisme qui règne dirait : un papa (3)) qui se fait plaisir, fait plaisir à ses garçons, et concrétisant sans aucun doute une promesse, leur montre ce qu'il est capable de faire en faisant le détour par d'où il vient. Cet aller-retour met totalement de côté le caractère public de la représentation politique. Il n'est qu'une histoire privée, une histoire de mecs, de démonstration masculine, par quoi le pouvoir, c'est en avoir, s'en servir au delà de ce qui est admissible. Berlin, pour Vals et ses fils, tient à la fois du pèlerinage (le passé catalan) et de la négation (du présent français). Ce qu'il vient regarder est indissociable du pouvoir qu'il a de donner à regarder. On imagine le souvenir inoubliable pour la progéniture, où se mêlent le goût de la victoire, l'union familiale et l'étalage du pouvoir paternel, comme aux temps très anciens où nous croyions que notre père était capable de tout et qu'il nous protégerait de tout.
Valls, dans cet épisode qui risque de lui coller à la peau, est dans la monstration et la démonstration. Il est dans le plein désir, et pour ce faire, confond ce qu'il est, comme adulte, avec ce qu'il a été, comme enfant. Et ces enfants, sans qu'il s'en rende compte peut-être, sont le miroir nécessaire à sa volonté de jouissance sans fin. Pas la peine d'être grand clerc pour se dire que le retour à Poitiers a dû le consterner, parce qu'il s'agissait de revenir vers ce pour quoi il a été choisi alors même qu'il venait d'en nier la réalité. Ce n'est pas très rassurant quant à l'avenir...
Mais l'avenir commun, Valls n'en a cure. On sait désormais qu'il est capable de tout pour satisfaire son désir et nous ignorer. Les Grecs appelaient cela l'hybris. La démesure... Mais les Grecs, comme les Latins, sont des inutiles. Et Valls en sait quelque chose, lui qui soutient la réforme de Valaud-Belkacem...
(1)Preuve s'il en est du peu de considération qu'il faut avoir pour ce parti. Pas la peine de jouer la mauvaise foi, ces idiots donnent les arguments pour qu'on puisse en conscience les mépriser.
(2)Et nous connaissons tous untel qui aime Paris, Marseille, Munich ou la Fiorentina, sans être ni parisien, ni marseillais, ni munichois, ni florentin. C'est un attachement sportif, dont on peut sourire, mais qui n'est pas fondé sur l'attachement au sol, que par ailleurs beaucoup condamnent, notamment ches les socialistes.
(3)"Le papa", "la maman" : symptôme de l'époque, dans la bouche des psychologues miteux, des enseignants débiles, des journalistes qui cherchent à émouvoir, et des politiques qui veulent être proches...