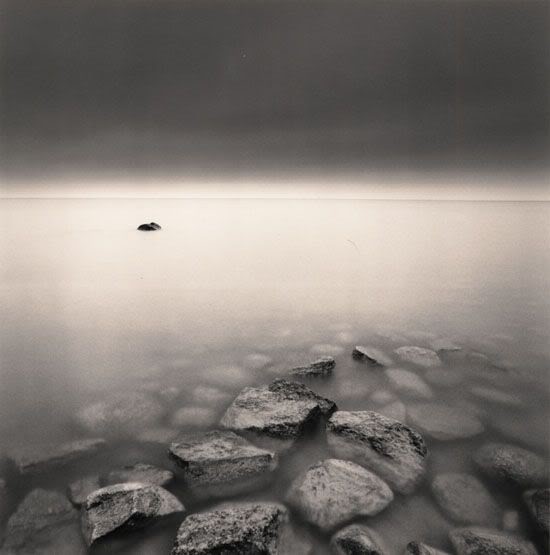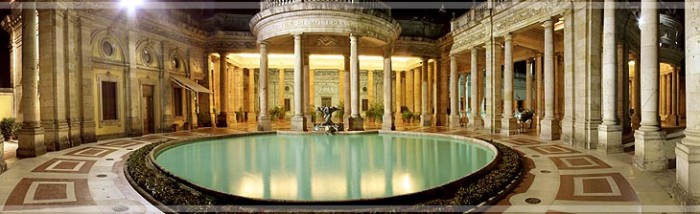La provocation littéraire et, croit-on, intellectuelle, prend le plus souvent, désormais, la forme du clapotis germanopratin dont la trace n'excède guère la semaine. L'information (ou plutôt son flot) ne supporte pas l'arrêt. Tel est bien le traitement auquel aura été soumis le dernier épisode de la guerre (factice) dans la République des Lettres française. Je veux ici parler du scandale Millet/Breivik (1).
Ayant tout lu, ou presque, de cet auteur, et observé ce que le Landerneau littéraire en disait, il est, me semble-t-il, assez curieux que l'on ait guère abordé le problème autrement que par l'invective, le diktat et les raccourcis peu audacieux. Tout ce monde manque singulièrment d'ironie dans ses attaques : il n'a pas le talent du délicieux billet de Pascal Adam, c'est clair. Certes, l'ère médiatique conditionne l'accélération des temps de réponse (la fameuse réactivité) mais on pouvait attendre des écrivains (laissons de côté le marais journalistique (2)) une plus grande retenue.
Richard Millet fait donc scandale par son éloge littéraire de Breivik. Nous reviendrons ultérieurement sur le fond. Pour l'heure, occupons-nous seulement de ce qui permet la promotion du texte, la force institutionnelle de l'auteur et la genèse des plaintes plumitives qui poussent cette fois plus loin que d'habitudes leurs jérémiades. Parce que Millet n'en est pas à son coup d'essai, et c'est justement ce glissement progressif de la parole inacceptable (du point de la doxa) qui importe, que soit possible son existence.
À ce titre, le parcours de Millet illustre d'une manière assez éclatante les analyses de Bourdieu sur le monde littéraire considéré comme un champ de pouvoirs ouvrant à une reconnaissance et à des droits pour qui acquiert ou bénéficie d'une position spécifique. C'est sur ce plan que Millet est un cas fort significatif. Il aime à rappeler, ces dernières semaines, qu'il est un écrivain, et non des moindres : il serait même une exception, à l'entendre. Ce terme ne manque pas de sel, dans sa bouche (ou sous sa plume) tant cet emprunt (involontaire) à la théorie fumeuse de l'exception culturelle française bricolée par Lang et consorts est maladroit. Il y a là une forme assez puérile d'auto-célébration. Passons... Écrivain, aime-t-il donc revendiquer, et depuis toujours : une œuvre abondante, exigeante, s'inscrivant dans une indéniable continuité. Encore que...
Commencée en 1983, l'entreprise milletienne fut d'abord confidentielle, jusqu'au tournant de l'année 93. Il publie alors chez P.O.L. Sa littérature explore les affres du malaise artistique, selon des voies qui n'ont guère d'originalité. L'écriture est belle, le propos désabusé, la mélancolie règne. À lire L'Angélus, La Tour d'ivoire ou L'Écrivain Sirieix, on n'explore guère plus qu'un malaise existentiel teinté de romantisme. Dans le même temps, il entreprend une œuvre polémique où l'on retrouve assez clairement cette inquiétude esthétique et morale de l'artiste au prise avec le monde contemporain : ce sont les premières versions du Sentiment de la langue. Millet y développe sa passion pour le classicisme et sa défiance devant le reniement moderniste (ou postmoderniste) pour le sérieux de l'héritage culturel et moral. Ce sont dans ces pages que la francité de l'auteur prenne corps. On pourrait écrire que sa plume est réactionnaire, que son esprit rame à contre-courant d'un mouvement qui veut brasser, mélanger, métisser et, même si ce n'est jamais ouvertement dit, revoir l'histoire et retirer à la pensée française et européenne (l'Europe étant alors conçue comme un territoire blanc, caucasien) non seulement sa prédominance mais son droit à l'originalité.
Mais il n'est encore pas grand chose, alors, le petit Millet, qu'un prof de banlieue, pas même agrégé (une de ses grandes misères, assurément). Il lui faut la bénédiction des institutions, et il l'obtient en 1993 par le Prix de l'Académie française. C'est à partir de ce moment-là qu'il s'extirpe de la masse des littérateurs, qu'il devient quelqu'un. Et que devenant quelqu'un, il peut se lancer plus gaillardement dans ce que d'aucuns trouvent une intempestive ratiocination nostalgique. Il infléchit le discours, revient vers la terre natale. Viendront donc La Gloire des Pythre, Les Trois Sœurs Piale et plus tard le très beau Ma vie parmi les ombres. Ces romans lui donnent une assise, un poids. Il fait entendre sa musique, fait jouer sa différence, et celui qui était peu entre dans le royaume des lettrés parisiens. Il quitte P.O.L. et son underground confidentiel pour la maison-mère, le fleuron français de la littérature : Gallimard. Non seulement comme écrivain mais aussi comme membre du comité de lecture. Il est intronisé dans le cercle fermé de ceux qui font la littérature (soit : les chefs cuistots de la tambouille éditoriale, où l'on récupère les bonnes recettes des autres, où l'on se façonne des plans marketing terribles qui n'ont plus rien à voir avec l'art, où l'on établit des rentes de notoriété comme d'autres sont éternellement sénateurs).
Arrivé à ce point de son évolution institutionnelle, le petit Millet peut se déchaîner. À tort ou à raison, le problème n'est pas là. Mais de Lauve le Pur à Eloge littéraire de Breivik, en passant par Le Dernier Écrivain, Désenchantement de la littérature, et L'Opprobre, il multiplie les textes prétendument sulfureux. On sent la jouissance du parvenu, la roucoulade facile du provocateur protégé par son statut. Millet, ce n'est pas, sur ce point, Renaud Camus. Il hérite d'un système dont il peut dire pis que pendre, d'un monde littéraire qu'il conchie à tour de bras tout en œuvrant de l'intérieur (3). Il joue l'homme d'exception, le dernier des Mohicans mais minaude avec Sollers, quand ils se rencontrent pour une discussion compassée propre à ceux qui feignent la lutte quand ils se sont tacitement partagés le territoire (4). On pourrait à l'infini montrer que la gloire virile et résistante de Millet relève essentiellement d'un opportunisme médiatique et d'une prébende littéraire.Parce qu'il est une véritable mine d'or, cet éditeur, qui, cumulant Littel et Jenni, vaut à lui seul des millions de chiffre d'affaires. Et quand on considère, bassement peut-être, ce paramètre, on imagine fort bien que l'homme se soit senti pousser des ailes...
Il y a en effet une corrélation très claire entre l'inflation de l'invective, le goût de la provocation, la mise en scène de soi (dont La Confession négative n'est pas la moindre des traces) et la reconnaissance du pouvoir qu'il a acquis dans la République des Lettres. C'est en considération de cette situation que le texte sur Breivik est une facilité grotesque, et une grossière escroquerie intellectuelle. Millet a fini par confesser sur i-télé, un soir (5), que ce titre était peut-être mal choisi et qu'à la relecture il y avait matière à modification. Voilà un aveu de taille, mais qu'on ne peut prendre tel quel. Trop facile. Il savait ce qu'il faisait. Il voulait faire ce qu'il faisait. Dès lors, venir s'expliquer (ou non) à la télévision n'est qu'un épisode de plus dans la stratégie de reconnaissance qui est la sienne.
La soif de distinction (au double sens qu'induit cette détermination bourdieusienne) suppose un travail de longue haleine et l'analyse lucide des niches que l'on peut occuper dans le territoire des lettres. Millet a choisi la réaction, l'intégrisme de la langue, une passion pour le classicisme, là où, clairement, il place le temps magnifique de la Littérature, oubliant alors que la Littérature, alors, n'existait pas mais qu'il n'y avait que les Belles Lettres, erreur d'appréciation historique. Dans la stratégie qui est la sienne, le contenu prévaut moins que la posture, le fond moins que la forme. Sur ce plan, on notera l'affaiblissement progressif de l'écrivain Millet depuis qu'il a atteint les hautes sphères tant désirées. Le Sommeil sur les cendres et La Fiancée libanaise sentent la redite et la simplification. Plutôt que d'asséner à répétition ses sentences apocalyptiques, Millet, l'écrivain, ferait mieux de s'interroger sur ce qu'il a encore à écrire.
Mais revenons à l'objet du délit, objet du délire pour ses vilipendeurs (sur lesquels nous reviendrons au prochain numéro). Il n'y a rien, dans les quelques pages consacrées à Breivik qui ne puissent être mis en écho de ce que cet auteur a déjà publié. Ceux qui aujourd'hui s'alarment et en appellent à la vertu de la littérature ou n'ont jamais lu Millet, ou vivaient loin des territoires hexagonaux, ou prennent la pose. La question n'est donc pas là. En revanche, le titre et la méthode ne laissent pas de surprendre. Éloge littéraire... Pourquoi Millet invoque-t-il ici la littérature ? Faut-il y voir un clin d'œil malin (?) à l'ouvrage de Thomas de Quincey publié en 1854, De l'assassinat considéré comme un des beaux-arts ? Millet aurait-il une face d'humour noir cachée ? Breivik peut-il être alors un héros de roman, à défaut, dans son sens le plus étroit, romanesque ? Pourquoi pas... Il reste alors non à en percer le mystère (car de cet homme, en soi, il y a sans doute peu à apprendre) mais à en construire une identité remarquable par laquelle le lecteur pourra, dans un retour de la littérature à la vie, tirer une réflexion sur ce que sont la violence et sa légitimation. Si la littérature a sa place dans l'histoire de Breivik, c'est à condition d'en sortir, paradoxalement, de faire de Breivik une source et non pas une vérité. Or, c'est justement à cela que Millet réduit son entreprise éditoriale (6). Il ne prend pas le temps de la métamorphose du style et de l'exploration du monde et des êtres. Il se présente comme le scribe magistral et efficace (dix-huit pages pas plus : du concentré, vous dis-je...) d'une pensée dont lui seul a réussi à décrypter et synthétiser l'ampleur. Tout le brillant de la démonstration tient en cette capacité à nous épargner les 1500 pages du compendium de l'assassin norvégien. Et c'est à partir de cet exploit que Millet nous donne les clés de la violence d'Oslo : une dilution progressive de la culture européenne, l'abandon programmé d'un passé européen par le biais d'une explication essentiellement ethnique et la réduction de la grandeur européenne à son versant classique, chrétien, et blanc.
Qu'il y ait aujourd'hui un problème majeur avec l'islam est une évidence, n'en déplaise à ceux qui voient dans ce constat les signes d'une islamophobie tout à fait fantasmatique (7), alors que l'antisémitisme ressurgit sans qu'on s'en inquiète outre mesure. Que Millet s'en alarme, c'est son droit et certaines voix peuvent le conforter : de Michel Tribalat à Gilles Kepel (lequel Kepel a singulièrement revu ses analyses si l'on se souvient de ce qu'il écrivait il y a quinze ans). Qu'il affiche haut et fort son attachement catholique, en quoi est-ce méprisable ? Or, il est clair que dans les milieux dopés à l'ouverture des frontières, du monde et, éventuellement de l'esprit, le catholique est un affreux garnement, un réac, un peine à jouir, un intégriste. Passons... Il a le goût classique : il préfère Saint-Simon aux plaisanteries de Léo Scheer, le cardinal de Retz aux œuvres complètes d'Annie Ernaux. Est-ce un crime qu'il ne se retrouve pas dans la littérature contemporaine ? Qu'il fasse comme bon lui semble. Millet n'est qu'un écrivain de plus dans la tradition littéraire des auteurs en combat avec leur temps, avec la décadence qui rôde, avec le mal qui pullule. On peut ainsi se promener de Saint-Simon à lui en passant par Chateaubriand, de Maistre, Flaubert (celui de la correspondance), Barrès, Péguy, Jouhandeau, Cioran... Ceux qu'Antoine Compagnon nomme un peu facilement parfois les anti-modernes.
En revanche, quand il assimile, et c'est bien le fil conducteur discret de cet Éloge, l'association de la langue à l'ancienneté territoriale, à cette inscription dans l'espace, à cette généalogie immémoriale (8) c'est plus qu'agaçant. C'est absurde. La littérature est-elle réductible à l'ascendance de celui qui l'accomplit ? Millet sur ce point devrait se souvenir que des auteurs, et non des moindres : Strinberg, Nabokov, Conrad, Tabucchi, Beckett, Pessoa..., ont écrit en deux langues, voire trois, et qu'ils n'en sont pas moins des auteurs du dedans de ces langues. De même, est-il nécessaire d'être du plus profond de la francité pour en prendre une part ? Faut-il réduire la littérature au chant itératif d'une délimitation spatiale ad vitam aeternam ? Faut-il être du lieu pour avoir voix au chapitre ? Peu me chaut la judaïté suisse de Cohen, l'antériorité égyptienne d'Albert Cossery, la naissance caraïbe de Chamoiseau. Ou plutôt : elle m'importe, tant j'y entends, loin de tout exotisme, une partition nouvelle (et en même temps dans la continuité) de la langue française.
La litanie milletienne du territoire n'est au fond que le revers de la médaille différentialiste. Il n'est pas contre ceux qu'il combat, dans le sens où être contre signifierait être ailleurs, dans une autre alternative : il est face à eux. Pas si loin...
Son Éloge est un ersatz de polémique, un brouillon de pensée, une redite. Cela fait beaucoup pour si peu de pages.
(1)Richard Millet, Langue fantôme suivi de Éloge littéraire d'Anders Breivik, Pierre-Guillaume de Roux, 2012
(2) Trois exemples suffisent (mais c'est déjà beaucoup, en fait) : la si inutile Nelly Kaprièlan dans les Inrocks du 29 août (mais on sait ce qu'elle vaut depuis ses éructations contre Renaud Camus) le réduit à un facho. Classique. L'insuffisant Edouard Launet dans le Libération du 7 septembre 2012 (mais c'est Libé...) ressert la soupe bobo de gauche indigné avec une telle légèreté de contenu qu'on se demande si le pauvre Édouard a vraiment lu Millet ou s'il ne s'est pas plutôt aligné à l'aveugle sur une discussion de café du commerce des amis de Stéphane Hessel. Le meilleur arrive avec Rue 89 qui ne trouve pas mieux, via la plume grotesque d'Aurélie Champagne, de nous pondre une lettre putative du sinistre Breivik à son ami Millet, ce qui ne manquera pas de surprendre, sur deux points. Avoir, en deux temps trois mouvements, les moyens de se glisser dans la peau de Breivik suppose ou une compréhension magnétique de l'individu et de son discours, ou un jeu parodique par quoi le méchant enfonce les portes ouvertes de son propre néant (c'est la deuxième solution, évidemment, que choisit la petite Champagne). Dès lors, la singularité de Breivik est passée à la trappe et le massacre norvégien est une histoire de tueur en série de plus. Ensuite, puisque fausse lettre il y a, on glisse donc dans le fictionnel, dans le littéraire, accréditant de facto le titre ridicule de Millet. Un partout, la balle au centre.
(3)Avec un succès certain qui lui garantit l'impunité : Les Bienveillantes de Littell, L'art français de la guerre de Jenni, c'est lui. Voilà des réussites qui sonnent dans la finance, soit, mais quid de la littérature dans tout cela, vu la médiocrité de ces deux romans...
(4)Dans un numéro du Magazine littéraire de décembre 2007.
(5)Pour un écrivain d'exception, ainsi qu'il se définit lui-même, condescendre à répondre à la sottise journalistique estampillée Canal+ est un manque évident de lucidité. Le propre de l'exception, en ces temps de délire médiatisé, semblerait de s'en tenir aux écrits seuls, de les donner à lire pour ce qu'ils sont et de laisser le tout venant se débrouiller avec eux. Venir sur un plateau télé pour justifier ou faire de l'explication de texte est une veulerie pitoyable, à moins qu'elle ne révèle vraiment ce qui agitait Millet depuis longtemps : faire un prime-time.
(6)J'emploie à dessein le mot entreprise, parce qu'il y a bien là manière de faire de peu une machine à fric, dont se félicitera en premier lieu le petit éditeur qui a eu l'audace (fichtre...) de publier une telle somme.
(7)J'en veux pour preuve le délire des gauchistes au moment de l'affaire Merah et les raccourcis immédiats sur les effluves nauséabondes de la campagne électorale. Pendant une journée, ces enragés moralistes firent une battue médiatique pour trouver le coupable dans les rangs de Marine Le Pen. Pas de chance pour eux. Ce genre de comportement est stupide et dangereux. Il ne fait que renforcer le Front National qui se présente alors en victime. La victimisation ne peut pas être un discours politique, parce qu'on privilégie alors le subjectif, l'affectif, le distinctif.
(8)« ...les noms propres, lesquels durent généralement plus longtemps que les corps et que le souvenir » (Le Renard dans le nom, Folio, p,13). De même : « Les mots sont la seule gloire des disparus – et le français la belle langue des morts, comme le latin celle de Dieu » (Ma vie parmi les ombres, Folio, p. 50)
Les commentaires sont fermés.