Combien étais-je présomptueux en commençant, il y a quelques jours, le billet précédant celui-ci lorsque je disais que l'affaire Millet ferait clapotis dans l'eau et guère plus. Le jeu en valait en fait la chandelle et la Littérature française a cru bon devoir mettre de l'ordre dans son territoire. Et comme dirait une mienne connaissance, elle a envoyé du lourd.
La Littérature française, par auto-désignation il faut le dire, a confié ses intérêts à deux noms appelés à disparaître. Ce sera donc pour eux l'occasion de demeurer un temps, au titre de participants aux anecdotes de l'histoire littéraire (1). Ci-devant donc, et en première ligne, puisqu'il faut guerroyer : Annie Ernaux, styliste pour classe de lycée (2), Tahar Ben-Jelloun, insignifiant gratte-papier de l'amour étendu à l'universel. Ces deux-là y sont allés pour dire, un peu à la manière d'un instit IIIe république, ou d'une mère la pudeur, ou d'un père fouettard, que désormais l'affaire était grave, que Millet ne pouvait plus sévir indéfiniment sans que mesure soit prise à son encontre. Comme le courage est leur ligne de conduite, ils se sont retournés vers l'instance des lettres, leur sur-moi éditorial, la principauté Gallimard, pour que l'affreux lascar soit chassé du territoire. Il y avait un côté Robespaul 1981 dans une telle revendication (3). Il faut dire que l'un et l'autre de ces grands moralistes ne pouvaient plus supporter d'être avec Millet au comité de lecture de la vénérable institution. Dans le fond, on les comprend. Imaginez : un repas de famille, le père au bout de la table, des mécontents en nombre, et le Judas qui prend sa chaise comme si de rien n'était. C'est terrible, insoutenable, odieux...
Oui, il faut les comprendre, à mesurer ce qu'ils prennent alors pour une sorte de tache, d'être ainsi confondus avec le fasciste répétitif. Cela fait pourtant bien des années que l'affaire dure, qu'ils connaissent le compère. Tant que les histoires restaient confinées à la sphère étroite des Lettres (le règlement de compte de L'Opprobre, par exemple), ils faisaient semblant. Mais l'ego de Millet réussissant à faire scandale au delà, avec son Éloge littéraire, on change de registre. On ne peut plus faire semblant. On se drape de vertu, de lin blanc et tout le saint-frusquin et la sentence tombe, en deux temps : Millet doit partir, Gallimard doit faire quelque chose. Il aurait été trop leur demander de mettre leurs actes avec leur indignation et de décider unilatéralement qu'ils abandonnaient les planches pourris du navire. Mais il est fort difficile, sans doute, de renoncer, même pour l'étendard de la morale, à une position. Surtout, qu'en l'espèce, ce choix aurait dû se faire il y a déjà longtemps puisque les choix idéologiques de Millet sont très anciens. Mais, ils s'en accommodaient. Sans doute parce que la notoriété de l'auteur honni était suffisamment contenue dans la sphère littéraire pour leur permettre de faire comme si. Chacun a ses petites lâchetés, certainement. Reste que la noblesse revendiquée de la littérature en prend un coup, et à l'endroit de ceux qui veulent en être les pasdaran.
Mais revenons à l'argumentaire d'Annie Ernaux qui vaut des points, parce qu'il use de toutes les ficelles d'une rhétorique facile.
Le titre est déjà tout un poème. « Le pamphlet fasciste de Richard Millet déshonore la littérature ». Rien de moins. Allons vite : « fasciste », évidemment, comme un point Godwin de la doxa. Fasciste, c'est l'adjectif qui permet tout, une sorte de générique de la morale. Après cela, on se tait. Le déshonneur de la littérature, ensuite. Outre que elle offre à Millet ce qu'il attend, d'être l'alpha et l'oméga de la pensée française, la formule affaiblit singulièrement la puissance de la littérature, qu'une quinzaine de pages met à mal. Elle établit surtout une équivalence de l'écriture littéraire à une position morale soumise à l'approbation de tous, à un critère obscur qui rendrait donc impossible toute polémique, tout pamphlet, toute diatribe, à partir du moment où ces genres enfreignent le bon goût et la morale. La morale surtout. Et de me dire alors que Discours sur les misères de ce temps de Ronsard doit être de toute urgence retiré de l'histoire littéraire, que Les Déracinés de Barrès doit être détruit séance tenante, qu'il faudrait batailler radicalement contre la réédition probable des brûlots antisémites de Céline (4). Écrire, et bien écrire, ne se décrète pas dans les couloirs de la bienséance. Quand on se place d'emblée sur ce plan et qu'on choisit un titre aussi ronflant, aussi ridicule que celui trouvé par l'homme qu'on veut démolir, il est certain qu'on va droit dans le mur. Ce constat est tellement évident que même Patrick Kéchichian y a trouvé à redire et ramène le problème à des considérations un peu moins grandiloquentes.
Continuons. Annie Ernaux se situe sur le plan de l'affect. Elle a lu Millet dans un « mélange croissant de colère, de dégoût et d'effroi ». Dans le monde de violence qui est le nôtre, je n'ose imaginer ce que doit être la vie de cette dame, en considération des sauvageries dont l'information nous rend compte quotidiennement. Quelques lignes plus loin, tout s'éclaire : la plume « de Richard Millet s'est bel et bien mise au service du fusil d'assaut d'Anders Breivik, en attisant la haine à l'égard des populations d'origine étrangère ». Rien de moins. Millet est un criminel en puissance. Il n'est pas encore passé à l'acte mais le risque est énorme. On croirait lire du Sarkozy glosant sur la potentialité criminelle des gamins de trois ans. En clair, la paix civile française (voire européenne, voire mondiale) est entre les mains de Millet. C'est, me semble-t-il, lui faire un peu trop d'honneur, surjouer la puissance d'un écrivain dans un monde où la littérature tend à disparaître.
Mais il est vrai que la logique démonstrative de cette auteur nous échappe. Il est éminemment narcissique. Il se développe autour d'un « moi, je... » sournois et risible. Ainsi avons-nous droit au morceau d'anthologie ci-dessous reproduit in extenso. C'est l'avant-dernier paragraphe de l'attaque.
« J'écris depuis plus de quarante ans. Pas davantage aujourd'hui qu'hier je ne me sens menacée dans ma vie quotidienne, en grande banlieue parisienne, par l'existence des autres qui n'ont pas ma couleur de peau, ni dans l'usage de ma langue par ceux qui ne sont pas "français de sang", parlent avec un accent, lisent le Coran, mais qui vont dans les écoles où, tout comme moi autrefois, ils apprennent à lire et écrire le français. Et, par-dessus tout, jamais je n'accepterai qu'on lie mon travail d'écrivain à une identité raciale et nationale me définissant contre d'autres et je lutterai contre ceux qui voudraient imposer ce partage de l'humanité. »
Je serais fort heureux que quelqu'un m'explique le lien intellectuel entre la première phrase et la deuxième, entre l'ancienneté dans les Lettres (5) et sa vie en grande banlieue. Et d'abord, où en banlieue ? Oui, quel lien ? Au delà, de toute manière, on retombe, par un curieux paradoxe, au développement du sentiment. C'est le « I feel » creux au lieu du « I think » des débats d'étudiants anglo-saxons. Chacun son impression et tout se vaut. Annie Ernaux ne se sent pas menacée. Tant mieux. Est-ce une réponse à ceux qui, eux, se sentent menacés ? Est-ce une manière intelligente de répondre à celui qui, ayant vécu une menace étrangère, décide que l'étranger est par essence un danger ? À ce dernier on dira qu'il généralise ; il répondra que son expérience est ainsi et que son propos vaut bien celui qui célèbre le multicuralisme à l'ombre des beaux quartiers et d'une intelligentsia cosmopolite unie par le fric et les espaces réservés... Et comme le substrat du vécu ne suffisait pour être décisif, on aura le droit dans le dernier paragraphe à l'anecdote de la « jeune romancière, qui n'est pas d'origine européenne »... Voilà donc les actes de moralité d'Annie Ernaux : elle n'a jamais eu de mauvaise pensée et elle connaît et aime des gens différents. L'objectif sous-jacent d'une telle démonstration (!!) est simple : supposer qu'outre ses positions intellectuelles, Richard Millet a un vécu inhumain et pourri. Si Annie Ernaux avait lu Millet, elle saurait que celui-ci a une relation à l'Orient fort complexe, que son amour de la Chrétienté orientale n'exclut pas en lui l'attrait pour le monde arabe (dont il maîtrise la langue...). A-t-elle mené l'enquête pour savoir ce que sont les fréquentations, les amitiés du barbare fasciste ? Peut-être au prochain numéro (comme on parle d'un numéro de cirque...).
Si l'on s'intéresse au contenu plus idéologique du papier, il y a là aussi de quoi rire. Que reproche-t-elle ? Où se loge sa répugnance ? La parole de Millet écœure parce qu'« il faut accepter de lire ce tableau ahurissant de la littérature contemporaine – française, européenne, américaine –, qui ne serait qu'insignifiance, indigence, niaiserie, "ordure romanesque". Pour faire simple : il pense qu'ajourd'hui on écrit de la merde ! Il trouve cette décadence dans le métissage de la langue. On peut trouver ce point de vue contestable mais il n'est pas nouveau. Dans Le Dernier Écrivain, il écrit que « citoyen du monde », c'est « formule qui ne veut en fin de compte rien dire ». Il s'inquiète de la disparition de l'Europe et de l'immigration ? Mais il avait écrit dans Le Dernier Écrivain, qu'il se sentait comme « le minoritaire même : blanc, mâle, «Français de souche », catholique, hétérosexuel ». Il déplore violemment la mort de la langue française gangrénée par les langues étrangères ? Mais il avait écrit dans Le Sentiment de la langue, en 1993, : « Ne pas franciser les mots étrangers, c'est accepter la perte du génie de la langue, se résoudre à sa babélisation ou à quelque minimal espéranto anglo-saxon ». Il s'effraie devant la dilution d'une identité nationale ? Mais il avait écrit dans ce même ouvrage : « Tout se passe comme s'il y avait une volonté politique de miner l'identité française au profit d'un improbable métissage ethnico-culturel dont on sait qu'il ne produit que ghettos, clivages, sortes de sous-castes de banlieue ».
Il n'y a donc rien, ABSOLUMENT RIEN de nouveau sous le soleil pauvre des Lettres françaises et le babillage d'Annie Ernaux est d'abord une escroquerie intellectuelle. Ce que montre d'abord sa tribune, c'est son ignorance du sujet qu'elle attaque. Il n'est pas nécessaire qu'elle la feigne la blessure insupportable, que son papier mondain (si j'ose ce jeu de mots) devienne un impératif : « Je ne ferai pas silence sur cet écrit », « Je ne me laisserai pas non plus intimider par ceux qui brandissent sans arrêt, en un réflexe pavlovien, la liberté d'expression ». Imaginez : elle ne cède pas aux intimidations. Lesquelles ? De quels lieux ? Des troupes littéraires et journalistiques d'extrême-droite ? Espérons qu'elle puisse obtenir sous peu une protection policière. Elle pourra alors écrire un papier intitulé, « Moi, Annie Ernaux, nouvelle Talisma Nasreen... ». Plus sérieusement : je suis fort aise de savoir que la liberté d'expression, comme argument, peut être un réflexe pavlovien. Ou bien cette dame ne sait pas ce que signifie cette expression, ou bien elle suppose que c'est une notion à géométrie variable, une donnée sociale déterminée dans le temps et dans l'espace et qu'il faut en user avec parcimonie et discernement, voire en occulter le droit. C'est exactement ce que pensent les fondamentalistes de tous bords, les fous de tous les Dieux en puissance. Il est toujours plaisant de voir un écrivain caresser la terreur dans le sens du poil.
Et si Richard Millet, dans un geste très imbécile, met en scène Breivik et fait fausse route dans sa critique du monde comme il va, en faisant de l'actualité immédiate un brûlot, il n'est pas si éloigné, dans l'esprit du scribouillard Salim Bachi qui, à l'incitation du Monde des Livres, s'est fendu d'un Moi, Mohamed Merah... dont la publication n'a pas réveillé les âmes sécuritaires de la pensée littéraire. Peut-être ne fallait-il pas agacer un écrivain qui venait de publier en février Moi, Khaled Kelkal... Il faut croire que le massacreur salafiste de légionnaires et d'enfants juifs dérange moins que l'extrémiste de droite flinguant avec froideur des jeunes socio-démocrates. Sur cet exploit littéraire qui, sur le plan de la morale, puisque c'est le terrain d'Annie Ernaux, méritait bien une réplique, une mise au point, une alerte, rien. Rien du tout. Annie Ernaux a donc l'indignation sélective. Ce n'est pas un reproche, c'est un fait, dont je ne tire aucune conséquence sur le plan de son éthique. Je constate.
Encore a-t-elle un mérite : elle a écrit ; elle a pris sa plume. Que dire en revanche des suiveurs qui ont apposé leur nom au bas du document, avec une mention d'un ridicule affligeant : « Nous avons lu ce texte d'Annie Ernaux et partageons pleinement son avis ». Tous des écrivains pourtant (6), mais avec le besoin de rappeler qu'ils ont lu (c'est bien...) et qu'ils approuvent : de là le « pleinement » qui nous rappelle combien les adverbes sont terribles (7). Bref, on dirait des pétitionnaires de salle des profs ou d'une administration quelconque signant devant la machine à café. Ce ne serait que pathétique s'il n'y avait pas dans ce geste une procédure nauséabonde de la horde en chasse, de la sécurité morbide du nombre. Au fond, sont-ils mieux que ces obscurantistes qui, pour un oui, pour un non, ont le goût du lynchage. Loin de penser qu'ils soient violents, ils sont simplement lâches. L'agglomérat de leurs ego (ah, monsieur, les écrivains...) pourrait étonner, eux qui sont si soucieux de leur indépendance, mais l'on comprend vite qu'il s'agit d'un réflexe pavlovien de la caste excluant un intrus devenu gêneur et puissant. Ils veillent au grain de leur coterie : la littérature française, ce n'est pas cet énergumène nourri de haine et d'invectives. Non seulement, disent-ils, en filigrane, il n'est pas comme nous mais il n'est pas des nôtres. Il est vrai que ce n'est pas, pour nombre d'entre eux, à les parcourir (quant à les lire, il ne faut pas exagérer...) qu'on risque le frisson, l'étonnement et l'inquiétude (8).
Mais il est clair qu'il faut bien œuvrer dans ce sens puisque l'archange nobélisé est lui-même convenu qu'il fallait livrer sa parole. L'œcuménique Le Clézio a parlé et l'extrait qui suit suffit, dans son invraisemblance, pour ne pas aller plus loin dans le commentaire :
« Revenons au bouquin de M. Millet: comment croire à ce qu'il raconte? Il n'existe que pour et par le scandale, et c'est là ce qui doit le rendre insignifiant à nos yeux.
Sans doute, en France, existe-t-il le syndrome célinien. Si Céline est un génie et un provocateur, est-il suffisant d'être provocateur pour avoir du génie?
Le scandale, le scepticisme et le goût d'amertume sont des éléments inséparables de la bonne littérature. Cependant, l'auteur qui n'est motivé que par le goût du scandale cède à la pathologie de l'insignifiant. Le pouvoir de séduction de l'ignoble est insidieux, il sécrète une humeur grise et sournoise qui peut conduire certains esprits faibles à l'assassinat. »
C'est paradoxalement un défenseur de Millet qui donne une partie de la solution à cette effervescence. Dans Le Monde du 11 septembre, Pierre Nora écrit ceci :
« Richard Millet a le droit de penser ce qu'il veut et de l'écrire. Mais il n'a pas le droit, au nom de la solidarité amicale et professionnelle, de nous faire otage de ses opinions, de ses enfantillages, de ses confusions intellectuelles, de sa psychologie particulière, de ses foucades délirantes. On ne veut pas se désolidariser et on ne veut pas se solidariser. Nous voilà dans un piège. A cause de vous, mon cher Richard. A vous donc de trouver le moyen de nous en sortir, sans hurler que l'on veut votre mort, et avec vous, celle de la littérature et même de l'Occident. »
Formule magique : « Nous voilà pris au piège ». Tel est sans doute le vrai problème : Millet somme les Lettres françaises de prendre parti, de sortir de son contentement, de se placer dans le jeu intellectuel autrement que comme dans un jeu de chaises musicales. Mais ses représentants brillent d'abord par leur (in)suffisance. La preuve en est administrée par le papier simple, clair, dans la logique d'une pensée historicisée (9). Ces lignes sont signées Bruno Chaouat et c'est à lire ici. Et elles sont d'une autre portée, et autrement épineuses, tant le sentiment anti-américain est un lien fort universel...
(1)Si toutefois l'histoire littéraire a encore droit de citer dans le monde de la culture contemporaine, ce qui n'est pas gagné. Il suffit de voir comment l'institution scolaire, à commencer par l'Inspection Générale, en a fait une peau de chagrin.
(2)Parce qu'il ne faudrait pas ennuyer l'adolescent inculte (et de plus en plus fier de l'être) avec des phrases interminables. Le non-style, à base de sujet-verbe-complément, est un moyen de pactiser avec lui. De plus, on le sait depuis 68, la langue est faciste...
(3)Allusion à Paul Quilès demandant au lendemain de la victoire de Mitterrand en 1981 que des têtes tombent.
(4)Mais l'on peut aussi faire un grand nettoyage et supprimer de l'horizon Béraud, Jouhandeau, Drieu La Rochelle, Chardonne, Morand, pour s'en tenir aux écrivains du XXe...
(5)Et c'est important, l'ancienneté, quand on a fait sa carrière comme prof au CNED. Alors, dites-nous : grand choix, petit choix ou ancienneté ?
(6)Ou prétendus tels parce que, malgré tout, le mélange Amélie Nothomb, Chloé Delaume ou Camille Laurens avec Antoine Emaz, Jean Rouaud ou Oliver Rohe, c'est un peu too much...
(7)Le "pleinement" touche-t-il toutes les expériences personnelles d'Annie Ernaux, auquel cas nous découvririons que le parisianisme des lettres est une blague puisque ceux qui comptent vivent tous en banlieue...
(8)Pour nombre d'entre eux, dis-je, parce que certains valent infiniment mieux que de se soumettre à la logorrhée d'Annie Ernaux.
(9)Même si la référence aux années 30 nous semble une erreur conceptuelle.
Les commentaires sont fermés.
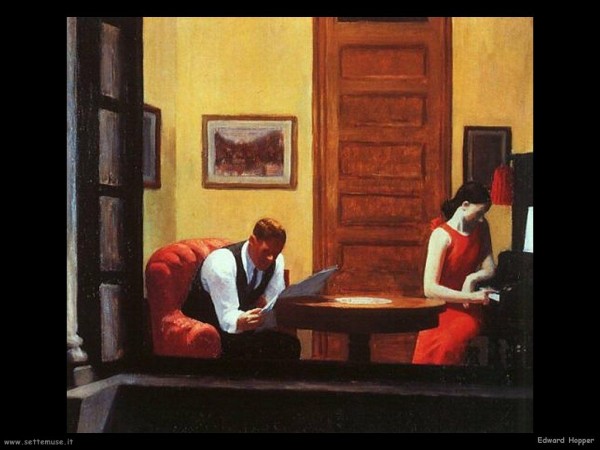






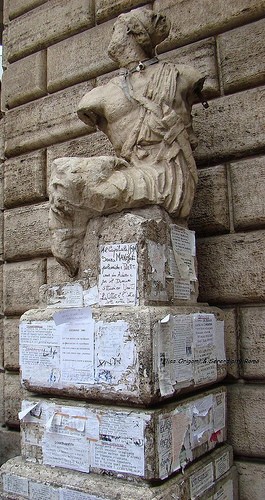
![486591_10151009848097872_21667606_n[1].jpg](http://off-shore.hautetfort.com/media/01/02/682041602.jpg)