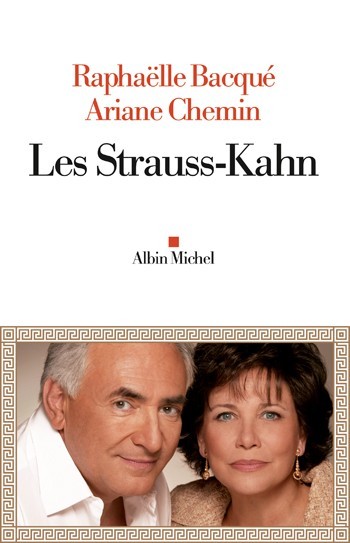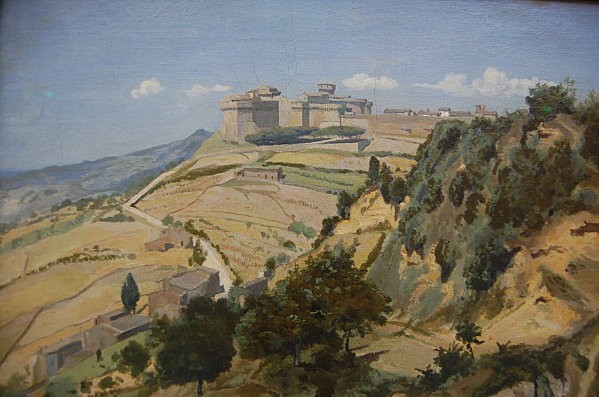Il a un jour refusé un verre, sans plus d'explication. Certains ont souri en constatant que deux semaines plus tard il s'en tenait à la même sobriété et à ceux qui ont voulu savoir il a opposé un sourire (un peu) narquois. Il n' a rien invoqué : la peur de l'accident, l'odeur récurrente du vomi, les gamma GT, la fatigue, la cirrhose, l'âge, le dégoût, l'ennui, l'entrée dans une vie plus sérieuse, maintenant qu'il était père, la crête de la trentaine, les mauvais exemples...
Il avait beaucoup bu ces dix dernières années, essayé l'éventail des alcools, connu des périodes, des envies, des folies, des obsessions. Il avait dormi dehors, sur des bancs, sur le palier (incapable qu'il était de glisser sa clé dans la serrure), dans ses voitures successives, dans celles de ses amis, dans une ou deux cellules de dégrisement.
Il avait connu le whisky mordoré, le goudron des stouts et la traitresse belliqueuse de la transparence : vodka, tequila, rhum blanc, mescal, aquavit..., le sucré-alcoolisé aussi : les cocktails.
ll avait parlé pour ne rien dire, pour relancer le comptoir, pour déblatérer, pour séduire (et n'être, parfois, plus qu'un homme ne tenant pas ses promesses), pour refaire le monde. Il avait renié sa vie et ses amours ; il avait trempé ses amitiés dans la bière, les avait pleurées de même. Il ne disait pas qu'il avait tout connu ; il ne disait pas qu'il avait tout fait pour mettre fin à cette histoire, à cette mondanité ruineuse à plus d'un titre.
Il aurait parié qu'un jour son corps le lâcherait. Il attendait une faiblesse hépatique, un manque (une angine asséchante, une fièvre pour le réduire à des tremblements en attente des degrés habituels de son sang, comme il arriva à Cyrille, et le delirium traemens.). Il n'était pas sûr qu'il n'eût couru vers ce fracas, parfois, mais en vain.
Il avait connu les réveils laborieux, le dégoût temporaire et la honte des témoignages quand il était là sans y être. Les choses sales des discours et des bagarres, les amours sans mémoire, tout abîmées dans l'œil, vitreux souvent, de l'autre, des autres. Ce qu'il avait partagé sans y donner de soi. Ce n'était pas un temps déraisonnable mais une vie parallèle, comme s'il y avait eu en lui une réversibilité du temps et de l'espace.
Puis, un jour, sans qu'il sût ce qui avait été la goutte de trop, il sortit d'une nuit avinée alourdi d'un chagrin inconnu, dépossédé de cette vitalité qui lui avait permis de braver le creux de la vague, le taedium du corps demandant une trève. Ce n'était pas l'incertitude de l'œil, le vertige passé de l'oreille interne aux terminaux du corps entier. Pas dans le corps, non, tout en étant bien là, dans le corps, dans son corps. Pas le corps seul, non, mais bien plus que lui. Il avait dormi chez Pierre et lorsqu'ils se retrouvèrent devant un café, sur la terrasse, en plein soleil, son ami lui expliqua, quoique ce ne fût pas le mot qui convînt, qu'il avait eu le vin triste, abyssal. Il ne répondit pas et Pierre ne fit pas plus de commentaires.
Il fit comme si le récit amical ne s'était pas superposé à ce malaise du réveil initial et il continua ainsi son chemin, essayant de ne pas se retourner sur cet épisode. Il ne s'effraya pas d'accumuler, par occasions, les verres, croyant que l'affaire était conclue et qu'il s'agissait d'un anecdote.
Mais il n'en était rien et une nuit, chez Vincent, cette fois, le cirque du chagrin recommença. Il s'était écroulé sur le plancher, sans perdre connaissance, capable de répondre et exigeant qu'on le laissât tranquille. Il sentait que cela allait venir. Il n'aurait pas pu en donner les symptômes précis : il en avait simplement la certitude. Et cela vint, comme il aurait pu le dire d'une envie de vomir ou d'une éjaculation. It comes...
C'était tout le contraire de ce qu'on a l'habitude de projeter quand on parle d'un sentiment désespérant. Il n'y trouvait pas la submersion, brusque et dévastatrice, par laquelle vous étouffez, et que l'expression avoir la tête sous l'eau résume en quelque sorte, cette asphyxie acqueuse où vous sentez au-dessus de votre corps une épaisseur insaisissable, mobile et froide. Pas cela : l'image océanique de son ensevelissement, dans le mariage improbable de l'eau et de la terre. Et pas tout à fait improbable si l'on admet alors que ce serait une boue liquide, très liquide qui vous recouvrirait. Liquide liquidateur. Cette sensation, il l'avait connue : elle avait à voir avec les cauchemars, les courses pour fuir une figure inquiétante, sans que l'on puisse vraiment mettre ses jambes en action ; et de sentir le rythme cardiaque monter alors même que l'effort fourni est vain. Il s'était déjà réveillé dans la continuité de ces histoires écrasantes, haletant comme un idiot. En pleurs, dilué.
Non, ce désarroi insondable ressemblait plutôt au retrait de la mer, à son éloignement vaste et imparable, jusqu'à ce qu'il n'eût plus en lui qu'une baïne où, dans la clarté de l'eau restée prisonnière, flotteraient des objets minuscules, sans identité, comme les résidus calcinés d'une combustion menée à son terme, comme ces infimes particules qui demeurent lors d'une évaporation aboutie (et que l'on eût alors récupéré ces restes pour les remettre dans un liquide et qu'elles flotassent, en autant de corpuscules peut-être vivants mais plus sûrement morts). Il n'y avait rien à voir, il n'avait rien à saisir. Seulement sentir cette étrange et lent tourbillon qui devait lui appartenir sans qu'il sût mettre des mots dessus. Ce n'était pas un débordement, ou une gangrène à extirper : tout au plus une danse de poussières....
Il crut qu'il s'agissait de sa madeleine à lui, macabre et accessible aux seuls instants où il s'en remettait à un ordre qui lui retirait tout pouvoir réel. Il voulut savoir et chercha ainsi à ce que l'expérience se répétant, cette part inconnue mais toujours apparaissant quand il sortait de l'ivresse la plus profonde, une chose qui n'était donc pas fortuite mais une constante de lui-même : un axiome de son existence, cette part, il en lui donna un sens. Il vit donc de loin en loin ce pays à moitié découvert par l'alcool, mais sans jamais sembler s'en approcher le moins du monde. N'était-ce pas là ce qu'il tenait de plus intime : ce moins du monde avec lequel il luttait à chaque instant, quand, à jeun, il jetait un œil fébrile sur le temps qui passait, les jours qui s'écoulaient et la dérision de l'existence.
Il avait donc quelque chose à gagner sur ces terres souterraines, ce point d'ancrage sans localisation autre qu'une perdition incontrôlée à force de whisky ou de tequila, sésames pulvérisés dans l'ensemble de ses boyaux. Il essaya et cette putride soumission au mystère de la baïne le rendit insensible au quotidien. Peut-être était-ce là l'alcoolisme auquel ses amis, avec discrétion, faisaient allusion, comme d'un univers qui ne concernait personne en particulier (ils ne visaient personne...) mais inquiétait. Les inquiétait. Il comprenait bien qu'il s'agissait de lui.
Ils s'éloignèrent. Il s'épuisa, comme d'écoper une cale de bateau à la cuillère. Il y avait ce point, cette intermittence, non du cœur, mais de sa raison d'être, qui fulminait dans la tempête. Il aurait juré ses grands dieux que la rive était proche. Vaine...
Et on l'intuba, un soir, une nuit, il ne savait plus trop. Il fut celui vers lequel on revient pour lui dire qu'il a manqué à chacun, qu'on y pensait, qu'il faisait peur et pleurer. Tout le monde y passa, comme si son lit d'hôpital était leur confessionnal. Ils avaient sans doute des choses à se reprocher, à moins qu'ils ne fissent pour certains une première prise devant la mort, essayant de comprendre comment se comporter dans un moment aussi pénible.
Il partit en convalescence, dans une maison face à la mer. C'était, lui avait-on dit, le meilleur moyen de se refaire une santé. Une infirmière venait matin et soir pour des piqûres et elle vérifiait aussi s'il prenait correctement son traitement. Elle était blonde, comme dans les films et cela l'agaçait. Il pensait que Sarah ne viendrait pas, et c'était mieux pour l'enfant. Il ne voulait voir personne mais ce n'était pas une vraie décision, tout au plus un pis-aller.
Il faisait de longues marches sur la plage, à pas lents, comme un vieux dont on compte les heures. Le matin, la brume venant du large. Chaque jour, ainsi, à voir la marée, cette répétition en décalage incessant du flux et du reflux, où rien ne se gagne ni ne se perd. Il savait que la sobriété était une facilité, la suspension de l'essentiel auquel il n'aurait pas donné de nom. Boire de l'eau désormais avait des airs d'amputation. Il se retirait du jeu dont il était le seul acteur et sans doute était-ce là la vraie douleur, que de ne pouvoir en parler à personne.
Il démissionna de l'amitié, divorça de Sarah, partit de la ville pour un pays où l'alcool est prohibé ; et toujours dans sa poche la seule audace qui semblait lui rester : les poésies sur l'amour et le vin d'Omar Khayyam, dont il enviait la gaieté et la force. Médiocre ascète à ses propres yeux, il hésita plusieurs fois devant la marche à suivre. Il eut la tentation de revenir et même il n'était pas loin de prendre un billet d'avion pour l'odeur des troquets qu'il avait gardée dans sa mémoire, pour le bonheur d'un comptoir, et voir clair en lui, croyant que cette longue thrène qu'il portait en lui, il en comprendrait désormais la langue ; mais sa trace se perd un soir d'orage, dans le désert, alors qu'il est dans le lit d'une rivière soudaine qui n'existe qu'aux heures où le ciel se déchaîne, et l'on retrouve un corps, deux semaines plus tard, raboté, déchiqueté, coincé par un agglomérat rocheux, le corps d'un européen, sur lequel on n'a pas le temps d'enquêter et qu'on enterre, vite, dans la chaleur d'une décomposition purulente.