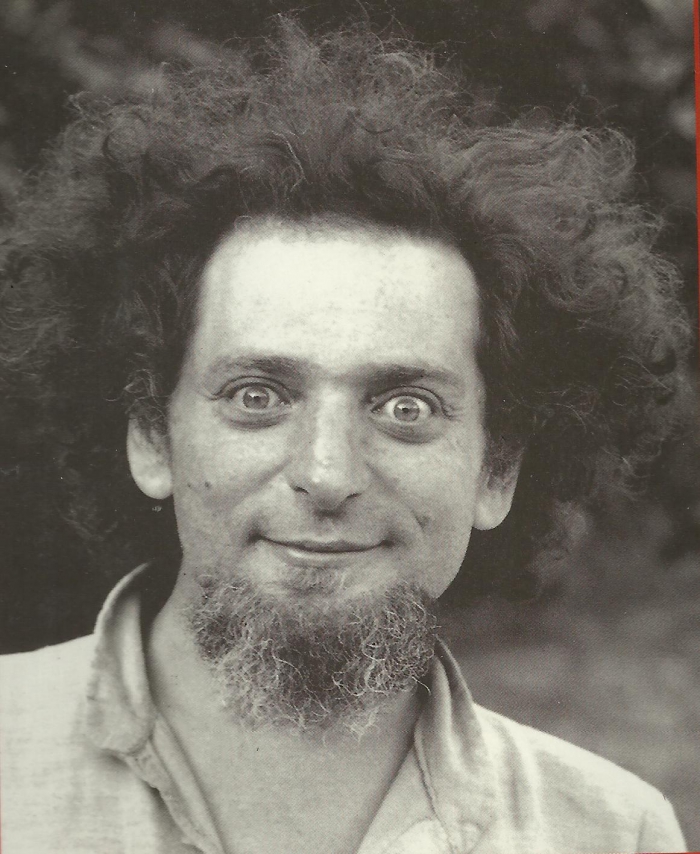Gustave Flaubert nous avait déjà gratifiés d'un Dictionnaire des idées reçues qui ne manquait pas de sel mais en restait justement aux limites du cadre définitoire. On attend que l'écriture se déploie, en vain (certains diront que l'auteur s'était chargé de mettre en scène la bêtise dans ses romans... certes). Avec son Exégèse des Lieux communs, Léon Bloy satisfait notre désir jubilatoire. On y trouve l'acidité, la radicalité d'une fin de siècle qui soulignent combien notre présent est aseptisé. Mais il paraît que l'esprit caustique n'est plus de mise. Il faut une consensualité apaisante, que les mots sont doux (sans doute pour compenser la dureté du monde). Bloy mêle le déchaînement littéraire à un regard acerbe sur ce qui l'entoure, le premier procédant sans aucun doute du second. Des Esseintes, le héros du À Rebours de Huysmans, parle déjà d'«une langue tout à la fois exaspérée et précieuse». Pour ceux qui ne l'aiment guère, et il y en a (la France a ses pestiférés et ses saints, dans une distinction qui mériterait qu'on s'y arrête plus longuement), Bloy, c'est le fiel, la haine, une misanthropie vindicative et lassante. Quand bien cela serait-il, il faut ne pas l'avoir lu pour le réduire à ce jugement. Et s'il fallait considérer la littérature à l'aune de la bien-pensance actuelle, nous aurions une bien petite bibliothèque. Bloy, comme Flaubert, était un homme peu facile. Il n'aimait voir le monde se fourvoyer, ne chantait pas sur les grandes orgues du progrès, voyait avec lucidité s'établir les enjeux d'une idéologie marchande conduisant à l'acculturation massive (et qu'on ne nous parle pas des Trente Glorieuses comme démenti : le bonheur occidental doit tout au spectre communiste, à la peur de l'invasion venant de l'Est. Nous devons moins notre bonheur matériel à nos propre luttes qu'aux menaces d'une extension communiste, aux SS20 et au goulag... Mais la récréation est finie, comme le prouve le mouvement régressif dans lequel nous sommes pris). En ces temps où triomphent la financiarisation du monde et la soumission pleine et entière à la loi du marché, relisons cette page publiée en 1901.
LES AFFAIRES SONT LES AFFAIRES
De tous les Lieux Communs, ordinairement si respectables et si sévères, je pense que voici le plus grave, le plus auguste. C'est l'ombilic des Lieux Communs, c'est la culminante parole du siècle. Mais il faut l'entendre et cela n'est pas donné indistinctement à tous les hommes. Les poètes, par exemple, ou les artistes le comprennent mal. Ceux qu'on nomme archaïquement des héros ou même des saints n'y comprennent rien.
L'affaire du salut, les affaires spirituelles, les affaires d'honneur, les affaires d'État, les affaires civiles même sont des affaires qui pourraient être autre chose, mais ne sont pas les Affaires qui ne peuvent être que les Affaires, sans attribution ni épithète.
Être dans les Affaires, c'est être dans l'Absolu. Un homme tout à fait d'affaires est un stylite qui ne descend jamais de sa colonne. Il ne doit avoir de pensées, de sentiments, d'yeux, d'oreilles, de nez, de goût, de tact et d'estomac que pour les Affaires. L'homme d'affaires ne connaît ni père, ni mère, ni oncle, ni tante, ni femme, ni enfant, ni beau, ni laid, ni propre, ni sale, ni chaud, ni froid, ni Dieu, ni démon. Il ignore éperdument les lettres, les arts, les sciences, les histoires, les lois. Il ne doit connaître et savoir que les Affaires.
-Vous avez à Paris la Sainte-Chapelle et le Musée du Louvre, c'est possible, mais nous autres, à Chicago, nous tuons quatre-vingt mille cochons par jour !... Celui qui dit cela est vraiment un homme d'affaires. Cependant, il y a plus d'hommes d'affaires encore, c'est celui qui vend cette chair de porce, et ce vendeur, à son tour, est surpassé par un acheteur profond qui en empoisonne tous les marchés européens.
Il serait impossible de dire précisément ce que c'est que les Affaires. C'est la divinité mystérieuse, quelque chose comme l'Isis des mufles par qui toutes les autre divinités sont supplantées. Ce ne serait pas déchirer le Voile que de parler, ici ou ailleurs, d'argent, de jeu, d'ambition, etc. Les Affaires sont l'Inexplicable, l'Indémontrable, l'Incirconscrit, au point qu'il suffit d'énoncer ce Lieu Commun pour tout trancher, pour museler à l'instant les blâmes, les colères, les plaintes, les supplications, les indignations et les récriminations. Quand on a dit ces Neuf Syllabes, on a tout dit, on a répondu à tout et il n'y a plus de Révélation à espérer.
Enfin ceux qui cherchent à pénétrer cet arcane sont conviés à une sorte de désintéressement mystique, et l'époque est sans doute peu éloignée, où les hommes fuiront toutes les vanités du monde et tous ses plaisirs et se cacheront dans les solitudes pour consacrer entièrement, exclusivement, aux AFFAIRES.