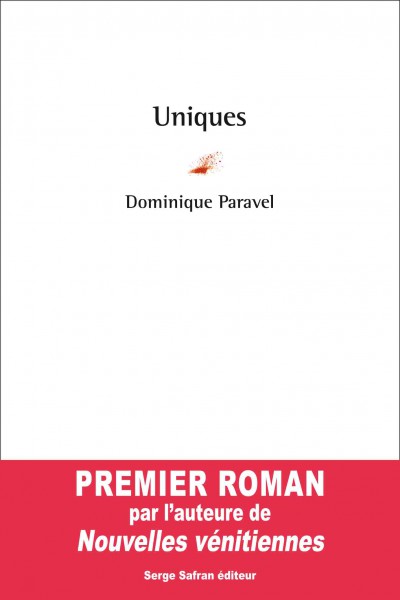Il y a tout juste un siècle, le 14 novembre 1913, paraît Du côté de chez Swann, le plus grand des romans, quoique la formule soit un peu approximative puisque cette œuvre n'est qu'un élément d'un ensemble infiniment plus vaste intitulé À la recherche du temps perdu (que l'on abrège hélas en Recherche du temps perdu, voire en Recherche. Simplification qui tourne à la mutilation tant le "à" est essentiel pour aborder la geste proustienne. Ce n'est pas un état qu'expose l'écrivain -et incidemment le narrateur qui lui sert de relais- mais un travail, une forme en devenir. Le "à" porte sur lui la tension, le désir-vers, sans lesquels on passerait à côté de la grande originalité du propos.)
Mais il est vrai que pour le lecteur de 1913, l'aventure tient encore à ce premier pan (de mur jaune évidemment), ce qui suffit amplement à un bonheur sans fin.
Et pour le lecteur qui vient à Proust, encore aujourd'hui, savoir qu'il s'engage dans une histoire échelonnée sur plusieurs tomes ne change rien. Proust, c'est d'abord le tryptique initial, cette magie à la fois énigmatique et déroutante, où l'onomastique s'affiche d'emblée comme une source de rêverie infinie. Combray -Un Amour de Swann -Noms de pays : le nom.
Tryptique qui décontenance par ses ruptures de temps, d'univers, de personnages, même si l'on sent des affinités et des apparentements symboliques, entre le narrateur et Charles Swann, notamment.
La grandeur prend forme immédiate dans le style. D'abord le style, comme un éventail qui se déploie. Audace kaléidoscopique de la syntaxe en accord (plutôt qu'au service de) avec l'exploration du monde et des êtres. L'objet et les moyens se confondent. Ils fondent la singularité de l'auteur, cette unicité rébarbative poussant certains à renoncer. Proust, intellectuel et précieux (dans un sens que parfois certains déplorent), raffiné, affecté : autant de qualificatifs possibles pour la clôture à peine voilée d'un monde qui va en effet s'achever dans moins d'un an après la parution du roman. 14-18 : le grand chambardement. Un monde qui ne devrait plus nous concerner, sinon sous l'angle archéologique. Trop de duchesses, selon le mot malencontreux de Gide.
Mais il est trop simple de réduire Proust à ces longues digressions sur les arts ou à ces analyses méticuleuses des uns et des autres. Qu'il ait pensé aux intermittences du cœur comme titre ne doit pas laisser penser que l'intéresse la seule cartographie des sentiments qu'il esquisse (esquisse est le mot, non par le fait de sa possible imprécision mais parce qu'il explore moins la certitude de ce que l'on sait que le flottement autour de ce que l'on apprend. Degré d'incertitude fracassant et cruel : Swann l'incarne déjà, et lorsqu'on sait, il est trop tard.).
À cette esquisse il faut ajouter le circuit sensible du monde que le lecteur ne verra plus comme avant, soit parce qu'il le découvrira à travers le livre et replongera dans la réalité avec un autre œil, soit parce qu'il revisitera sa propre existence au tamis de son expérience de lecteur. Et c'est dans son prosaïsme sublimé que Proust est aussi merveilleux. L'odeur des lilas, l'œil trompé à guetter une fenêtre, la couleur aigrelette d'un arrosoir vert, le goût d'un cognac, la chambre sentant l'église et le médicament, l'attrait étrange d'un visage vulgaire. En fait, le temps perdu, nécessairement perdu, qui forme bientôt la charpente du lieu où l'on se réfugie, est là pour échapper à l'autre temps perdu, celui des occupations vaines, dévorantes, fastidieuses. Écrire que Proust serait la vie n'a pas de sens. Il est seulement (mais déjà...) cet addendum au monde évoqué par Gracq dont la force vient d'un mélange de secrets, ceux qu'il nous révèle et ceux dont il nous délivre.
Le prosaïsme de Proust fait œuvre dans cette double délivrance. Il ne se faufile pas toujours que dans les salons, pour discuter avec de belles femmes à chapeaux. Il y a aussi ces autres lieux magnifiés, comme des vitraux du quotidien. Ainsi la cuisine de Françoise...
"À cette heure où je descendais apprendre le menu, le dîner était déjà commencé, et Françoise, commandant aux forces de la nature devenues ses aides, comme dans les féeries où les géants se font engager comme cuisiniers, frappait la houille, donnait à la vapeur des pommes de terre à étuver et faisait finir à point par le feu les chefs-d'oeuvre culinaires d'abord préparés dans des récipients de céramistes qui allaient des grandes cuves, marmites, chaudrons et poissonnières, aux terrines pour le gibier, moules à pâtisserie, et petits pots de crème en passant par une collection complète de casserole de toutes dimensions. Je m'arrêtais à voir sur la table, où la fille de cuisine venait de les écosser, les petits pois alignés et nombrés comme des billes vertes dans un jeu ; mais mon ravissement était devant les asperges, trempées d'outre-mer et de rose et dont l'épi, finement pignoché de mauve et d'azur, se dégrade insensiblement jusqu'au pied – encore souillé pourtant du sol de leur plant – par des irisations qui ne sont pas de la terre. Il me semblait que ces nuances célestes trahissaient les délicieuses créatures qui s'étaient amusées à se métamorphoser en légumes et qui, à travers le déguisement de leur chair comestible et ferme, laissaient apercevoir en ces couleurs naissantes d'aurore, en ces ébauches d'arc-en-ciel, en cette extinction de soirs bleus, cette essence précieuse que je reconnaissais encore quand, toute la nuit qui suivait un dîner où j'en avais mangé, elles jouaient, dans leurs farces poétiques et grossières comme une féerie de Shakespeare, à changer mon pot de chambre en un vase de parfum.
La pauvre Charité de Giotto, comme l'appelait Swann, chargée par Françoise de les « plumer », les avait près d'elle dans une corbeille, son air était douloureux, comme si elle ressentait tous les malheurs de la terre ; et les légères couronnes d'azur qui ceignaient les asperges au-dessus de leurs tuniques de rose étaient finement dessinées, étoile par étoile, comme le sont dans la fresque les fleurs bandées autour du front ou piquées dans la corbeille de la Vertu de Padoue. Et cependant, Françoise tournait à la broche un de ces poulets, comme elle seule savait en rôtir, qui avaient porté loin dans Combray l'odeur de ses mérites, et qui, pendant qu'elle nous les servait à table, faisaient prédominer la douceur dans ma conception spéciale de son caractère, l'arôme de cette chair qu'elle savait rendre si onctueuse et si tendre n'étant pour moi que le propre parfum d'une de ses vertus.
Mais le jour où, pendant que mon père consultait le conseil de famille sur la rencontre de Legrandin, je descendis à la cuisine, était un de ceux où la Charité de Giotto, très malade de son accouchement récent, ne pouvait se lever ; Françoise, n'étant plus aidée, était en retard. Quand je fus en bas, elle était en train, dans l'arrière-cuisine qui donnait sur la basse-cour, de tuer un poulet qui, par sa résistance désespérée et bien naturelle, mais accompagnée par Françoise hors d'elle, tandis qu'elle cherchait à lui fendre le cou sous l'oreille, des cris de « sale bête ! sale bête ! », mettait la sainte douceur et l'onction de notre servante un peu moins en lumière qu'il n'eût fait, au dîner du lendemain, par sa peau brodée d'or comme une chasuble et son jus précieux égoutté d'un ciboire. Quand il fut mort, Françoise recueillit le sang qui coulait sans noyer sa rancune, eut encore un sursaut de colère, et regardant le cadavre de son ennemi, dit une dernière fois : « Sale bête ! » Je remontai tout tremblant ; j'aurais voulu qu'on mît Françoise tout de suite à la porte. Mais qui m'eût fait des boules aussi chaudes, du café aussi parfumé, et même... ces poulets ?... Et en réalité, ce lâche calcul, tout le monde avait eu à le faire comme moi"
Du côté de chez Swann, I, II (Combray)