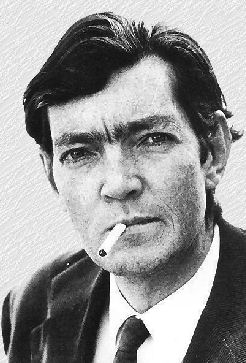À la fin d'un ouvrage passionnant sur le devenir des mégalopoles et des territoires urbains, Jean-Paul Dollé a ajouté un post-scriptum intitulé «Après le 11 septembre. Capitale de l'Empire et ville-monde» dans lequel, notamment il fait une distinction entre l'attentat manqué contre Washington et ceux, réussis, contre New York. Il remet dans une perspective historique un événement devant lequel on a trop souvent lu et entendu des positions qui se définissaient selon un axe pro/anti américain simpliste. Il conclut ainsi :
«Quand New York est agressée, c'est (les amoureux de la liberté) qu'on agresse. Ceux qui haïssent New york la haïssent parce qu'elle les fascine : New York-Satan, New York-Babylone -image de la corruption, de la dépravation. New York : lieu du péché, des orgies furieuses, de la liberté des femmes, des identités sexuelles vacillantes, des gays, des sexualités multiples. C'est cela qu'ils haïssent, à proportion de leur terrible envie, envie à mourir et à faire mourir. Il faut empêcher Satan, l'ange le plus séduisant, donc le plus désirable, de nuire -de séduire, de fasciner. À mort donc !
Depuis les débuts de l'humanité, ce sont les mêmes pulsions de désir, de haine et de ressentiment que suscite la ville-monde cosmopolite : l' «urbicide», comme l'appelle Bogdanovitch -qui sait de quoi il parle pour avaoir été le maire de Belgrade, et compris que la fascination-répulsion des paysans vis-à-vis de ce que représente la ville cosmopolite était la source principale des guerres qui ont déchiré l'ex-Yougoslavie. L'urbicide, après s'être acharné contre Paris-la-putain, Berlin-la-dégénérée de la République de Weimar, prend aujourd'hui comme cible New York.
N'attire pas la haine des tueurs sacerdotaux qui veut. N'obtiennent cet honneur que les villes-monde, les villes lumières, les villes lupanar.
La haine des villes-monde s'étend, de proche en proche, à la haine de la mixité sexuelle et donc sociale, à la haine de l'urbanité et de la civilisation. Attaquer New York, ce n'est pas seulement attaquer une métropole mondiale située aux USA : c'est attaquer chacun de ceux qui se sentent participer de la même civilisation humaine, ou qui y aspirent. Alors que le coup porté à Wahington peut être considéré comme une déclaration de guerre contre les USA, condamnée par ses alliés et laissant indifférente tous ceux qui refusent l'imperium américain, l'agression contre New York concerne tous ceux qui refusent la barbarie. Tous les amis de la liberté, tous ceux qui aspirent à ce qu'un monde habitable soit possible ont toutes les raisons de proclamer «Nous sommes tous new-yorkais». New York est devenue à jamais une icône exemplaire dans la longue histoire de la liberté humaine.
La cause est entendue. Il s'agit bien pour les «islamistes radicaux» d'une guerre radicale contre le monde. Il ne peut y avoir aucun compromis entre eux et le reste du monde. Quand bien même s'opposerait-on à la superpuissance américaine -et dans la mesure même où on s'y oppose- New York représente à jamais la liberté anti-impériale, qui constitue la ville-monde comme telle.»
Jean- Paul Dollé, Métropolitique, Paris, éditions de la Villette, 2002.