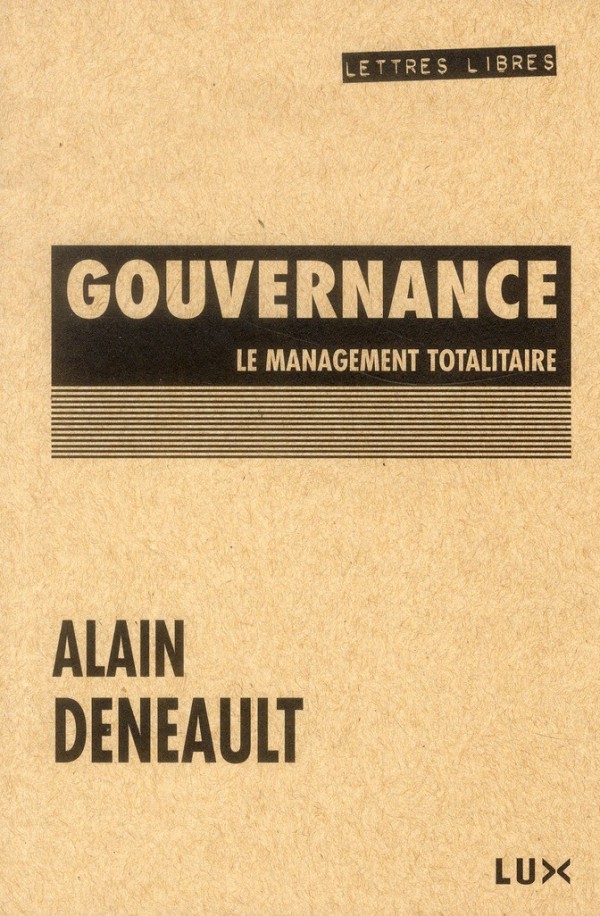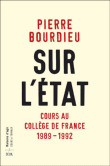Le sociétal, comme on dit, n'est pas le social, moins encore le politique. Cela pourrait l'être, d'une certaine manière. Être un élément du politique. Encore faudrait-il qu'il y ait une véritable politique. Et lorsque moi-président est élu en mai, sur la base qu'avec lui (entendons : à l'inverse de celui dont il va prendre la place), tout sera différent, que la gauche vient au pouvoir pour vaincre le seul ennemi qui vaille, l'invisible et si puissante finance, c'est un miroir déformant du politique qu'il projette aux yeux de l'opinion. Opinion qui y croit, qui va voter massivement (quand même...), qui chante le dimanche soir, et qui sent, dit-on, que l'air est soudain devenu respirable.
Si nous n'avions pas à payer le prix de cette escroquerie (et je la paie, moi, bien moins que d'autres...) on pourrait en rire mais la nudité-nullité de la pensée au pouvoir est telle qu'il lui faut absolument se battre sur des détails, sur des effets d'annonce. C'est l'utilité du sociétal. L'affaire ne serait pas nouvelle (la défense de l'école privée, le CIP, le PACS,...), dira-t-on. Si, pourtant...
La gauche qui est désormais au pouvoir est une droite de rechange. La droite qui doit se charger des besognes libérales dont la droite visible ne peut s'acquitter. Et cela pour deux raisons : parce qu'une partie de son électorat n'en voudrait pas (ceux que la doxa qualifiera de cathos, fachos, réacs...), parce qu'elle risquerait, cette droite, de voir débouler dans la rue des manifestations qui ne seront pas organisées par une base de «gauche» face à un gouvernement qu'elle a aidé à porter au pouvoir. La gauche est une droite de rechange, dis-je, c'est-à-dire qu'elle s'est fondue dans le moule libéral, qu'elle en a adopté les principes fondamentaux, au-delà même de ce que représente, et c'est un beau paradoxe, la droite classique, conservatrice. Pour l'écrire autrement, la gauche est aujourd'hui économiquement plus à droite qu'une partie de l'opposition qu'elle fustige...
Prenons le mariage pour tous. Laissons de côté, même si cela a son importance, l'effet neutralisant du débat qui se déploie à ce sujet. La vive polémique a son importance en ce qu'elle est un agent masquant d'une politique qui suit à la trace (et qui ira plus loin, c'est certain) celle menée par Sarkozy. Était-il urgent de débattre sur le droit des homosexuel(le)s à se marier ? Etait-ce intelligent que dans la torpeur de l'été on décide de mettre en avant cette énième proposition moi-président, quand celui-ci avait déjà renié des engagements plus lourds, à commencer par le traité budgétaire ? Certains diront que non, évidemment, et ils ont raison, d'une certaine façon. Ils ont raison si l'on se place du point de vue des impératifs économiques de crise (1), si l'on se place sur le seul plan de la réactivité gouvernementale face à une situation d'urgence. En revanche, il est tout à fait logique que la gauche se précipite sur cette question, quand elle a entériné tout l'appareil idéologique de l'économie libérale. Il lui reste à faire le travail sur le plan sociétal, justement.
La transformation fondamentale de l'ultra-libéralisme, au regard de sa forme plus ancienne, est le glissement progressif de l'économie dans toutes les sphères de l'espace social et individuel. C'est faire que tout soit monnayable, que tout puisse entrer dans des rapports d'intérêt transposables sur le plan d'un échange financier. C'est là qu'intervient une nouvelle définition de la liberté. Celle-ci n'est plus constitutive d'une construction individuelle, sur un plan philosophique (pour faire court), accréditant l'idée d'une possible émancipation des personnes ; elle est un signe, comme les objets sont des signes (pour reprendre Baudrillard). La liberté fait signe, et en tant que telle, elle est soumise à la loi des signes qui, en territoire libéral, impose sa conversion en acte économique.
Le mariage pour tous doit se concevoir comme un acte faisant progresser l'activité économique libérale d'un degré de plus. Le problème n'est pas tant de placer chacun sur un pied d'égalité au nom du droit de s'aimer (2) que de poser les bases d'un droit à la procréation par assistance médicale, ce qui revient à créer un marché de mères porteuses (3). On peut nous emballer l'affaire sous les mots de l'amour (belle blague ! Depuis quand le mariage est affaire d'amour ! Il suffit de lire le Code civil pour se convaincre du contraire. C'est un contrat...), il ne faut pas être dupe. Le mariage pour tous est l'ouverture vers les dérives mercantiles mettant en jeu des enfants, que des couples ayant les moyens pourront s'offrir. C'est la possibilité de monnayer la grossesse. Sur ce point, Pierre Bergé a eu l'heureuse bêtise de formuler de manière cinglante l'enjeu du débat, quand il déclarait le 16 décembre dernier :
"Nous ne pouvons pas faire de distinction dans les droits, que ce soit la PMA, la GPA ou l'adoption. Moi, je suis pour toutes les libertés. Louer son ventre pour faire un enfant ou louer ses bras pour travailler à l'usine, quelle différence ? C'est faire un distinguo qui est choquant."(4)
Le propos a choqué. On peut comprendre, mais ce serait une grave erreur de l'attribuer au débordement d'un esprit atteint de sénilité. Ceci dit sans ironie. Ce propos est en fait le dévoilement d'une conversion radicale de la gauche à cette logique de marché jouissif, telle qu'en parlait déjà Fredric Jameson quand il envisageait les transformations culturelles du capitalisme tardif. Et sur ce plan, certains ont acquiescé plus vite que d'autres aux débordements du libéralisme hédoniste. Le mariage pour tous est le fruit d'un lobbying gay parisien, de gauche, forcément de gauche, qui, plutôt que de s'interroger sur ce qu'est la vraie homophobie (ce qui lui demanderait de reconsidérer les concepts de classe à l'aune de la relégation sexuelle (5)) veut à la fois la conformité pour jouir du possible (avoir des enfants) et la différence pour jouir tout court. Rappelons à cet effet que la jouissance est un terme de droit (avoir la jouissance d'un bien), et c'est bien de droit qu'il est question ici, et d'un droit qui à un coût.
Or, et c'est un fait économique, une certaine gentry homosexuel a les moyens de faire face à ces dépenses médicales ; elle a les moyens de louer un ventre, de négocier la gestation (n'est-ce pas charmant) (6). L'ultra-libéralisme a le devoir de trouver encore et encore des marchés. Il peut le faire en mettant en marche deux éléments complémentaires : les ressources de la technologie et la promotion, sous des formes trompeuses, de la liberté individuelle. L'indifférenciation sexuée, la substitution du genre au sexe, cette récupération post-soixante-huitarde des revendications pseudo-libertaires ne sont que des stratégies pour élargir le champ d'investigation économique (7).
L'élargissement de l'économie à toutes les sphères possibles a de plus grande chance d'aboutir lorsque tous les principes millénaires et les puissances qui essaient d'en limiter les effets sont mis à mal, sont ridiculisés et voués à n'être plus que balivernes. C'est bien pour cela, notamment, que les partisans du mariage pour tous se sont acharnés comme jamais sur l'église catholique, sur les cathos. Ils ont bien compris que l'enjeu était de taille (8).
Pour ce faire, il faut des gens capables d'enjoliver le changement, de proposer le progrès (sans dire de quoi il retourne vraiment) contre la réaction, de promouvoir la liberté contre l'oppression, de brandir l'étendard du respect contre le drapeau noir de l'intolérance. C'est la logique du plus. Le mariage pour tous est un plus, et le plus ne peut être que bon. Et le bon, parce que l'histoire a été ainsi écrite, ne peut être que de gauche. C'est au nom de ce diktat progressiste qu'une philosophe de salon, une dénommée Beatriz Preciado, ci-devant directrice du Programme d'études indépendantes musée d'Art contemporain de Barcelone (Macba) éructe initialement dans Libération du 15 janvier sur les contestataires :
"Les catholiques, juifs et musulmans intégristes, les copéistes décomplexés, les psychanalystes œdipiens, les socialistes naturalistes à la Jospin, les gauchos hétéronormatifs, et le troupeau grandissant des branchés réactionnaires sont tombés d’accord ce dimanche pour faire du droit de l’enfant à avoir un père et une mère l’argument central justifiant la limitation des droits des homosexuels."
Le lecteur appréciera ces raccourcis magnifiques et le vocabulaire. L'hétéronormatif est splendide : une manière d'avilir l'hétérosexualité en la faisant passer pour une banalité petite bourgeoise, un conformisme pisse-froid, une sordide obéissance à la logique procréatrice. Mais d'apprendre qu'elle est proche des queer culture et qu'elle est la compagne de Virginie Despentes m'éclaire, sans me rassurer : je sais depuis quelque temps déjà que les révolutionnaires en chambre sont les pires compagnons d'armes de l'horreur. (9)
La boucle est bouclée.
(1)Quoique ce que j'écris là soit un peu biaisé puisqu'il est faux de dire que nous sommes en crise. La crise est un moment, l'acmé d'une situation qui s'est développée, un moment décisif. Or nous sommes depuis près de 40 ans en crise. Tout simplement parce que c'est l'ordre même du monde soumis à un économisme croissant et destructeur. Ceux qui pensent qu'un jour quelqu'un nous en sortira se leurrent. Il faudrait alors repenser la totalité du développement. La dégénérescence du système, et la mort politique, économique et sociale qui en résultera, violente, impitoyable, aura eu raison de toute les jugements.
La krisis grecque était l'acte de trancher devant une situation confuse et incertaine. On voit bien que la confusion et l'incertitude sont, paradoxalement, le fondement d'une économie ultra-libérale, fonctionnant sur la précarisation des acteurs et le flottement des situations...
(2)Auquel cas, n'en déplaise aux plus audacieux : il faudrait reconnaître à deux adultes (un frère et une sœur) le droit de se marier. Le mariage n'est donc pas pour tous, en dépit de son appellation marketing pour ne pas dire qu'il s'agit d'un mariage homosexuel.
(3)Pour couper court à toute critique sur ce point, je précise que je suis contre les procédures de procréation assistée, qu'elles soient destinées aux hétérosexuels ou aux homosexuels. Sur ce plan, la science se doit d'avoir des limites et l'individu se doit de concevoir que son bon plaisir n'est pas tout.
(4)PMA : procréation médicalement assistée
GPA : gestation par autrui
(5)Dans les banlieues par exemple, ou dans l'espace culturel maghrébin, où l'homophobie est tenace. Mais il lui faudrait, à cette côterie, penser l'Autre dans sa diversité problématique, le comprendre, l'affronter, débattre avec lui, et ne pas le voir seulement comme jouet d'une bonne conscience. Il lui faudrait quitter ce côté gidien qui ne la lâche pas : l'exotisme de l'enculage est une philosophie méprisable...
(6)Car c'est une ficelle grossière que de découpler (!) mariage pour tous et PMA. À partir du moment où le mariage homosexuel est posé comme l'égal du mariage hétérosexuel, il n'est plus constitutionnellement possible de limiter les droits du second par rapport au premier. Tout étudiant de licence de droit le sait bien...
(7)Le cri des hirsutes de 68 « il est interdit d'interdire » est, comme c'est étrange !, un programme que ne désavoueraient pas les tenants d'un marché libre, capable de régler de lui-même les conflits.
(8)Ce qui explique d'ailleurs les attaques violentes contre les évêques, quand, par ailleurs, on ménageait les autorités musulmanes (le recteur de la mosquée de Lyon avait précédemment manifesté...)... Sans doute, parce que cela aurait mis en porte-à-faux les tenants du différentialisme et du droit-de-l'hommisme.
(9)Qui se ressemble s'assemble. J'invite donc le lecteur à la délectation (soyons kantien...) des œuvres (?!) littéraires et cinématographiques de Virginie Despen
Par ailleurs, j'entends, en même temps, la complainte de cette Preciado. Elle a le précieux dans son nom, et elle y croit. Et croit sans aucun doute que le libéralisme de mœurs espagnol est une manière de conjurer le sinistre héritage franquiste. Mais elle devrait savoir, si elle avait un tantinet de cervelle, que l'escalade de la négation pour abolir un régime abject (ce que fut le franquisme) est justement le meilleur moyen de le réhabiliter, de gommer en lui la caricature qu'il fut, de donner à ses nostalgiques les moyens de leur retour politique. Elle devrait, en plus, s'interroger sur le fait que les pays catholiques les plus permissifs sont ceux qui ont subi la crise libérale la plus sévère, à commencer par l'Argentine. Mais penser le politique autrement que par le prisme du cul, de la chatte et de la bite est une chose fort difficile pour certain(e)s intellectuel(le)s soi disant émancipé(e)s...
photo : Antoniol Antoine /SIPA