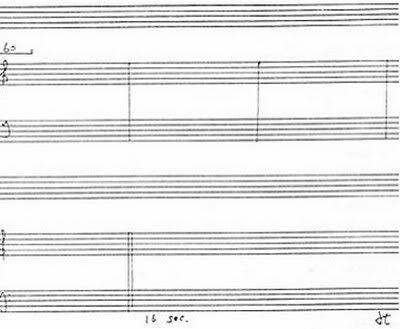Places est un des plus beaux opus de Mehldau accompagné de Jorge Rossy et Larry Grenadier. Peut-être est-ce le fait d'avoir construit cet album autour d'une thématique à la fois unificatrice -transposer sur la portée l'esprit des lieux- et ouverte, tant la diversité des endroits évoqués est grande... Car il s'agit bien d'un imaginaire aléatoire qui peut réunir des lieux aussi étrangers les uns des autres que le sont Los Angeles, Madrid, Perugia ou Schloss Elmau, en Bavière.
Mais il y a chez ce pianiste une faculté à toucher ce qui lui est intime (d'une manière ou d'une autre, puisque tel ou tel endroit est choisi parmi les innombrables qu'il a pu connaître) tout en nous emportant dans une rêverie collective. Sur ce plan, la composition consacrée à Paris est saisissante. Le cheminement mélancolique, quasi début de siècle (le XXe, évidemment), est celui d'un matin silencieux, le lever du jour après une nuit blanche. Un hommage à Debussy, une traîne douce, et plus lointaine, de Chopin sans doute aussi. Il faut attendre que tout, dans le cœur, se remette en place. Les cafés un peu chic sont fermés ou presque. Reste une grande terrasse vide, où l'on sert un Armagnac qui vous servira de soleil, pendant que les nuages s'étirent. On s'amuse du va-et-vient qui papote crescendo. Un ami passe. Il surprend votre engourdissement, s'installe et vous raconte sa folle odyssée chez Marianne qui est complètement folle, mais si belle, si rousse, et elle vit, comme dans les romans, dans une chambre sous les toits, et même s'il a fallu déguerpir en quatrième vitesse, parce que son mec revient dans la matinée, et qu'elle redevenait sérieuse, il a ri, ri, en dévalant quatre à quatre les escaliers de la rue des Canettes, il en rit encore et vous riez avec lui...
Les commentaires sont fermés