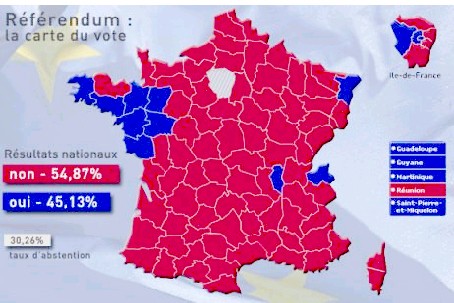La professionnalisation du monde politique n'est pas récente. Elle va de pair, dans les pays de tradition démocratique ancienne (en Europe), avec une importance donnée à la sphère publique comme centre de décisions de plus en plus complexes, lesquelles décisions demanderaient une expérience de plus en plus soutenue, une vision d'ensemble que seuls des cerveaux qui se sont destinés à la chose publique pourraient appréhender.
C'est bien ainsi que se justifient les happy few du politique pour, et particulièrement en France, traverser les décennies, comme si leurs échecs successifs, leurs approximations ne comptaient pas, tant le petit peuple n'est pas en mesure de comprendre ce qui les anime, cet intérêt général fourre-tout, masquant d'abord leurs ambitions.
Ils sont devenus le personnel politique, sorte de caste d'un château imaginaire qu'est la nation, dont ils seraient les gardiens. Une sorte de domesticité de la patrie. On a envie de les louer, devant tant d'abnégation et de désintéressement. Ils ont dû lire Kant...
On les croirait presque, et certains y croient effectivement. Peut-être même ne faut-il pas être aussi injuste, si l'on pense au menu fretin de la représentation nationale, les députés lambdas, godillots d'un système cadenassé par quelques nababs à l'ego démesuré... Ces médiocres (au sens classique, s'entend) ne sont pas à mépriser, sinon que, par le nombre, ils auraient moyens sans doute de redresser la barre. Il n'en est pas de même des têtes de série.
Et puisqu'en ce jour, le déferlement électoral va bon train, rappelons que les visages les plus connus du personnel politique ne cessent d'afficher à ceux dont ils sollicitent les suffrages un mépris souverain. Parce que c'est mépris que de se soustraire, au moindre risque d'échec, à la décision démocratique. Cette attitude n'est pas de droite, n'est pas de gauche. L'indignité morale se distribue également et deux exemples suffiront, exemples qui transcendent les partis et les générations.
Alain Juppé devait se présenter à la députation mais le score plus que médiocre de Sarkozy dans sa circonscription l'a persuadé qu'il y avait péril en la demeure. Dès lors, lui qui dirigeait et Bordeaux et la diplomatie française, rien de moins, nous a gratifiés d'un retrait réfléchi, d'homme responsable, pour pouvoir se consacrer pleinement à la cité qu'il dirige. On espère que cette défausse augure d'un retrait plus large et que le meilleur d'entre nous, comme l'appelait le grand Jacques, répondra enfin à la tentation de Venise.
Najat Vallaud-Belkacem, fraîchement promue ministre de la condition féminine (ce qui ne veut rien dire, puisqu'à ce titre ne répondent ni budget, ni administration, ni espace de compétence spécifique...), avait depuis longtemps annoncé son désir de conquête législative. Mais, là encore, le risque important de défaite, et incidemment de démission gouvernementale, l'a convaincue de renoncer pour se consacrer, dit-elle, pleinement à sa nouvelle tâche.
Dans un cas : l'orgueil méprisant. Dans l'autre, le souci de ne pas perdre son travail. Dans les deux, le narcissisme foulant au pied l'éthique démocratique. Le peuple n'est bon et respectable que lorsqu'il vote dans le sens qui vous arrange. C'est ainsi que le personnel politique tourne l'affaire en une politique personnelle...
D'aucuns diront que ce sont des épiphénomènes, qu'il faut composer avec les passions humaines, et qu'il y a quelque mesquinerie à relever ce qui n'est pas significatif. Sauf que ce n'est pas significatif, c'est signifiant...
Les commentaires sont fermés.