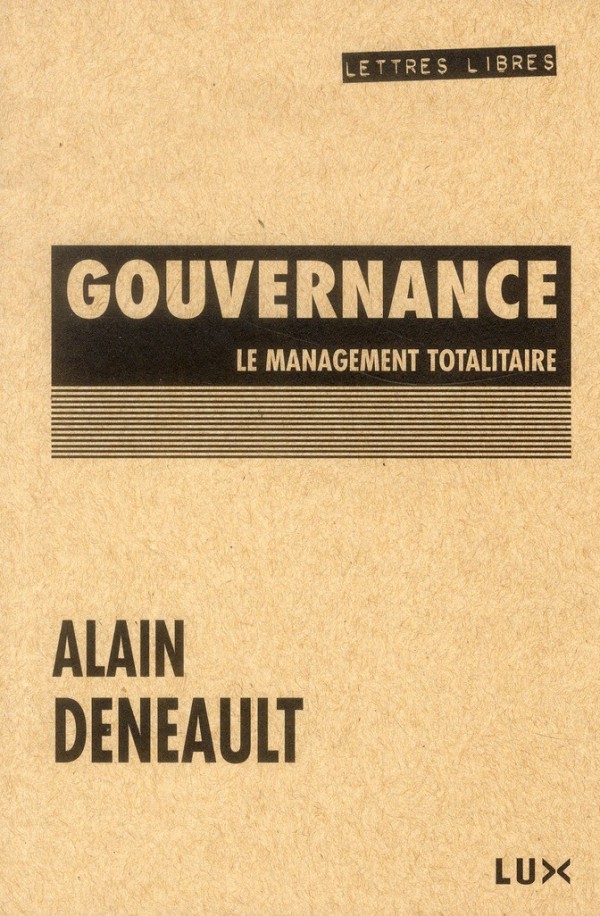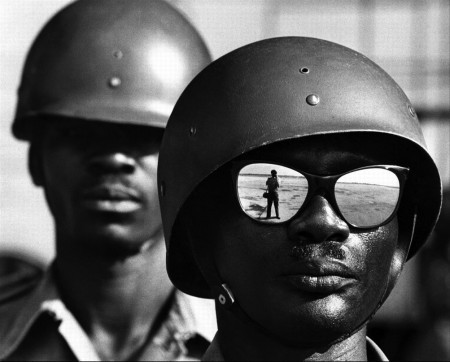L'affaire Méric aura donné lieu à une belle débauche de propagande quasi soviétique. Nous aurons assisté ces derniers jours à un exemple de terreur médiatique et de manipulation, à vous rappeler dans la minute les pages décapantes de Serge Halimi quand il écrivait sur les Nouveaux Chiens de garde (1).
Les faits sont ce qu'ils sont et la peine des parents de la victime ne me concerne pas plus que celle de tout parent qui perd un enfant : cela arrive tous les jours et dans des circonstances dont la violence est comparable à ce qui est advenu la semaine dernière. Nous sommes dans l'ordre du privé et la common decency implique que l'on reste à sa place. Le problème n'est pas de s'apitoyer, de tourner l'histoire d'une rixe entre extrémistes en préfiguration d'une montée du fascisme et fissa, à l'image de l'inutile Vallaud-Belkhacem, de demander aux media de ne pas se faire les relais des idées néo-nazis et d'extrême-droite. Ridicule porte-parole d'un gouvernement non moins ridicule et nuisible, faut-il rappeler à sa culture politique que ce fut Mitterrand qui obligea à ce qu'on ouvrît l'espace médiatique à Le Pen, dans les années 80, pour amoindrir la droite ? Faut-il lui rappeler que ce furent ses vieux copains socialistes qui, pour sauver des sièges, introduisirent de la proportionnelle en 1986 et offrirent à Le Pen and co 35 députés ? Est-il possible d'énumérer les média complices des idées brunes ? Voudrait-elle brider l'espace d'expression, voyant dans Le Figaro, Valeurs actuelles et La Croix les vers pourrissant la démocratie ? Bergé vient bien d'accuser Frigide Barjot d'avoir du sang sur les mains. Tout est possible en cette France nourrie de bêtise. Mais l'amalgame est un jeu connu des aspirants autoritaires...
Quelle terreur, donc ?
Un simple glissement sémantique, en fait. Clément Méric fut d'abord médiatiquement un militant d'extrême-gauche. Mais cela n'était guère porteur, eu égard à la manière dont la classe politique institutionnalisée, à commencer par le parti de la rose, traite habituellement cette engeance agitée. Était-il possible de se mettre du côté d'un trotskyste ou apparenté ? Problème sans doute. On ne pouvait pas, sans être en porte-à-faux et dépasser le compassionnel, tenir la ligne politique qui, paraît-il, plaçait la victime du côté des extrêmes, car il faudrait alors envisager un jour de devoir tenir la même posture pour la mort, dans un combat de rue, d'un facho patenté. Il fallait le ressort de la langue de bois et des fausses moustaches pour convertir le débit en crédit. La requalification de la langue est un des modes les plus classiques de la terreur, parce qu'elle s'impose par le haut : elle est un signe non seulement du pouvoir en soi mais aussi l'affirmation de son droit illimité à redéfinir le réel à sa convenance. Cela n'a rien à voir avec la polysémie ou la métaphore. Ce à quoi on assiste alors est un transfert symbolique mettant entre parenthèses (ou annulant même parfois) le partage commun du sens. Telle a été, en moins d'une journée, la transmutation de l'élément politique.
Ainsi parut-il que c'était un militant non plus d'extrême-gauche mais antifasciste qui avait trouvé la mort. L'antifascisme est pratique : il ouvre la clé des bonnes âmes et impose le respect, c'est-à-dire le silence. Il a de plus l'avantage d'être soluble dans la doctrine libérale (fût-elle maquillée en bavardages de gauche). Il est le blanc-seing par quoi certains s'achètent ou se rachètent une virginité. Mieux encore : c'est une étiquette fédératrice, devant laquelle vous n'avez plus qu'à vous taire. Vous êtes, vous devez être anti-fasciste, pro mariage gay, aimé le progrès, être de gauche, mondialiste (2). Au fond, l'identité démocrate française, aujourd'hui, c'est un peu comme le formulaire que vous remplissez quand vous allez aux États-Unis : le choix est réduit et contraint. Antifasciste, donc, la victime, ce qui supposerait en bonne logique (je veux dire, quand on applique un principe d'équivalence des termes) qu'extrême-gauche et antifasciste soient synonymes. Pourquoi pas ? C'est en tout cas un brevet de bonne conduite absolument imparable. Les staliniens du PC en usèrent pendant des décennies pour couvrir les horreurs du Goulag, la Révolution culturelle chinoise et le soutien aux Khmers rouges. Ce genre de révisionnisme historique est pour le moins répugnant et suppose que l'on fasse des confusions malhonnêtes dans les époques. Mais de telles pratiques sont le fondement même de ce qu'on appelle la propagande, eût-elle les apparences des pensées les plus nobles. L'antifascisme, comme position politique, mérite mieux qu'un traitement postiche, qu'un accommodement de circonstances. Or, les socialistes et les journalistes soumis à leurs intérêts ont œuvré en ce sens, un peu comme ils l'avaient fait un an plus tôt dans l'affaire Mérah. Il faut croire qu'ils n'ont pas eu honte de leurs raccourcis d'alors et qu'on leur a vite pardonné ces pratiques nauséabondes.
J'ai connu dans ma jeunesse des autonomes et des anarchistes qui avaient eux aussi des gros bras qui aimaient la baston et j'aurais craint certains soirs de les croiser. Ce sont d'ailleurs eux avec qui la police des gouvernants socialistes ont parfois eu mailles à partir. Mais ce n'est évidemment pas le sujet. Ce n'est jamais le sujet.
Dès lors, comment ne pas rester amèrement dubitatif devant cette énième tentative de récupération, devant cet énième travail de moralisation confondante de la part de ceux qui pensent avoir pour eux, ad vitam aeternam, les valeurs universelles (3) ? Il est ridicule et sommaire de penser que de telles arguties médiatiques puissent encore longtemps faire illusion. Ces procédés sont propres à creuser plus encore le fossé entre les politiques et la population. Éluder la réalité en recourant à des recettes aussi éculées consterne.
Une mienne connaissance me faisait justement remarquer que le mis en examen est fils d'émigré espagnol, d'origine modeste, quand la victime est fils de professeurs de droit. Il y a là comme une inversion symbolique. Le garçon issu du peuple, qu'on aurait attendu à l'extrême-gauche, est à l'extrême-droite, quand le fils de bourgeois s'entiche des rêveries trotsko je ne sais quoi. Les sociologues à la petite semaine, qui ne voient pas grand chose du monde mais qui aiment discourir sur les plateaux télé, devraient prendre en considération ce bouleversant paramètre. Ce serait, me semble-t-il, plus intéressant, plus porteur, pour analyser la décomposition sociale d'un pays livré aux vents frais du libéralisme intégral, que de pavoiser à la couleur des étendards de quelques anars et autres ultra-gauchistes de salon comme on en trouve à Sciences-Po (avant que de rentrer dans le rang des pantouflages rémunérateurs). Il ne s'agit nullement de défendre qui que ce soit, de trouver des excuses à qui que ce soit mais il est intolérable que l'argument social et politique soit la propriété des mêmes. On aurait par exemple aimé entendre les instances de l'État s'exprimer sur le passage à tabac d'un prêtre le 13 mai dernier. Pas une ligne dans Le Monde, dans Libération.
Antifascisme, donc, puisqu'il faut croire que nous sommes à l'orée d'une éruption brune. Encore faudrait-il le prouver ? Encore faudrait-il alors prendre les mesures en accord avec les paroles. Car toute cette mise en scène manque de profondeur. Si les groupuscules d'extrême-droite sont dangereux, qu'on les interdise, qu'on les combatte aussi virilement que sont capables de le faire les forces de l'ordre pour évacuer une usine occupée par des salariés. Si le Front National est un danger pour la démocratie, qu'on l'interdise. Purement et simplement. Si l'on est vraiment antifasciste, on ne peut pas prétendre comme on l'entend jusque dans les rangs de la droite (Fillon en tête) qu'il n'est pas dans l'arc républicain.
Pour le reste, l'antifascisme est une pirouette dont se targue à tout moment la gauche, oubliant qu'elle fut historiquement un pourvoyeur non négligeable des troupes fascistes dans les années 30-40.
Dernière chose : l'indulgence pour l'extrême-gauche et son masque antifasciste ne doit pas nous faire oublier que l'antisémitisme de ce milieu, au nom d'une lutte contre la capitalisme et le soutien aux mouvements post-coloniaux passant par la haine d'Israël, les rend fort perméables à certains discours islamistes. Il suffit de les voir s'accointer sur les campus. Mais de cela nul n'est jamais censé parler.
(1)Serge Halimi, Les Nouveaux Chiens de garde, Raison d'agir, 1997 (édition revue en 2005)
(2)Pas altermondialiste, mon-dia-liste !
(3)Ce qui ne manque pas de sel tant, par ailleurs, il conteste l'universalité au nom de la diversité...