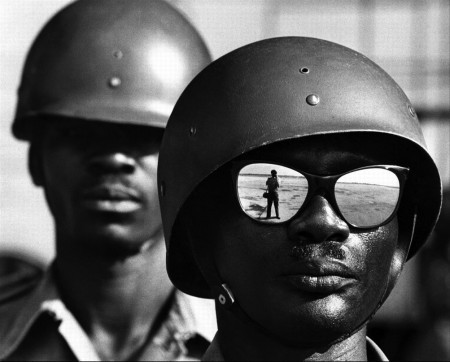C'est en feuilletant les pages d'un livre de photographies (accompagnées d'un texte de Truman Capote) qui lui est consacré que l'on prend conscience combien l'image de Marilyn est imprégnée d'une constance capable de nous la rendre familière. Par delà ce qu'elle vécut et qui n'appartient qu'à elle, son visage reste le même et si de toute sa beauté pulpeuse et magique il est plutôt logique d'en retenir les accents mélancoliques de la fin, des Misfits, sa présence demeure, persiste, tout au long de sa vie publqiue. Il n'y a en elle aucune mystification, seulement l'apprêt nécessaire à ce sacrifice hollywoodien devant lequel nous avons une position si ambiguë : à la fois l'attrait d'un monde d'artifice et la désillusion de cette guerre du faux qui ne fera que s'accentuer.
Les pages se tournent et ce toujours-là-même est la mesure désormais impensable d'un temps présent qui, lui, veut que nous soyons toujours autres, toujours dans le possible à venir, toujours dans la surprise, toujours dans le dérangement, c'est-à-dire le réarrangement de soi, dans une perpétuelle course à l'invention pour exister.
Et de penser, par ricochets, à Lady Gaga dont des étudiantes me montrèrent l'an passé le véritable visage, ne sachant quel il était. De penser, oui, à Lady Gaga dont le transformisme incessant n'est pas qu'une marque de fabrique, une manière de se singulariser : il ressortit aussi d'une métamorphose plus profonde de l'époque identitaire. À mesure que s'affichent les revendications de cet ordre se développe le besoin d'être incessamment ailleurs. Les multiples apparences de Lady Gaga, qui ne font plus qu'un avec ses apparitions, soit : la concomitance de l'être et de sa recomposition en autre, n'ont rien à voir avec le grimage de carnaval ou le maquillage classique de l'artiste (par quoi, parfois, justement il se signe). Que l'art du maquillage soit inhérent à l'espace spectaculaire et à la mise à l'écran d'une réalité que l'on vend pour éventuellement vraie est une évidence. Que cet art qui fascinait tant Baudelaire fasse l'aller-retour entre la scène et la vie, nul ne peut en disconvenir. Il suffit de rappeler, comme un trait symbolique, que Max Factor et Elisabeth Arden, avant de monter leur entreprise de cosmétiques, furent des maquilleurs de cinéma. Mais la problématique de Lady Gaga est un saut qualitatif aux perspectives vertigineuses.
L'invisibilité de Stefani Germanotta (son nom à l'état civil) est d'une tout autre mesure que purent être, par exemple, les déguisements des musiciens de Kiss : elle est con-substantielle d'une disparition profonde de ce qu'elle est. Se montrant autrement qu'elle est, mais dans le dépassement programmé de ce qu'elle est déjà devenue, puisque le but du jeu est qu'on ne la reconnaisse pas, sinon dans une reconnaissance qu'elle soit inconnaissable, elle dévoile à travers le masque l'accomplissement du narcissisme suicidaire de l'époque contemporaine. L'être-autre est devenu la défaite annoncée de ce que j'ai déjà fait pour être autre. Les multiples visages de Lady Gaga sont proprement des images, des imago, ces masques mortuaires que les Latins portaient en procession aux funérailles. Ils ne sont pas ce qu'elle a pu trouver pour être mais le signe de ce qu'elle n'a pu trouver que transitoirement.
Lady Gaga n'est pas une femme (ou un homme) mais une virtualité du temps présent, toujours présent, et donc toujours mort. Elle est une figure, un processus qui se montre au grand jour. Ses chansons, ses chorégraphies ne sont ni pires ni meilleures que le tout venant du easy listening FM. Ses produits n'ont rien de remarquable, ses talents non plus. En revanche, elle peut fasciner, par sa réalité d'objet virtuel. Un virtuel qui tendrait à devenir le fantasme de chacun. Faire de sa vie un perpétuel jeu de masques, où la réalité est suspendue de n'être plus qu'un arrière-plan permettant de se mettre en scène. C'est une course plus lourde de sens que le toujours plus du consumérisme classique, quand on pouvait croire faire la différence entre l'objet et soi. Lady Gaga, c'est l'objet en soi, l'objet de soi, et un soi diaphane, qui ne peut se fixer à rien.
Le précurseur pop de ce naufrage est évidemment Bowie, le Bowie qui se grime en Ziggy et multiplie ensuite les accoutrements, les modes, les orientations musicales, surfant sur ce qui peut se vendre, Bowie dont on fait une expo et qui sort un album minable.
Nous sommes loin, avec eux, de la chair de Marilyn, loin de ce temps où coûte que coûte la supposée superficielle et facile Norma Jean Baker demeurait fidèle à elle-même, et nous, fidèles à elle, parce que nous y trouvions une part de nous-mêmes, parce que nous savions que tout jeu a ses limites, parce que le fait de n'avoir qu'une vie est peut-être une désespérance, certes, mais une désespérance qui ne se contre pas en se démultipliant, en fracassant les miroirs.
De Marilyn à Lady Gaga, il y a bien plus qu'une perte qualitative sur le plan artistique, bien plus que le triomphe de la société du spectacle : c'est la suppression volontaire et jouissive du sujet. C'est la mort de l'Autre, l'angoissante mort de l'Autre qui hantait la pensée d'Emmanuel Lévinas. Autant dire un crépuscule...