
Mark Rothko, Rust and blue, 1953
"Je peins de très grands tableaux ; j'ai conscience que, historiquement, la fonction de peindre de grands tableaux est grandiloquente et pompeuse. La raison pour laquelle je les peins cependant -je pense que cela s'applique aussi à d'autres peintres que je connais-, c'est précisément parce que je veux être intime et humain. Peindre un petit tableau, c'est se placer soi-même hors de sa propre expérience, c'est considérer une expérience à travers un stéréopticon, ou au moyen d'un verre réducteur. Quelle que soit la manière dont on peint un plus grand tableau, on est dedans. Ce n'est pas quelque chose qu'on décide."(1)
Être dedans. Rothko peut-il mieux définir l'inespéré horizon qu'il ouvre à l'œil quand il sépare, sur une aussi grande étendue, les couleurs tout en les rendant, indépendant de tout classement strictement chromatique, complémentaires. La taille n'est pas chez lui qu'une question de surface, c'est aussi une problématique de la profondeur, d'un au-delà construit sous couver d'une ligne (parfois plusieurs) de partage et le regard plonge dans un volume qui le balade sans cesse de l'un à l'autre des endroits peints. Et chaque endroit, pouvons-nous écrire en français, est l'envers indissociable de l'autre, comme dans les figures d'un jeu de cartes. Par les contrastes dont il se saisit, Rothko nous oriente dans la toile, en détruisant au passage la question du haut et du bas et celle de la primauté du centre. C'est un état d'âme qu'il restitue, dans une alternance parfois douce, parfois violente. Ici, le bleu : en force, comme un grand sourire engoncé dans la tension des deux autres tons. Un bleu-noir où règne une légèreté inexplicable, à la façon d'une fumée qui se dissiperait progressivement. Un rouge obscurci de noir qui ressemble aux lueurs d'un crépuscule d'incendie très lointain. Mais pour ce ton-là, Rothko a choisi un autre mot qu'une couleur. Rust : la rouille. Moins une donnée chromatique que l'introduction d'une durée. Moins un fait, étant-là du monde, qu'une histoire. De là procède cette étrange incertitude de la couleur, sa non-uniformité, parce que justement il n'est rien en nous qui s'imprime comme le ferait une peinture étalée sur un mur, si nous devions regarder ce tableau sous l'angle d'un exercice de pure coloration. La variation et l'incertitude de l'esprit, son humeur (dans tous les sens du terme : à la fois sentiment, liquidité de soi, voire trop plein qui mérite saignée ou lavement...) se matérialisent par des reflets, des prises et des retraits auréolés.
Rothko peint, il a raison, un intérieur, le circuit interne de l'être qu'il est (de là les bords qui ferment le sujet). Il est dedans et en ce lieu exposé sur la toile cohabitent des extrêmes qui se souviennent l'un de l'autre. Ce n'est pas la bouillie d'un ton intermédiaire, unique, dans lequel on pourrait retrouver telle ou telle nuance. Avec lui l'affaire est plus tranchante : une opposition qui ne se fondra jamais, des contradictions qui ne s'annuleront jamais, parce que ce serait à ce titre le signe le plus clair de la mortalité de l'existence (laquelle est mortelle, certes, mais il faut bien, paradoxe de la vie, mettre cette seule vérité entre parenthèses, ou, sinon, couper court). Parfois l'exploration sent l'horreur ou la tension (chromatisme sombre) parfois l'éclat, la vitalité (chromatisme clair, comme ce qui suit).
Orange and Yellow, 1956
Il y a une grande latitude dans la peinture de Rothko, quelque chose qui, dans la diversité chromatique, marque le balancement des pulsions. Son expressionnisme est à cet endroit, dans cette friction et, à chaque fois, l'immersion est totale. Alors la rouille, puisque rouille ici il y a, est une expérience qui, plutôt que d'anéantir le regard (contemplant une mare de sang séché) dans un univers oxydé, le pousse aussi à courir vers cette bande bleue intense, sans concession, presque brutale. Tout se tient. Nous ne sommes jamais ce que nous croyons être, ou ce que nous voudrions être. Rothko peint à merveille ces alternatives de nous-mêmes que nous avons tant de mal à accepter. La rouille, toujours, ce souvenir de l'inconciliable cru inconciliable, un peu comme la formule définitoire de René Char : "Le poème est l'amour réalisé du désir demeuré désir". Et de ces observations, le peintre a raison d'écrire : Ce n'est pas quelque chose qu'on décide.
(1)déclaration au magazine Interiors, en mai 1951, pour l'enquête "Comment combiner l'architecture, la peinture et la sculpture".




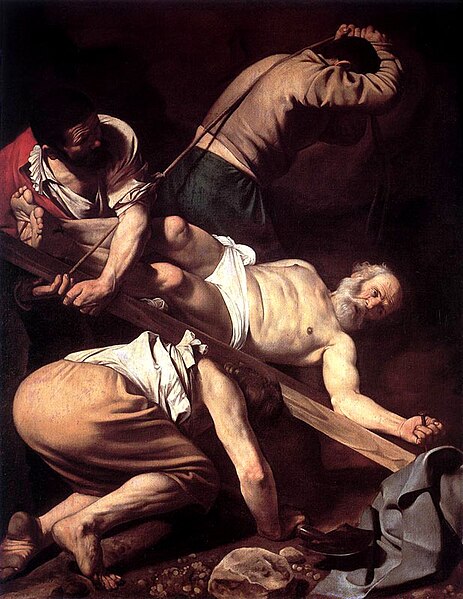
 Jackson Pollock, Number 1, 1950
Jackson Pollock, Number 1, 1950


