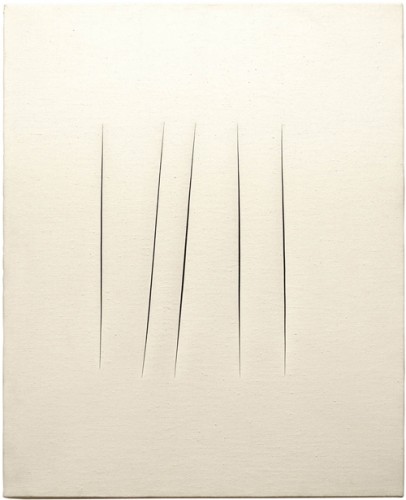Cet homme s'appelle Vincenzo Peruggia. Le 21 août 1911, il dérobe La Joconde. Ses motivations (apparemment le patriotisme) m'importent peu. Elles ne peuvent pas entrer dans l'histoire, plus intrigante, qui procède de son geste et qui en fait un récit complexe, je trouve, du temps écoulé dans le siècle précédent, récit qui trouve en quelque sorte son couronnement ces jours derniers dans l'enceinte d'une maison d'enchères.
La saveur du fait divers (qui a le mérite au moins de ne tuer personne et d'avoir préservé jusqu'à l'intégrité du chef d'œuvre retrouvé en 1913) commence par l'identité sociale du voleur. C'est un ouvrier, un modeste n'agissant visiblement que selon un désir personnel, sans la logistique ni les plans arrière dont s'assurent désormais certains monte-en-l'air contemporains. Plus délicieux : il est peintre en bâtiment. Cela ne s'invente pas. Aucun écrivain sérieux n'aurait l'audace de proposer un rapprochement aussi facile, cette rencontre improbable de l'artiste et de l'artisan. D'un côté la cosa mentale du maître parcimonieux de son génie ; de l'autre les grandes surfaces à recouvrir, le rouleau, l'échaffaudage. Quand on sait ce que pouvait être, pour le peuple, le monde du musée, le prestige de la peinture inscrite dans la tradition et dans l'art (1), le choc est saisissant. À bien des égards, Peruggia enfreint les règles les plus élémentaires de la distinction bourgeoise. Si on avait l'esprit politique, on serait enclin à voir dans ce vol un acte quasi... anarchiste, une déclaration de guerre à la confiscation de la culture dont est victime la classe prolétaire. Vincenzo en quasi révolutionnaire...
Mais pouvait-il l'être, ce cher Vincenzo ? La photographie (double) de l'identité judiciaire frappe par la conformité bien mise du délinquant (faut-il dire criminel ? En ces temps d'inflation sémantique, on ne sait jamais.). Le col raide, la cravate, l'habit respectable, la moustache soignée : celui que l'on soumet au répertoire argentique de Bertillon n'a rien d'un voyou. Guéant et les rois de la criminologie au faciès pourraient-ils, à l'aveugle, y voir la racaille ? Barthes en averti sémiologue l'inquiétude du prévenu ? Sans faire polémique, remarquons cette mise étudiée de l'ouvrier. Ce cliché est-il pris alors qu'on l'a interpellé un dimanche, quand il s'agit de sortir de la condition de la semaine ? Lui a-t-on laissé le temps de s'habiller ? Je ne sais. Mais ce portrait, face et profil, laisse rêveur. Le contemporain sent le lointain d'une société qui a vécu il y a à peine plus d'un siècle...
Photographie judiciaire, disions-nous, de 1909. Quelque trente ans auparavant, la traque de la délinquance a pris un tournant méthodologique. Bertillon et son fichage des individus ont ouvert la voie à une rationalisation dans la chasse aux déviances. Désormais, on aura leurs empreintes et leur tête (que parfois, pour l'exemple, on guillotinera...). Peruggia entre ainsi, parmi d'autres, dans l'éternité d'un acte conservatoire auquel le monde contemporain s'accommode très bien, sans trop se poser de question. Il est près pour son moment de célébrité, sans même qu'il l'ait cherché, sans même qu'il l'ait voulu. Car, pour envisager une telle éternité, il aurait fallu qu'il pensât aux dérives morbides et fétichistes d'une société de plus en plus morale dans le temps où ses instincts nécrophiles trouvent à se nourrir des images les plus pourries qui soient : du fait divers aux séries médicales... Et cela, Vincenzo Peruggia ne pouvait le concevoir.
Sinon, qu'aurait-il penser de celui qui, l'apprend-on cette semaine, a dépensé 3825 euros pour acquérir cette épreuve argentique prise en 1909 par Bertillon lui-même, épreuve d'une taille fort modeste (123 X 54 mm), témoignage d'une époque où le peintre en bâtiment n'était encore qu'un inconnu ? Acquérir un tel objet (mais s'agit-il d'un objet, d'ailleurs : peut-on dire que la photo soit un objet ? Le fait même de sentir que les deux mots s'excluent demanderait en soi un approfondissement. Est-ce parce que le principe de la trace qui fonde cette pratique prime sur le résultat ? Qu'il soit insupportable à l'homme devenu modèle de se penser comme objet ?) est-il si anodin ? Eût-il été un grand écrivain, un grand savant, un grand peintre, etc. que l'on comprendrait (pas vraiment, mais faisons comme si) ce besoin de posséder un portrait : il s'agirait de passer des heures infinies à scruter le regard, les traits du génie, à essayer de déceler les signes de l'exception, à faire, d'une manière paradoxale, en prétextant l'amour de l'art et la compréhension des hommes (bonne blague...), la même chose que nos apprentis criminologues quand ils cherchent dans l'œil ou la proéminence frontale la révélation de la dangerosité. Parce que ce cliché antérieur au vol fameux de Vincenzo ne peut être considéré qu'à l'aune de ce coup d'éclat. Or, si je le contemple, du mieux que je peux, il me semble que je ne puis guère dépasser les modestes considérations sociales (la mise, la tenue, la mode) et que ce visage quelconque ne me révèle rien de ce qui va se passer. C'est au motif d'un voyeurisme assez sournois que le portrait de Peruggia passe à la postérité.
Et l'on se prend à rêver d'une histoire désormais impossible qui aurait vu Andy Warhol acheter cette photographie, se lancer dans l'une de ses énièmes sérigraphies faciles et colorées, offrant au voleur de la Joconde une éternité d'œuvre appelée à finir accrochée sur les murs d'un musée x ou y. Puis, un jour, à l'occasion d'une exposition thématique exceptionnelle, autour du portrait, le commissaire de l'événement (et de savourer, évidemment, une autre rencontre sémantique entre l'art et la police) aurait eu l'idée délicate de placer l'un à côté de l'autre le grand Leonard et l'énigmatique Vincenzo. Et d'imaginer ce qui aurait pu être écrit sur le catalogue, de subtil, pour éclairer ce rapprochement...
(1)Encore les Italiens sont-ils sans aucun doute moins enclins au saisissement devant le chef d'œuvre tant leur quotidien de paroissiens les habitua à côtoyer les maîtres. En Italie, chaque église est un musée. Deux, trois tableaux : rien de plus, peut-être, mais quelle rencontre, quel ravissement... Pour se faire une idée, ne serait-ce que littéraire, de l'intimidation des musées on relira à la très fameuse visite du Louvre dans L'Assommoir de Zola