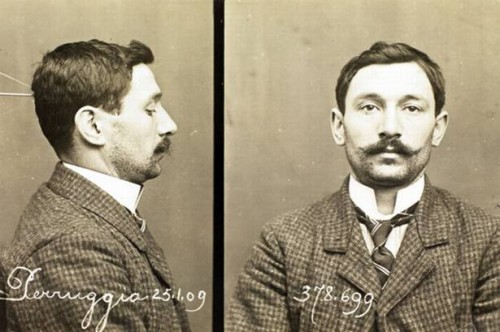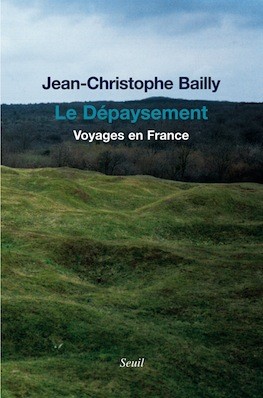Commencer ce billet en disant combien la mort d'enfants dans une école du territoire français constitue une horreur est déjà une concession au glissement de la raison vers la sensibilité, un renoncement de la pensée devant le pur (!) affect. C'est dire à quel point le système est vicié et court-circuite non pas toute capacité mais tout droit à penser le politique. C'est bien là la perversité de la logique médiatique à laquelle s'est soumis l'ordre prétendument démocratique. Il n'est plus possible de dire autre chose que sa compassion, de faire autre chose que de s'apitoyer. Et, de fait, présenter ses condoléances et ses regrets à ceux qui, dans leur chair, ont été effectivement touchés.
Il aura donc suffi (et je pèse mes mots) de quatre morts pour que tout s'arrête, pour que ceux, de tous bords, prétendant incarner la démocratie, renoncent à leurs convictions pour s'incliner devant la violence. Alors même que nul ne sait les motivations de l'assassin, que nul ne peut affirmer que les intentions sont politiques, ce qui pourrait éventuellement justifier une mobilisation nationale, la classe dirigeante (majorité et opposition comprises, unanimement) choisit de renoncer. Car, au-delà de l'émotion du carnage, c'est bien de cette position (faut-il parler de posture) qu'il s'agit. De toutes les imbécillités que nous aurons entendues depuis quarante-huit heures, de toutes les lamentations compassées, de toutes les pétitions d'union nationale que nous aurons entendues, la plus absurde sera venue de Marion Le Pen. Qui l'eût cru ? "Dans ces moments-là, il n'y a plus de politique. Il n'y a plus de droite, plus de gauche." Stupidité profonde que d'affirmer que ce sur quoi se fonde justement la démocratie (si elle existe) disparaît devant un crime qui pourrait (nul ne le sait) relever du droit commun.
Et voilà justement le problème. Le droit commun ne peut relever, a priori, du politique. Dès lors, invoquer, quand rien, absolument rien, dans les faits objectivement avérés, n'atteste que nous nous trouvons devant un acte politique, la nécessité de renoncer justement au politique (la fameuse suspension de la campagne présidentielle) signe la négation de la démocratie. Nous sommes là dans une situation dépassant de très loin la formule de Bourdieu : "le fait divers fait diversion". Le fait divers fait ici annulation, annulation de ce qui est, prétendument, le souffle républicain. La logique (car il serait, jusqu'à preuve du contraire, faux de parler de folie) meurtrière ne peut, ni ne doit être la porte ouverte au silence. Ce serait faire trop d'honneur à l'assassin, lui reconnaître un droit inaliénable à la parole passant par l'obligation d'un mutisme politique du pays entier.
Cette irruption de l'émotion dans la campagne est révélatrice de la molesse démocratique dans laquelle la France (entre autres) est tombée. La mort ne faisant plus partie du décor, la violence n'étant plus qu'une irréalité statistique, le cimetière une zone périphérique de l'organisation spatiale, nous avons oublié (ou occulté) une part de ce qui fait justement la vie. Quatre morts, dans le caractère spectaculaire de leur disparition, suffisent à un traumatisme national. Ou, du moins, suffisent à construire un scénario de traumatisme national. À l'aune des horreurs du monde, n'en déplaise aux pleureuses de service, c'est un peu court. Pour qui connaît un peu ce que sont les catastrophes de la planète, les violences endémiques de certaines parties du monde (où la mort, violente, injuste, barbare, est le quotidien), cette mise en scène capitale du meurtre ressemble à un étonnement enfantin devant la réalité de la vie. Invoquer que les enfants morts sont nos enfants (comme l'a affirmé Mélenchon) est ridicule. Ce serait substitué le quidam à la détresse d'un père, d'une mère, d'un frère, d'une sœur, dans le temps d'une unité nationale factice qui, une fois l'événement relégué au second rang de l'actualité, laissera les vrais meurtris à leur détresse sans retour.
Ce n'est pas le rôle des politiques, sauf dans le régime spectaculaire qui est le nôtre, de remplacer la parole du courage et de l'affirmation par les lamentations suspendant la revendication politique. De voir tout ce beau monde prendre des airs de contrition, de les voir accourir à Toulouse pour témoigner de la solidarité nationale, de les voir ainsi, attérés et sévères, ne rassurent pas. Si ces crimes devaient se révéler politiques, les visages pitoyables (parce que faussement apitoyés de ceux qui briguent le pouvoir) seraient autant d'invitation aux terroristes de tous bords pour s'emparer du temps médiatique contemporain, le seul auquel obéissent désormais les hommes à qui les démocraties molles occidentales donnent le pouvoir.
Une seule question, en substance : si un tel événement s'était produit deux jours avant le premier tour de la présidentielles, aurait-il fallu reporter l'élection ?