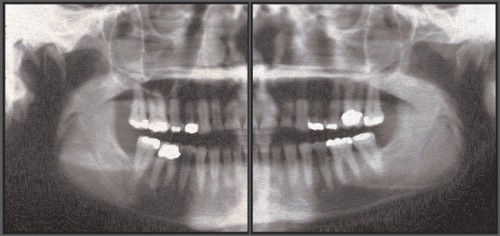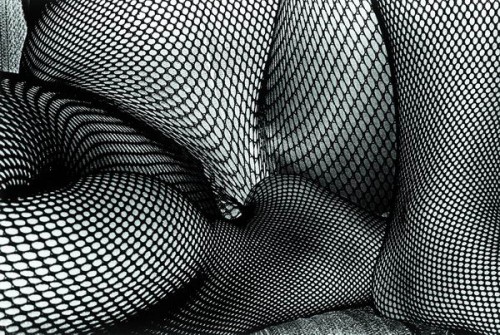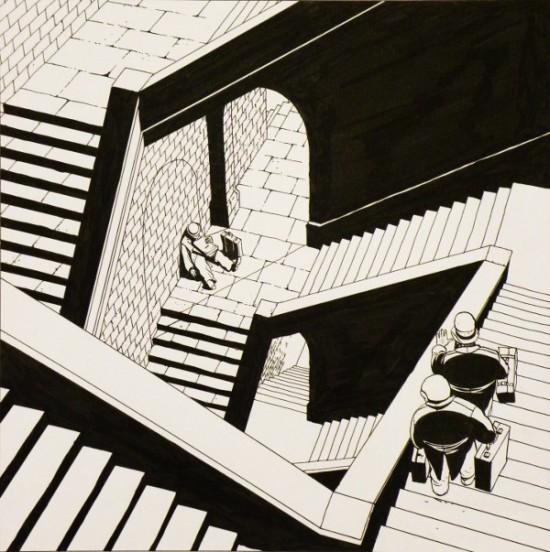Il a suffi de six gamelles dans le massif alpin, d'un risque de déflation (qui est bien plus terrible que l'inflation, laquelle inflation est pourtant, nous répète-t-on depuis longtemps, la pire des choses), un convoi louche du côté de la Russie, trois breloques (ou quatre, ou cinq) en athlétisme, un mille et quelquième mort d'Ébola (quand la malaria, ce sont des centaines de mille...), le suicide de Robin Williams, comique troupier d'un cinéma américain mainstream (comme on dit de nos jours), tout cela qui faisait qu'on avait notre quota de fait divers, de triomphalisme cocardier, et de bavardages sur un génie qui n'avait pas même fait un grand film, et alors Lauren Bacall n'était plus rien, et sa disparition finissait à la mi-journée au quatrième sous-sol...
J'avais déjà été assez surpris, à la mort de Liz Taylor, d'une certaine forme de confidentialité. Et voilà que je la retrouvais. Bizarrerie du calendrier, creux estival, indisponibilité des pleureuses de service...
Je crois que c'est plus simple. Même s'il ne s'était rien passé (mais il ne s'est rien passé, on a fabriqué du discours informatif, on a occupé l'antenne, et à ce titre tout est bon, sauf, peut-être, les chrétiens d'Orient qu'on massacre...), Lauren Bacall n'aurait pas tenu la distance, parce que Lauren Bacall n'est rien. Je n'entends pas qu'il faille en faire des heures et des heures, et qu'une actrice soit une icône devant laquelle on doit se prosterner. Je veux dire qu'elle n'est rien parce que le XXe siècle a produit (le mot n'est pas trop fort) des stars, des légendes, des monstres sacrés, dont la durée de vie est dérisoire. Lauren Bacall n'avait aucune chance et fût-elle morte le même jour que Robin Williams qu'elle eût dû céder la place, parce que dans la hiérarchie contemporaine des vanités elle est déjà reléguée dans les terres de l'ignorance.
Elle avait 89 ans, ne tournait plus (ou presque) depuis des lustres. Elle était, d'une certaine manière, entrée dans l'histoire du cinéma et notre époque, notre culture consumériste, hédoniste et immédiate n'a que faire de l'histoire, de toutes les histoires. Au petit matin, c'était une légende ; à midi, un troisième titre, le soir plus rien. Lauren Bacall était une actrice mais son œuvre, si lointaine, ses films, si vieux, ses personnages, si datés, n'existent plus pour un monde de l'obsolescence accélérée. On pourrait croire que la littérature ou les arts les plus anciens sont touchés par cette inéluctable déchéance. Il n'en est rien. Lauren Bacall, c'est aussi dépassé, ennuyeux et vide que Beethoven ou Proust. Cela ne leur dit rien, et si cela ne leur dit rien, il faut en déduire que cela n'a jamais existé.
Dès lors, fallait-il évoquer Bacall et Bogart, le regard de Lauren servant le petit-déjeuner à Humphrey dans Les Passagers de la nuit de Delmer Daves (et son début en caméra subjective...) ? Fallait-il revenir sur ce que fut le cinéma hollywoodien, les années 40 et 50 ? Fallait-il esquisser une histoire des vraies stars de l'époque ? Mais pour qui ? Pour des gens que leur passion d'il y a cinq ans ennuient déjà.
La veille, on avait déprogrammé pour célébrer Robin Williams et sa mémorable Madame Doubtfire (vu, il y a longtemps, trois minutes : insupportable de cabotinage. Autant revoir un bon vieux Jerry Lewis...). C'était jouable : pas trop ancien et en couleur. Pas de quoi perturber de trop le cinéphile contemporain. Mais Lauren Bacall...