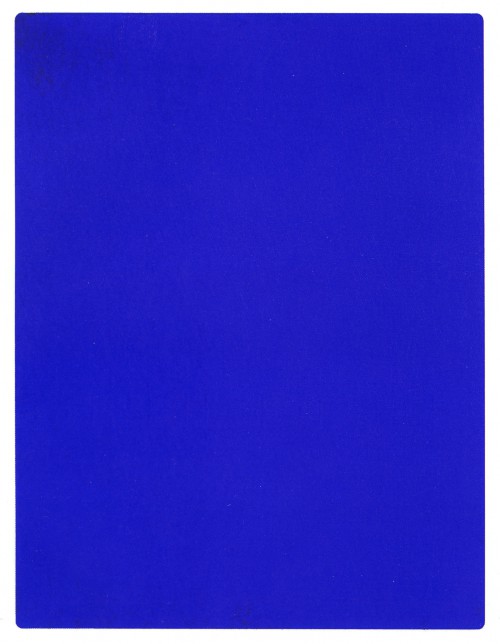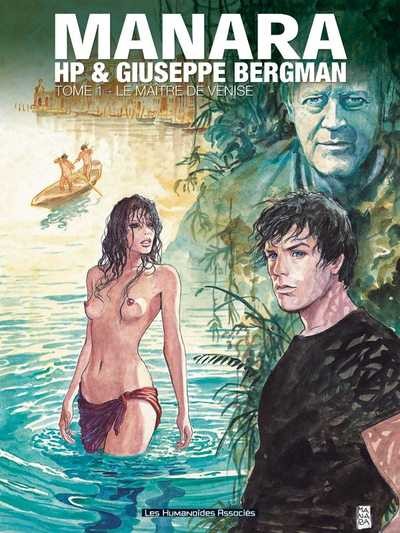Figure vénérable que celle de Leonardo Loredan, doge de Venise au tournant du XVIe siècle et qui, plus qu'aucun autre dignitaire de la Sérénissime, voit sa personne traverser les âges et venir jusqu'à nous. Comment pourrait-il en être autrement lorsqu'on a été immortalisé par deux peintres aussi magnifiques que Carpaccio et Giovanni Bellini (dit Giambello).
Deux portraits. Deux fois, à un an de distance, la représentation du pouvoir. Deux variations, en apparence, mais bien plus pourtant. La question ne porte pas sur l'évaluation de l'art de l'un et de l'autre, sur les capacités des deux peintres (1) mais sur ce que projettent les deux portraits. À chaque fois le modèle est représenté dans son habit d'apparat, avec la coiffe qui désigne son autorité politique. Le caractère officiel des deux tableaux ne peut faire mystère.
C'est moins l'homme que la fonction qui est en jeu. Mise en scène du pouvoir, certes, mais avec une relative modestie des effets. On évite dans les deux cas les fastes, la grandiloquence. L'homme seul, le Doge, tel qu'en lui-même. Le pouvoir en son incarnation.
Un an d'écart entre les deux peintures et pourtant deux explorations très distinctes de la puissance et de l'exercice de la force politique (et de sa transformation à venir).

Carpaccio, Portrait du doge Leonardo Loredan, 1500, Musée Carrara, Bergame
Carpaccio peint Loredan de profil, selon un modèle ancien (si l'on veut penser par exemple au premier tableau d'un roi seul : le Jean II Le Bon, au milieu du XIVe siècle. On se tournera aussi vers l'œuvre anonyme représentant Louis XI). On pense à l'art des monnaies. Un tel choix marque les traits du personnage. La silhouette souligne la rudesse et la sécheresse du visage. Les deux lignes qui traversent la joue durcissent plus encore le portrait. L'unité chromatique (l'habit, la coiffe et le teint) accentue l'austérité de la représentation. Le pouvoir politique tire sa force et sa forme d'une sévérité sans laquelle on ne comprendrait pas sa légitimité. La fenêtre ouvre sur un paysage qui rappelle l'île San Michele, celle qui serte de cimetière à la ville. Rien qui puisse vraiment adoucir le propos.
Dans la peinture de Carpaccio, il y a comme la fixation d'un temps ancien, quand la rigueur seule valait loi. Le pouvoir est chose sérieuse. Il n'y a qu'un visage à offrir. En ce sens, le profil détermine la thématique de l'unité. Loredan est froid, marmoréen. il ne présente aucune faille. Il délimite et définit le pouvoir comme une œuvre austère et en partie cachée. Le secret est posé : il est constitutif de la puissance. On le sait, on le voit. Le tableau est coupé en deux. À gauche, le paysage, le ciel et la lumière ; à droite, le noir absolu, l'impénétrabilité des choses, le silence. On le voit ; on voit qu'une part de l'être-au-pouvoir sera invisible, incernable. Au moins n'a-t-on pas l'aporie contemporaine de la transparence...
Le Loredan de Carpaccio est, d'une certaine manière, très clair : très clair de son obscurité posée comme préalable à tout. Tout est peint, jusque dans ce qui ne peut se peindre, sinon au noir. Œuvre au noir d'une alchimie des puissances qui ne transigent pas...

Giovanni Bellini, Portrait du doge Loredan, 1501, National Gallery, Londres
On reconnaît aisément Leonardo Loredan dans le tableau de Bellini. Il ressemble à celui de Carpaccio. Ce n'est, malgré tout, pas le même homme. Peint de trois quarts face, sur un fond bleu qui adoucit l'ensemble, le doge porte des habits clairs. L'ombre du visage est à peine soulignée, moins un signe à interpréter qu'un effet de vérité inclus dans le cadre perspectif.
Cette fois, le spectateur contemple le visage dans sa totalité. Il regarde le pouvoir en face. Mais le pouvoir le regarde-t-il lui, en face ?
La première impression qui se dégage du portrait de Bellini renvoie à l'humanisation du personnage. Les traits sont adoucis, moins anguleux ; le nez et le menton tranchent moins. Un instant, on pense à un homme ordinaire, presque banal, une image quasi parfaite de cet idéal vénitien incarné par le modèle républicain. Tout doge qu'il est, Loredan reste un homme. Impression fugitive cependant, parce que le portrait est moins beau qu'il n'est fascinant, c'est-à-dire dérangeant. Son unité physiologique n'est pas en cause. Il n'y a pas d'erreur ou de maladresse. La question est ailleurs, dans la faille symbolique que l'artiste a fixée dans ce visage. Faut-il d'ailleurs parler de faille, alors qu'il ne s'agit, dans le fond, que de détermination politique.
La profondeur de ce portrait scelle son secret en deux points. Le premier est le moins original : ce sont les yeux. Loredan ne fixe pas le spectateur potentiel. Son regard se porte au-delà. Tout présent qu'il soit, son être demeure insaisissable. Il n'est pas à qui il se donne à voir. Bellini, malgré tout, n'explore pas ce qui pourrait être de l'arrogance ou de la vanité. Il cerne plutôt l'inévitable retrait du monde par quoi, justement, est orienté le monde du point de vue du politique qui en a la charge. L'œil politique bellinien possède en même temps la vivacité (l'œil est petit, la vue perçante. Une sorte de rapace...) et le détachement. Il a l'air d'un sphinx.
Cela suffirait-il pour en faire un chef d'œuvre ? Sans doute pas, s'il n'y avait la bouche. Peut-on voir plus remarquable ambiguïté qu'elle en peinture ? N'épiloguons pas... mais d'avoir vu, il y a longtemps, ce tableau à Londres, il m'en est resté un souvenir fulgurant, et presque désagréable. Loredan ne sourit pas. Sa bouche n'est pas très marquée, les lèvres sont fines. Il a le sérieux de la fonction. Il ne sourit pas. Quoique... La commissure gauche (face à nous) semble légèrement se soulever. On le regarde encore. La bouche est délicate et tranquille, presque indulgente. Pourtant à la commissure droite, la raideur. Tout est là, dans la rigueur indicible que j'ai devant moi. Telle est l'étrange modernité du tableau de Bellini, sa beauté terrible et sa grandeur révélatrice. Le pouvoir est-il réductible à l'écrasante distance et à la puissance implacable ? C'est la version de Carpaccio.
Le pouvoir tient-il à l'incertitude dans laquelle on laisse celui qui le subit ? Dans la magnanimité de façade par quoi on se laisse prendre au piège ? Dans le jeu des rôles multiples que les puissants apprennent à maîtriser ?
La bouche de Loredan fait converger tous ces temps divers du pouvoir qui n'est pas un, d'un bloc, sans quoi il ne survivra pas, mais protéiforme.
Cette bouche par où sortent le pardon ou la sentence, la mansuétude et la terreur. Elle est le fonds/fondement du tableau. Bellini ne réduit pas le pouvoir à un état des choses, l'être, mais lui suppose une dynamique que seule peut modeler la parole. Le Loredan de Carpaccio est muet, celui de Bellini parle. Et il nous parle. Il est contemporain du pouvoir que l'on met désormais en scène.
Le theatrum mundi est infiniment redoutable, quand on n'en connaît ni les règles (ou si peu...) ni les visages les plus élémentaires. On se prévient d'un Loredan de Carpaccio. On s'arme, tant bien que mal. On est démuni devant un Loredan de Bellini. L'extraordinaire puissance de cette œuvre vient de là, puissance de ce qui est dit, avec finesse, sans que jamais la beauté de l'art et la délicatesse de la main ne passent au second plan. Du génie, rien de moins...
(1)Carpaccio est un peintre sublime. Le cycle de la Scuola di San Giorgio dei Schiavoni est un des plus beaux qu'on puisse jamais admirer à Venise.
J'ai évoqué Bellini (et le vol d'une de ses œuvres vénitiennes) dans une nouvelle.