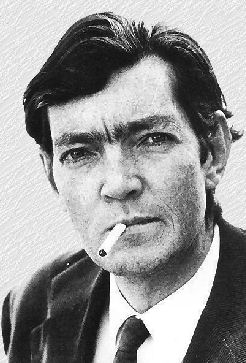Judith et Holopherne (1598), Palais Barberini
J'ai déjà évoqué sur ce blog des œuvres du Caravage, et d'abord, à mes yeux, le plus beau tableau du monde. Pour l'une d'entre elles il était question d'une décapitation ; pour celle qui m'occupe aujourd'hui, le peintre met en scène le meurtre en cours. Judith est une jeune femme, veuve de Manassé, qui, pour libérer son peuple de la tyrannie d'Holopherne, tue ce dernier. Le sujet sera traité à de nombreuses reprises par les peintres. Ce n'est pas, là encore, le tableau le plus réussi de l'artiste. Le jet de sang est maladroit, le corps tout en torsion de la victime est un peu lourd, les avant-bras de Judith, certes guerriers, ont quelque chose de masculin. On a l'impression que le tableau, dans un découpage vertical et médian, oppose le côté gauche et le côté droit et que plus nous nous déplaçons vers la droite justement plus il est accompli. Que cache ce visage presque de candeur horrifiée de Judith ? Que peuvent signifier ces tétons pointant sous l'habit ? Il y a comme un trouble autour de la meurtrière qui représente déjà une énigme. Mais la puissance de Caravage est ailleurs, dans un troisième personnage qui n'est pourtant, en apparence, que secondaire. Qui est-elle, cette vieille, sur laquelle notre attention se fixe progressivement jusqu'à devenir le centre d'une question tournant autour du sujet peint ?
Pour éclaircir notre propos, il faut revenir à l'écrit qui sert de point d'appui à cette représentation. Le texte biblique, dans la traduction des éditions du Cerf, dit ceci :
« Quand il se fit tard, ses officiers se hâtèrent de partir. Bagoas ferma la tente de l'extérieur, après avoir éconduit d'auprès de son maître ceux qui s'y trouvaient encore. Ils allèrent se coucher, fatigués par l'excès de boisson, et Judith fut laissée seule dans la tente avec Holopherne effondré sur son lit, noyé dans le vin. Judith dit alors à sa servante de se tenir dehors, près de la chambre à coucher, et d'attendre sa sortie comme elle le faisait chaque jour. Elle avait d'ailleurs eu soin de dire qu'elle sortirait pour sa prière et avait parlé dans le même sens à Bagoas. (Jdt, 13, 1-3)
[...] Elle s'avança alors vers la traverse du lit proche de la tête d'Holopherne, en détacha son cimeterre, puis s'approchant de la couche elle saisit la chevelure de l'homme et dit : « Rendez-moi forte en ce jour, Seigneur, Dieu d'Israël ! » Par deux fois elle le frappa au cou, de toute sa force, et détâcha la tête. Elle fit ensuite rouler le corps loin du lit et enleva la draperie des colonnes. Peu après elle sortit et donna la tête d'Holopherne à sa servante, qui la mit dans la besace à vivre, et toutes deux sortirent du camp comme elles avaient coutume de le faire pour aller prier. » (Jdt, 13, 6-10)
Le fait marquant est que cette vieille est la servante de Judith. Soit. Mais il est entendu que lors de l'accomplissement du meurtre, elle est absente. C'est donc une entorse au respect textuel que de la faire figurer. Cette liberté caravagesque n'est pas anodine parce que ce visage ne nous est pas inconnu. Il a de toute évidence une certaine parenté avec celui d'une autre vieille, bien plus prestigieuse, peinte à côté de la Madone des Palefreniers, œuvre exposée à la Villa Borghese. Il s'agit alors de voir Jésus enfant écrasant, avec l'aide de sa mère, une serpent malin. Dans les deux cas, ces personnages assistent donc à un acte de violence à la fois réel et symbolique. Dans les deux cas, s'ils n'y participent pas directement, ils en sont les spectateurs particuliers, des témoins jugés nécessaires. Pour revenir à Judith, ce qui saisit procède de deux éléments marquant la tension qui habite la vieille. Les traits sont crispés, la mâchoire ferme, l'œil avide. Si elle ne tient pas le cimeterre assassin, c'est tout comme. À l'effarement de la jeune femme répond, dans un processus de susbtitution, la volonté affichée de la servante. À la jeunesse douce de Judith répond le grand âge buriné de la suivante. Il y a en elle une volonté farouche, une détermination stupéfiante qui inquiète. Il faut alors regarder ses mains serrant fort le tissu de son vêtement. Les poings ne sont, semble-t-il, que le premier moment de la jouissance en elle. Ce qu'elle tient, et qui n'est qu'un substitut de l'objet réellement désiré, est encore dans la retenue de la victoire qui va advenir ; mais l'on devine qu'à l'heure de la tête totalement tranchée, les poings s'écarteront et le tissu sera tendu, tendu et raide comme une lame de cimeterre (quoique ce ne soit pas exact puisque celle-ci est courbe). La vieille aura, autant que Judith, obtenu gain de cause.
C'est à ce titre que ce tableau intrigue (ou, pour être juste, qu'il m'intrigue). L'écart avec le texte biblique explore la question du discours de la vengeance et celui de la responsabilité. Ce désir de peindre un second couteau avec une telle précision, avec le souci de la styliser plus que les deux acteurs annoncés et connus de l'histoire, donne à penser qu'elle est une nécessité du tableau, et pourquoi pas sa finalité. L'histoire n'est donc plus un règlement à deux, un affrontement, qui peut servir dans une perspective d'analyse psychologique ainsi qu'elle est (en partie) réinvestie par un Michel Leiris dans L'âge d'homme, mais un jeu à trois. Une triangulation qui n'est pas exactement de même nature que celles qui ont servi à Freud ou à René Girard mais qui s'en rapproche. Plus je contemple ce tableau et plus je m'interroge : qui sert qui ? Qui est au service de qui ? La vieille récupéra la tête d'Holopherne, soit. Elle n'a rien fait. Simple complice. Mais est-ce vraiment le sens du dess(e)in de Caravage ? Ne suggère-t-il pas que Judith n'est rien moins que l'instrument d'une volonté qui excède sa seule personne (et pas simplement parce que dans le texte biblique, elle est aux ordres de son dieu), et que celle qui veut vraiment, dont l'âme est ardente, est l'inconnue à ses côtés. Dès lors, cette œuvre explore discrètement la question de la responsabilité, le jeu entre suggestion et sujétion. Caravage ne peint pas ce sujet dans la perspective d'une simple illustration biblique. Il introduit une dramatisation en relation avec l'émergence d'une société où la question de la part dévolue au choix de chacun est grandissante. Ce qui est acte -ici, le meurtre- n'est peut-être pas compréhensible sans le regard que l'on porte sur ce qui entoure son effectuation. Il ne s'agit pas de s'en tenir à la seule démarcation stylistique d'un réalisme mis sur le devant de la scène (et la vieille est, en effet, très en avant) mais d'évoquer ce qui se trame aussi avant la scène, hors de la scène. Et la plus forte des deux femmes, du moins la plus importante dans la projection que l'on peut faire de ce tableau sur la détermination des individus à agir ou non, n'est pas celle que l'on croit.