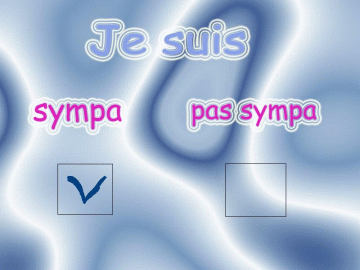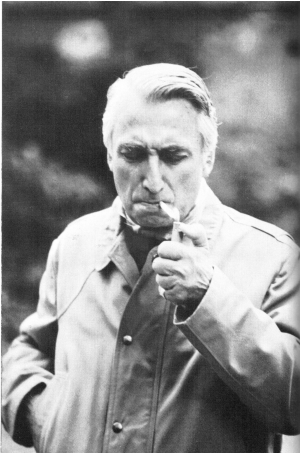Si le symptôme regarde le futur, annonciateur d'une transformation, d'un désordre ou d'une entropie, il touche aussi au présent, et même au passé (proche). En lui est aussi la trace (l'indice) d'un phénomène déjà en cours. Ainsi la séméiologie médicale n'est-elle pas simplement l'histoire d'un diagnostic (en vue d'un pronostic), elle est aussi retour en arrière... C'est dans cette perspective que la sémiologie des faits sociaux peut aussi s'appréhender. Et sur ce plan, il n'y a pas d'événement qui vaille plus que d'autre, d'advenu plus noble ou plus sérieux, parce que tout est trace, lisible ou non, inscrite dans le champ plus général des affaires du monde.
Prenons ainsi ce qui s'est passé la semaine dernière, pour inaugurer (à prendre dans son sens quasi religieux d'annonce) la finale de rugby entre la Nouvelle-Zélande et la France : le fameux haka, lequel est, pour les non avertis, un chant hérité des Maoris, accompagné d'une danse assez simple, et qui, sous ses apparences un peu rudes, n'a rien à voir avec une quelconque volonté de tuer.
Nous sommes dans le rituel, intégré comme tel dans l'espace d'un terrain de jeu. Pour reprendre une distinction de Michel Foucault, une sorte d'hétérotopie dans l'hétérotopie, croirait-on : la suspension à double niveau de l'ordre du monde pour lui substituer un ordre plus restreint, plus intime en quelque sorte, où sont concernés au premier chef les joueurs des deux équipes. Avec du recul, on en vient à se dire que ce à quoi nous sommes réduits ramène à un pur moment de voyeurisme. Devant l'écran ou au stade, nous sommes témoins d'une histoire qui peut certes nous émouvoir (le frisson du cri, des hommes en ordre de bataille, le noir contre le blanc, la suspension du temps, la connaissance du déjà-vu -et donc le plaisir de la retrouvaille) mais qui ne nous concerne pas. Plus que jamais (et comme il me semble, dans aucun autre sport, même au moment des hymnes nationaux (et pour être clair : surtout à ce moment-là)), nous sommes hors-jeu.
Il faut dès lors considérer le moment du haka comme un temps soustrait à l'ordre, pour un rite quasi privé, auquel nous ne pouvons pas participer (1), parce que la communion n'est pas là où nous croyons qu'elle est : le haka n'est pas la réunion d'un camp (joueurs et supporters) mais l'union des deux équipes, des adversaires.
C'est d'ailleurs en ce sens que les joueurs français l'ont très bien compris. Et cela en deux temps. En commençant d'abord par se disposer en V. Puis en avançant jusqu'à la ligne médiane. On pourra toujours mettre cette stratégie sur le compte de l'intimidation d'avant match, à la manière des déclarations intempestives qu'on trouve dans les journaux ou dans les conférences de presse. Il s'agit de ne pas se laisser impressionner, de se montrer, d'être présent. L'enjeu est à ce niveau, soit. Mais ce principe est repérable depuis longtemps, lorsque les équipes s'alignaient devant les All Blacks et les regardaient accomplir leur rituel, impassibles. Dans ce que font les Français, il y a comme un supplément d'âme, et plus encore. Il y a une réponse. La disposition classique consistant à écouter, raide comme un piquet, le chant maori laisse sa place à une action, c'est-à-dire à une parole, non pas au sens linguistique certes, à une adresse. À ceux qui leur parlent, ils répondent. Partir de son camp et s'avancer vers l'autre est une manière de lui signifier son existence et, très important, lui signifier la sienne. C'est établir l'échange dans ce qu'il a d'interpersonnel (quand bien même ils sont nombreux de chaque côté), dans ce qu'il abstrait le monde qui entoure les participants. Les Français prennent le haka pour ce qu'il est vraiment : un partage, un murmure au creux de l'oreille, une reconnaissance, un don (qui induit le guerredon).
Mais l'histoire ne s'arrête pas là et prend une autre dimension lorsqu'on apprend le lendemain que l'International Rugby Board condamne, pour "contre-haka", l'équipe française à une amende de 2875 dollars. Pour l'essentiel, on leur reproche de ne pas être restés à leur place et d'avoir franchi la ligne médiane, d'être allés dans le camp adverse. Ils ont enfreint la loi. À ce niveau, ce ne sont évidemment pas des délinquants, moins encore des criminels, mais des contrevenants. Voilà qui ne manque pas de sel, puisqu'en allant à la rencontre de ceux qu'ils reconnaissaient comme tels, ramenant le jeu à son humanité, ils allaient à l'encontre de la loi. Peu importe que le président de la fédération néo-zélandaise ait jugé inutile la sanction, qu'aucun joueur all blacks n'ait trouvé à redire sur l'attitude tricolore, que les Français, ayant gagné le toss, eussent pu jouer en bleu et qu'ils préférèrent jouer en blanc pour laisser les néo-zélandais à leur mythique couleur ; peu importe les élégances, quand l'ordre, celui qui n'a pas à se justifier, est en danger.
Franchir la ligne : tout est là. Afficher le désir collectif d'une communion qui met à mal l'autorité, telle est la visibilité de ces presque deux minutes où le cours des choses est entre parenthèses. Le faire ainsi au vu et au su du monde était insupportable à qui de droit. La sanction pourrait être considérée sur le seul plan sportif mais ce serait aller trop vite en besogne. C'est en ce sens qu'elle est un symptôme. Elle en dit long sur l'état du monde qui, sous couvert d'une plus grande liberté, s'ingénie à écraser toute velléité existentielle. Jouez, courez, trichez, soyez sanctionnés par l'arbitre, battez-vous... mais n'essayez pas d'être, d'exister, et surtout ne donnez pas au combat, à la lutte, à l'affrontement les limites de votre humanité. Un simple détail, sans doute... par lequel on reconnaît la coercition sournoise d'un ordre festif. Les figures mises en avant dans le moment de l'événement (une finale tout de même, et en chef de rébellion, celui qui sera désigné dans la foulée meilleur joueur du monde) ne sont rien, ne doivent rien avoir à penser, et surtout, elles ne doivent pas croire en l'existence de l'autre.
Sous cet angle, et parce que cette histoire n'engage pas grand chose sinon une victoire sur un terrain (80 minutes et puis on passe au divertissement suivant), il y a de quoi désespérer profondément du monde qui nous entoure. Arrivé à ce point de terreur disciplinaire, il tombe dans l'absurde, et l'absurde, dans le réel, est mortifère.
(1)À l'inverse des hymnes, que la foule peut reprendre en chœur, le haka se fait dans le silence. Il n'est pas question pour quiconque n'est revêtu du maillot (titulaires et remplaçants) de se l'approprier.

 Jackson Pollock, Number 1, 1950
Jackson Pollock, Number 1, 1950